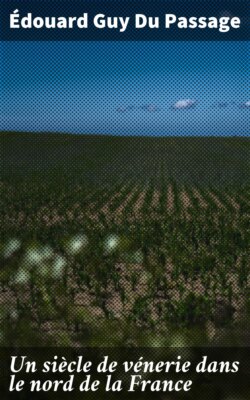Читать книгу Un siècle de vénerie dans le nord de la France - Édouard Guy Du Passage - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AU LECTEUR
ОглавлениеTable des matières
J’étais en seconde, chez les Dominicains, à Arcueil, m’ennuyant terriblement. La vie d’internat ne me plaisait guère et j’eusse eu grand’peine à l’accepter si je n’avais possédé un camarade.
Cet ami n’était autre que les Gentilshommes Chasseurs, de Fondras. Je l’avais lu et relu vingt fois; j’étais aussi amoureux que Lord Henry de la comtesse de Senozan, débuchant sur la Légère, et j’aurais tout donné pour que le Curé de Chapaize fut notre surveillant d’études.
Mon bouquin n’étant pas de la bibliothèque de l’Établissement, je l’avais habilement maquillé. Découpant les pages de mon dictionnaire, j’y avais introduit mon livre de prédilection. Quand j’avais l’air de faire des recherches minutieuses sur tel ou tel sens d’une phrase latine, je chassais le loup Baptiste à travers les trois royaumes.
Je me mis à illustrer l’ouvrage avec toute mon imagination de gamin, et, aux vacances de Pâques, j’apportais triomphalement à mon Oncle le fruit de mon travail de seconde; celui-ci, qui me poussait fort dans la voie des Arts, en fut ravi. Il fit relier le dictionnaire de Belin et son contenu dans la paroi d’un grand vieux sanglier, et j’ai toujours plaisir à refeuilleter ce résultat de mes études.
C’est à cette époque que germa, dans ma pensée, l’idée de ce volume. S’il a mis plus de vingt ans à voir le jour, c’est que, passionné de chasse et de peinture, j’ai passé cette partie de mon existence à courir derrière des chiens et à reproduire, du moins mal que j’ai pu, les scènes pittoresques que j’avais vues.
Quand, il y a trois ans, j’ai commencé à rassembler les éléments de ce travail, je croyais n’avoir qu’à questionner mon père et quelques amis pour arriver à mes fins. J’étais loin de compte!
J’ai eu trois genres de collaborateurs: les mécontents, les indifférents, les complaisants.
Les mécontents. Peu le disaient ouvertement, mais certains laissaient entendre leur rancune: «Mon grand-père ou mon grand-oncle a beaucoup chassé à courre, mais il a beaucoup dépensé ; il s’est ruiné, et alors notre héritage s’en est ressenti.» Voilà le premier cliché.
Les indifférents: «Mon cher Ami, excusez-moi, je rentre d’une battue où on a tué... (suit le tableau), je repars demain chez un tel pour telle battue. Mon père chassait à courre, paraît-il; je ne retrouve même plus ses boutons. Qui s’intéressait à ce sport d’un autre âge a disparu. Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous être agréable.» C’est le second genre.
Aux complaisants. Ils ne furent que quelques-uns, mais ceux-là ont su remplacer les autres, en m’aidant de tous leurs souvenirs. Je les remercie grandement de leur savante collaboration. Mais tous, je n’hésite pas à le dire, vibrent encore au moindre son de trompe, et la rage du fusil ne les a pas encore conquis à tel point qu’ils soient obligés, à la fin de chaque traque, de faire un calcul algébrique pour arriver à trouver le total de leurs victimes.
Certes, l’esprit moderne, la culture plus perfectionnée de nos contrées, le morcellement des propriétés, sont autant d’écueils qui ont rendu la chasse à courre très difficile dans notre région, mais la mode des battues n’est pas étrangère à cette difficulté.
Tout propriétaire de bois se doit, à l’heure actuelle, de donner une battue et veut un tableau. Toute son année, il fera garder son gibier, paiera des dommages, passera des journées chez le Juge de paix, s’abstiendra même de tirer un coup de fusil chez lui pour distraire, non pas lui-même, mais les autres, un jour par an.
Avec quarante lièvres qui, en deux traques, en moins d’une demi-heure se sont laissé assommer en faisant le chandelier à dix pas, on aurait eu de quoi amuser, six mois durant, ses amis et soi-même, en les forçant de bonne guerre; mais ce n’est plus le goût du jour, et, aux nombreux vautraits ou équipages qui se sont succédé en Picardie depuis un siècle, il ne survit que deux modestes meutes de lièvre.
Cet ouvrage, je le confesse, ne répond pas à l’idéal que je m’étais fait; je l’eusse voulu plus anecdotique, plus divers dans son ensemble. N’osant me laisser emporter par mon imagination, j’ai transcrit simplement les notes que j’ai pu rassembler et les souvenirs que j’ai recueillis. De Fondras, d’Osmond, Levêque, eussent su faire revivre toutes les figures que j’évoque tour à tour, mais je n’ai pas su ramasser la plume qu’ils ont laissé tomber, et j’en demande pardon au lecteur.
Nos buissons de Picardie et d’Artois, les vieilles futaies d’Eu et de Crécy ont leur histoire, et, avant que la hache ait fini d’en anéantir le souvenir, j’ai voulu narrer les exploits de ceux qui ont passé, sous leur couvert, les meilleurs moments de leur existence.
Je m’étais tracé comme cadre l’Artois et la Picardie, Si parfois, tel un ragot cherchant aventure, j’ai percé fort avant à travers pays, ce sont les chiens qui m’ont entraîné à leur suite dans des déplacements éloignés.
Quant aux veneurs qui poursuivaient le cerf de Saint-Gobain à Villers-Cotterets, si leurs prouesses se passaient en plein Valois, ils n’en avaient pas moins leur place ici, leur devise étant ce recri dont la suite de ces pages justifiera l’exactitude:
PICQUARD-PIQU’HARDI
Drucat, 8 janvier 1910.