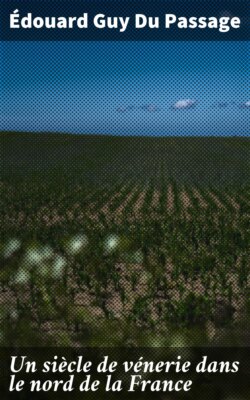Читать книгу Un siècle de vénerie dans le nord de la France - Édouard Guy Du Passage - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa BARONNE DE DRAËCK
La Baronne de Draëck
Table des matières
DÈS son jeune âge, Mademoiselle de Lamétan donna des signes indubitables de passion cynégétique, passant son temps chez les Ursulines, où elle faisait son éducation, à courir sus aux rats par-dessus les tables, bureaux ou armoires du couvent.
Dès sa sortie de pension, elle adopte les habits masculins, et c’est bien à contre-cœur qu’elle se laissa marier au Baron de Draëck, seigneur d’Oudezeele, près Cassel.
Présenté à la jeune personne, le Baron de Draëck commença par lui persuader qu’il la laisserait libre de s’habiller à sa fantaisie et de suivre ses goûts, qu’étant lui-même très amateur de chasse, il monterait à cheval avec elle.
Le jour du mariage surgit une difficulté. Le curé déclara qu’il ne pouvait marier deux personnes en costume d’homme. Force fut donc à la fiancée de passer une robe de femme par-dessus les habillements d’homme qu’elle ne voulut pas quitter.
Le mari tint parole; il laissa sa femme libre de faire ses volontés et, comme il était fort riche, elle put satisfaire tous ses goûts. Bien que les deux époux vécussent en bonne harmonie, le mari regrettant de n’avoir pas eu d’enfants vivants, il s’en suivit des querelles qui finirent par une séparation à l’amiable; le Baron s’en retourna à son château d’Oudezeele, où il ne tarda pas à mourir, en 1788, laissant à sa femme la jouissance de toute sa fortune.
L’équipage de chasse de la Baronne de Draëck comprenait un piqueux, un valet de chiens et plusieurs valets de limier. La meute pour le loup comprenait quarante chiens courants; elle entretenait de plus six chiens pour le lièvre, deux chiens d’arrêt et plusieurs terriers anglais pour les renards et les blaireaux.
Arrive la Révolution. On se contente de la mettre en arrestation chez elle avec un gardien à ses frais. Le commissaire de police, un arriviste, perquisitionne et enlève toutes les armes de chasse de la Baronne. Comme ce fonctionnaire tenait à la main son écharpe tricolore, elle lui dit: «Citoyen, vous pouvez mettre cela dans votre poche en toute sécurité, je n’ai pas envie de me révolter.»
La municipalité de Zutkerque intervient alors et voici un curieux document lui ayant trait:
«Un rapport du district de Saint-Omer établit en sa faveur que ladite Dame entretient à ses frais une meute de chiens courants et bœufliers pour la destruction des loups. (Le pied était alors payé cinq cents francs de prime lorsque sa grosseur dépassait la taille d’une patte de renard.) Qu’il est revenu au district que ladite Dame veut se défaire de sa meute, que cependant personne mieux qu’elle ne dirige les chasses, respectant les avétis et les dirigeant avec la plus grande autorité. Conséquemment, la municipalité de Zutkerque, sur la représentation des notables habitants de ladite paroisse et d’autres voisines, s’est transportée chez ladite Dame, pour la supplier à différer de se défaire des chiens qui lui restaient encore et à continuer de détruire lesdits loups. Fléchissant aux instances de la municipalité, le district demande à l’Assemblée Nationale de ne pas inquiéter la Dame de Draëck pour ses chasses, et si on ne la croit pas suffisamment autorisée à ces fins, bien vouloir obtenir un droit explicatif et augmentatif de celui rendu pour le fait de chasse en toute justice pour détruire les loups et les claquer si faire se peut.»
(Suivent les signatures des municipalités d’Eperlecques, Bayenghem, Zutkerque, etc.. )
Passionnée pour le courre du loup, elle en détruisit six cent quatre-vingts dans le Nord et l’Artois, surtout dans la forêt d’Eperlecques, où elle s’adonnait aussi au courre du cerf.
Lorsque l’époque était venue de commencer ses chasses, elle disait à son valet de limier:
«Allez à mon château d’Ablain-Saint-Nazaire, faites des reconnaissances partout, préparez les voies, et dans trois jours j’arriverai.» La veille de son départ, elle disait: «Vous partirez à onze heures de la nuit avec mes quarante chiens pour le loup, couplés deux par deux comme de coutume. Ne les laissez pas s’écarter. N’entrez nulle part pour prendre ce dont vous avez besoin plus loin que la porte.» A son palefrenier et à ses domestiques: «Vous partirez à trois heures du matin avec chacun vos chevaux et vous conduirez en main mes trois chevaux, sans vous arrêter nulle part.» Le cuisinier recevait l’ordre de rassembler quelques pièces de sa batterie de cuisine et de partir à six heures du matin dans le fourgon de bagages pour Saint-Omer, où il devra prendre la poste, afin de suivre la voiture de la Baronne. Le lendemain, Madame de Draëck rejoignait Saint-Omer avec sa voiture et ses chevaux, prenait des chevaux de poste et arrivait à son château d’Ablain-Saint-Nazaire presque en même temps que ses chiens, ses chevaux et tout son monde. Ce manoir a été le théâtre de ses exploits cynégétiques les plus remarquables; tous les jours étaient employés à prendre ou à tuer des loups, des renards et même des blaireaux.
L’auteur de cette notice nous apprend que plusieurs louveteaux, furent pris pendant un déplacement, dans les bois de Saint-Eloi, près d’Arras; le poil de ces animaux était argenté. les chiens ne les chassèrent pas avec autant d’ardeur que les autres loups; avec leur fourrure, elle fit faire un manchon qu’elle montrait comme une rareté. Ce fut la seule fois de sa vie qu’elle trouva des loups de cette espèce. Elle détruisit complètement les carnassiers dans le pays qui s’étend entre Arras et Douai, et ce fut à cette occasion que les bergers de la contrée lui présentèrent la chanson suivante, composée par l’un d’eux:
Paissez en paix, mes chers moutons.
Bêlez, bondissez sur l’herbette.
Le loup cruel dans ces cantons
Ne peut plus avoir de retraite.
Pour vous garder, il me suffit
De mes deux chiens, de ma houlette,
Nous jouirons pendant la nuit
D’une tranquillité parfaite.
Ecoutez-moi, gentil troupeau,
Pour prouver ma reconnaissance,
Je chante sur le chalumeau
L’auteur de notre délivrance.
Je veux vous apprendre son nom,
De Draëck est notre bienfaitrice,
Il faut que dans tous ces vallons
L’écho toujours en retentisse.
Dans nos bois, nous le graverons;
Partout nous le ferons connaître.
Les voyageurs l’apercevront
Ecrit sur l’écorce du hêtre.
Cet arbre nous sera sacré.
Réunis sous son vert feuillage,
Au bras qui nous a délivrés,
Nous rendrons un juste hommage.
Je voudrais qu’on en fît autant
Sur la surface de la France;
Chassons-en les buveurs de sang,
Détruisons cette infâme engeance.
Bons citoyens, unissons-nous,
Rendons leur espoir chimérique,
Purgeons, purgeons de tous ces loups
Le terrain de la République.
L’auteur de la notice rend ainsi compte d’une année de la vie de Madame de Draëck.
De l’arrondissement de Saint-Omer, Béthune et d’Arras, elle passait dans celui de Saint-Pol, près d’Hesdin, où elle séjournait beaucoup plus longtemps, car c’était le pays qui renfermait le plus grand nombre de ces animaux destructeurs.
Madame de Draëck attribuait la préférence des loups pour cette localité, non seulement à la quantité des bois et de forêts qui couvrent le pays, mais surtout et principalement aux troupeaux d’oies qui couvrent les marais de la Canche, de la Ternoise, de la Créquoise. Ces animaux sont très friands de ces volailles qui ne leur coûtent aucun combat ni danger pour s’en emparer. Je ne pourrais citer tous les bois nominativement où la destruction de ces animaux a été complète: un jour on revenait au logis avec deux loups, un autre jour avec quatre ou cinq; enfin, il était rare qu’un seul jour se passât sans que la chasse ne fût heureuse; alors, tout l’équipage, Madame de Draëck en tête, passait à travers la ville ou la commune la plus voisine en sonnant du cor de chasse, et toute la population accourait en foule voir les loups et aussi l’amazone qui était à la tête des chasseurs. C’est dans une circonstance semblable que le poste du corps de garde de Saint-Omer sortit au moment du passage de la nouvelle Diane chasseresse et lui rendit les honneurs militaires, alors qu’elle ramenait devant sa selle ses dépouilles opimes, soit quatre loups. Une autre fois, rentrant de déplacement après six semaines de chasse, Madame de Draëck retraversa Saint-Omer avec vingt et une têtes de loups sur l’impériale de sa voiture. Pendant que la poste était occupée au relais des chevaux, la place était pleine de curieux qui contemplaient les animaux féroces.
Arrivée chez elle, tout rentrait dans l’ordre pour une année, chacun se livrait à ses occupations ordinaires. La Dame de Draëck chassait le lièvre ou le petit gibier, ou travaillait à la menuiserie et à faire le galon au métier, ou encore à tresser le fil de fer pour faire des volières à ses oiseaux.
Le 3 novembre arrivé, jour de la Saint-Hubert, patron des chasseurs, la vie cynégétique reprend.
La veille au soir, tous les domestiques arrivent, rangés en haie, avec un énorme bouquet sur un plat, présenter à Madame de Draëck l’expression de leur respect et de leur attachement. Alors, on sonne les fanfares de vénerie, puis on fait venir un ménétrier et quelques jeunes personnes du voisinage.
Madame de Draëck, qui n’est fière que de ses hauts faits de chasse, ouvre le bal dans sa salle à manger avec le plus aimable de ses voisins; alors, tout le monde se met en branle, depuis le piqueux jusqu’au dernier valet de chiens. La soirée ne se prolonge guère, et on reçoit les ordres pour le lendemain. Faute de loups, on se contentait de renards; les garennes, bouchées par avance, forçaient l’animal à donner un joli courre, toujours couronné de succès.
Cette description de la vie, Madame de Draëck l’applique à toute son existence; elle est décédée au mois de janvier 1823, regrettée de tous ceux qui l’avaient connue et surtout du cultivateur.
Un chroniqueur du temps écrit ceci à propos de la célèbre Baronne:
«Il fallait la voir, la tête nue, l’épieu au poing, parcourir les coteaux, suivie de chasseurs à la mine sauvage et de chiens non moins rébarbatifs; les paysans, effrayés, faisaient la haie au cortège, et les jeunes filles n’écartaient qu’en tremblant les rideaux des fenêtres pour voir passer la «Diane de Brédenardre» avec ses sanglants trophées, dont au retour on clouait les têtes contre les portes du château.»
Ayant la passion de la destruction des loups, elle disait: «Si je pouvais être nommée louvetière de plusieurs départements, un seul loup ne paraîtrait plus dans les pays que j’aurais sous ma surveillance.».
Cette place de louvetière était sa marotte; elle en parlait souvent: elle en fit la demande au Prince de Neufchâtel, qui lui répondit qu’il ne pouvait pas lui accorder sa demande, qu’il était sans exemple qu’une femme eût eu cette place, mais qu’elle pouvait prendre un prête-nom chez elle, lequel serait nommé de suite.
Elle prit son parent, le Vicomte d’Artois, qui fut nommé louvetier du Pas-de-Calais, mais qui ne sut guère profiter des leçons de vénerie, puisque quatre mois n’étaient pas écoulés depuis la mort de la Baronne que la vente de l’équipage eut lieu.
A la requête de Messieurs d’Artois, demeurant à Ypres et à Cocove, ses héritiers dans la ligne paternelle, et de Monsieur Desmoncheaux, bourgmestre de Furnes, son héritier dans la ligne maternelle, on dispersa, le 1er avril 1823, à Zutkerque, les chevaux, chiens, voitures, faisans et presque tout le mobilier.
Respectant davantage les goûts de sa maîtresse, la fameuse Caroline, femme de chambre, puis premier piqueux, ne quitta jamais son costume d’homme. Une longue blouse bleue lui descendait jusqu’aux chevilles, laissant voir le bas des jambes du pantalon; elle portait les cheveux coupés court et coiffés d’une casquette. C’est dans cet attirail que jusqu’à sa mort, en 1855, on a pu la voir parcourant le pays, où elle vendait des balais de bouleau. Très bonne trompe, elle avait été envoyée à Boulogne par sa maîtresse pour donner des leçons de trompe, à la demande du Général commandant la place.
Cette figure originale, dont j’ai tenté de retracer l’existence, était-elle l’incarnation moderne de Diane, comme semblait le croire de Foudras en la faisant revivre sous les traits de la belle Diane de Brého?
Hélas! la vérité historique m’oblige à rapporter cette pointe sèche:
«Cette femme remarquable n’avait pas le caractère approprié à son sexe; elle n’en avait pas non plus la structure; d’une taille moyenne, sa figure, ordinaire pour un homme, était moins que belle pour une femme: avec une barbe d’adolescent, pas de gorge et un ventre proéminent, elle eût été ridicule sous un costume féminin.»
Lecteurs au cœur inflammable, cette présentation finale calmera vos regrets.