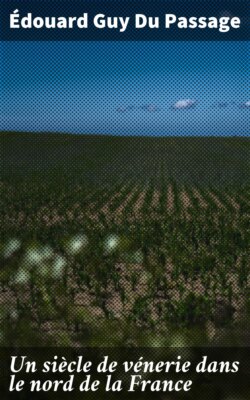Читать книгу Un siècle de vénerie dans le nord de la France - Édouard Guy Du Passage - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLe MARQUIS DE FERCOURT-CRÉQUY et son petit-fils le COMTE A. DU PASSAGE partant à la chasse du loup
Le Marquis de Fercourt-Créquy
Table des matières
FRANÇOIS-Hugues-Jules Perrot, Marquis de Fercourt-Créquy, a une jeunesse dramatique. Il a seize ans en août 1791, et, malgré son jeune âge, gagne l’armée de Condé et prend du service dans le régiment de Galiffet, puis aux hussards de Bercheny, au service de l’Autriche. Il passe ensuite dans les hussards de Choiseul-Praslin, à la solde de l’Angleterre, échappe au désastre de Quiberon et gagne alors sa vie comme cordonnier, après la dissolution de Portsmouth. Il rejoint bientôt l’armée de Condé et reste dans les dragons de Fargues jusqu’au licenciement, en juillet 1800.
Se hasardant alors à rentrer en France, il regagne sa terre de Frohen, mais il est encore suspect et se tient caché pendant près de dix-huit mois dans une ancienne carrière de la Vallée Latier, dans son bois. Son garde, Jean Roux, qui lui était resté fidèle durant toute la tourmente révolutionnaire, vient la nuit lui tenir compagnie. Il commence à se montrer lorsque survient la conspiration de Cadoudal. Arrêté et enfermé à l’Abbaye, il est exilé à Bar. Bonaparte, ayant reconnu son innocence, lui fit offrir le brevet de colonel; il le refusa et préféra être nommé capitaine de louveterie pour le Pas-de-Calais, tandis que Monsieur d’Artois, neveu de la Baronne de Draëck, était nommé lieutenant de l’arrondissement de Saint-Omer.
Après une jeunesse aussi aventureuse que celle dont on vient de lire le récit, il est aisé de comprendre que le digne gentilhomme n’aimait pas rester les pieds sur les chenets, et que c’est la passion de la chasse qui lui procura l’existence pleine d’imprévus à laquelle il s’était accoutumé.
Je retrouve un article de journal ayant trait aux premiers succès du veneur:
«La chasse aux loups a eu lieu les 14 et 15 vendémiaire, dans les bois de Willeman, près d’Hesdin. Le rendez-vous de chasse était chez Monsieur de Partz de Pressy. Monsieur de Fercourt, dont l’adresse pour la chasse surpasse encore le goût qu’elle lui inspire, se rendit avec une très belle meute de dix-huit chiens pour exterminer les redoutables ennemis des hommes et des animaux. Le vendredi, la chasse commença à huit heures du matin, et, à quatre heures du soir, quatre loups, dont deux mâles et deux femelles, avaient succombé sous le feu des chasseurs. Un cinquième fut poursuivi le lendemain; ne pouvant échapper à l’animosité des chiens, il fut se réfugier dans un terrier où il fut aisé de le prendre. Nous devons de la reconnaissance à Monsieur de Fercourt, qui fait si bien contourner ses plaisirs au profit de l’utilité publique, et nous croyons bien devoir l’avertir qu’on se plaint des dégâts que les loups commettent chaque jour, notamment dans les campagnes avoisinant Saint-Pol.»
Tout près de Willeman se trouvait alors la forêt de Saint-Georges, aujourd’hui absolument défrichée, mais qui, s’étendant de Wail aux portes d’Hesdin, servait de continuation au massif d’Hesdin et de Fressin pour communiquer par les bois de Caumont avec les forêts de Labroye, Dompierre et Torte-fontaine, doubles d’étendue de ce qu’elles sont aujourd’hui.
Aux abords de la forêt de Saint-Georges, au château du Quesnoy, habitait Monsieur de Vadicourt. Amis des jours malheureux, s’étant retrouvés à Londres, l’un ressemelant des bottines, l’autre donnant des leçons de dessin, sa femme confectionnant des chapeaux, ils restèrent toute leur existence liés par une grande affection. Les déplacements en forêt de Saint-Georges étaient couronnés de succès, et les habitants du Quesnoy ont gardé le souvenir de cinq loups rapportés le soir sur la petite place, où la vieille gentilhommière et l’église voisinent à se toucher.
Outre Monsieur de Vadicourt, Messieurs de la Houssoye et des Gaules étaient ses camarades de chasse accoutumés.
Habitant le petit château d’Occoches, Monsieur de la Houssoye avait quelque accointance avec la Normandie, et fit venir plusieurs lices de ce pays. Il en tira race avec les Artésiens de mon arrière-grand-père, pour qui il élevait, chaque année, plusieurs élèves, et c’est, me semble-t-il, le point de départ de la transformation de l’ancien chien d’Artois.
Malgré que Monsieur de la Houssoye ne fit pas de folles dépenses, sa passion pour la chasse finit par lui rogner le peu de fortune qu’il avait retrouvé après la Révolution, et il fut finir ses jours chez son ami des Caules, à Neuilly-l’Hôpital. Renonçant, dès lors, à sa passion, il continua à garder quelques chiens et à en élever, jusqu’à sa mort, avec un soin jaloux. Un vieux piqueux du prince de Condé, nommé Isaïe, les conduisait et rendait compte au retour à son maître de la manière dont ils s’étaient comportés. Les rapports d’Isaïe occupaient ainsi les soirées du vieux chasseur cloué sur sa chaise. Monsieur de Nampsaumont fut un autre fidèle compagnon de chasse du Marquis de Fercourt. En souvenir des chasses qu’ils avaient faites ensemble, ce dernier eut une idée touchante. Monsieur de Nampsaumont, apprenant qu’à la suite d’un procès qui était latent depuis plusieurs années, la fille du Marquis de Fercourt pourrait se trouver sans fortune, il s’offrit à lui laisser ses biens après sa mort,. L’offre fut déclinée, mais la pensée n’en était pas moins généreuse. Célibataire, toujours en affaire de chiens avec mon aïeul, ce Monsieur de Nampsaumont avait le langage imagé et le geste un peu leste. C’est lui qui, placé à table, à Sainte-Segrée, auprès de la chanoinesse de Valanglart, qu’il n’avait plus vue depuis longtemps, lui disait, en passant cavalièrement la main sur son ruban bleu du Chapitre de Bavière (la brave dame avait le duvet fourni): «Pour une petite griffonne, vous êtes bien conservée.»
Tout était sacrifié au plaisir de la chasse chez mon arrière-grand-père. Malgré son peu de fortune, il entretenait toujours une vingtaine de chiens en chasse et possédait, comme piqueux monté, un bossu nommé Dodor La Bosse, très fin valet de limier et excellente trompe. Faisant de continuels déplacements, il laissait sa femme et ses filles dans un confort des plus médiocres, et ma grand-mère répétait qu’en sa jeunesse, c’est dans une voiture à âne qu’elle gagnait la diligence pour se rendre à Saint-Omer, où il y avait quelques réceptions mondaines. Jusqu’à la chute de l’Empire, la plupart des chevaux qui servaient de remonte étaient des épaves des armées.
Au retour du Roi Louis XVIII, le Marquis de Fercourt retrouve son ardeur de vingt ans. Il entre comme capitaine aux Volontaires Royaux, sous le prince de Solre, et se fait casser le bras à la porte Saint-Pierre, à Amiens. Ce fut son dernier fait d’armes.
L’anecdote suivante démontre surabondamment que Fercourt se pliait peu aux exigences des gouvernements nouveaux.
Un bateau étant venu s’échouer en baie de Saint-Valéry, de Fercourt, des Caules et de Cacheleu avaient été voir les épaves, et rapportaient sur eux chacun un flacon de kirsch. Les gabelous, à leur retour à Abbeville, réclament des droits d’entrée.
Outrés, les trois amis reculent, tiennent conseil, puis vident chacun leur fiasque, repassent la barrière en laissant les cadavres aux agents de l’autorité.
Pendant le séjour des alliés, il remonta sa cavalerie, et ma grand’mère, qui l’accompagnait dans ses chasses autour de Frohen, montait, paraît-il, un genêt d’Espagne, au grand étonnement des populations.
J’ai pu recueillir, de la bouche même de son dernier valet de chiens, Maugé, quelques récits de certains laisser-courre.
Un loup, attaqué dans les bois environnants Martainneville, vers huit heures du matin, part en débuché vers la vallée de Somme qu’il traverse, pour revenir ensuite vers son lancer, et est tué à la nuit, entouré par la meute.
Dans ces mêmes parages, une louve, suitée de quatre louveteaux, fait tête devant la meute pour défendre sa portée, et toute la famille est tuée devant les chiens.
Deux louvarts sont pris vivants par Dodor, aux entours d’Oisemont, alors qu’ils sont aux prises avec les Artésiens.
Ayant épousé Mademoiselle de Cacheleu, dont l’une des sœurs était devenue la Baronne de France de Maintenay, il allait en déplacement chez eux, et j’ai connaissance de deux sangliers, pris le même jour dans les bois de la Cervelle. Un premier animal tué par les chasseurs du pays, dont on s’était assuré le concours; le second poursuivi par la meute, débuchant des bois de Saint-Josse et allant se faire prendre dans les dunes en bordure de la mer.
Quand le marquis de Fercourt n’avait pas connaissance de grands animaux, il se rabattait sur la chasse du lièvre autour de Frohen, mais, même à cette chasse, ses chiens n’ayant pas grand train, il aidait l’hallali par un coup de fusil.
Le dernier louvart pris par lui dans le pays fut attaqué dans le bois de la Mare-à-l’Eau, et s’en vint se faire prendre à la gueule d’un terrier dans les bois de Barly.
De 1815 à 1825, Messieurs Frénelay, le Boucher de Richemont, de la Houssoye, des Caules, de Nampsaumont, Alexandre, Merlen et le général Filon, se donnaient rendez-vous avec lui en forêt de Crécy, où les sangliers abondaient. On se souvient d’un vieux solitaire, qui fit plusieurs fois le tour de la forêt, et que Monsieur Alexandre Merlen tua aux abois devant les chiens, dans les fonds de Marcheville.
Les grandes randonnées n’étant point pour l’effrayer; vers 1830, il joignait ses chiens à ceux du Comte d’Hinnisdal, dont il fut le compagnon fidèle, souvent le commensal, avant qu’il ne devint le témoin de son mariage avec Mademoiselle de Bryas.
Toute sa vie durant, le Marquis de Fercourt continua de chasser, jusqu’en 1845, époque de sa mort.
Il ne quittait guère sa tenue de louvetier, et c’est habillé de la petite veste verte qu’il se rendait dans les soirées mondaines d’Abbeville.
Mon père, dans ses souvenirs d’enfance, rapporte sa première chasse à courre dans les bois de Mézerolles, où son grand-père, pour l’aider à sortir d’un roncier, avait caressé du même coup de fouet, et les fesses du baudet et les mollets du gamin. Le visage encadré dans une barbe blanche si fournie qu’il la nattait et la plaçait sous sa cravate, il portait avec élégance sa tenue, la culotte blanche et les grandes bottes de vénerie, et avait très grand air monté sur une grande jument alezane à balzanes haut-chaussées.
Aussitôt après sa mort, mon grand-père liquida la meute; une partie fut achetée par Monsieur de Tricornot; les autres garnirent les chenils de Flour, à Sainte-Marguerite, et de Mallart, à Ransart. Le chenil de Frohen devait rester vide durant deux générations.
La cuisine familiale était garnie jadis de pieds de loups et de traces de sangliers. Tous ces trophées ont peu à peu disparu. Seuls, la trompe et le couteau sont demeurés: j’eus la joie de sonner l’hallali par terre et servir une laie ragotte avec la trompe et la dague de l’aïeul. Ma grand’ mère, âgée de quatre-vingt-seize ans, vivait ses dernières journées, et le petit-fils, en lui présentant la trace, put réveiller les souvenirs lointains de l’aïeule.