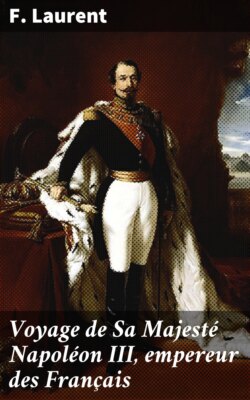Читать книгу Voyage de Sa Majesté Napoléon III, empereur des Français - F. Carrel Laurent - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DÉPART DE NANCY. — ROUTE DE NANCY A STRASBOURG.
ОглавлениеTable des matières
Nancy, le 18 juillet.
Nancy est l’ancienne capitale de la Lorraine. Elle fut assiégée en 1477 par Charles le Téméraire, qui y perdit la vie. La tradition rapporte qu’il fut tué dans les étangs de Saint-Jean, qui se trouvaient sous les murs de la ville. C’est sur ces étangs mêmes qu’a été élevée la gare du chemin de fer. Quels changements, quelles vicissitudes! Quelles réflexions fait naître dans l’esprit ce rapprochement entre la vieille et la nouvelle France! Il y a moins de quatre cents ans, la France était morcelée, divisée en provinces inconnues les unes aux autres, et qui ne se rapprochaient que pour se combattre. Elle épuisait ses forces les plus vives en luttes stériles, et chaque localité conserve la tradition d’un de ces combats où elle versa elle-même le sang de ses enfants.
Aujourd’hui toutes les provinces, unies par des sentiments communs, protégées par les mêmes lois, ne forment plus qu’un corps; et voilà qu’un chemin de fer, ce suprême symbole de l’union des populations entre elles, vient d’établir sa gare sur ces marais mêmes où Charles le Téméraire trouva la mort. Ne semble-t-il pas que c’est l’instrument le plus énergique de la paix qui vient abolir jusqu’à la physionomie des lieux qui furent jadis le théâtre de nos guerres?
Dans quelques instants, le Prince Impérial va partir de cette gare qui rappelle de tels souvenirs. Cette nuit, comme je vous le disais, a toute été donnée aux fêtes. Les premières lueurs du matin ont éclairé le retour des invités qui sortaient du bal de l’hôtel de ville. Les illuminations ne se sont éteintes qu’aux premiers rayons du soleil, et voici que déjà l’heure du départ va sonner.
Dès six heures du matin, les tambours battent le rappel, et toutes les troupes sont massées sur la place Stanislas. Une pluie bienfaisante avait tempéré dans la nuit la chaleur brûlante de la veille. Les fenêtres des maisons sont couvertes de charmantes toilettes du matin, et la foule se presse dans les rues.
A sept heures précises, Louis-Napoléon sort de l’hôtel de la préfecture et passe devant le front des troupes de la garnison rangées en bataille, et des pompiers qui ont fait le service d’honneur pendant le séjour de S. A. Impériale.
Pendant cette courte revue, les cris de: Vive l’Empereur! retentissent et se mêlent à ceux de: Vive le Président! Vive Napoléon!
Dans les rues que devait parcourir le Prince était accourue la population tout entière. S. A. Impériale, entourée d’un brillant cortége d’hommes d’État, de généraux et d’officiers supérieurs, se rend à la gare, au milieu d’acclamations qui ne cessent de retentir. A son entrée dans le salon de l’embarcadère provisoire, où éclatent les vives couleurs des tentures, des écussons, des drapeaux et des fleurs qui le décorent, la musique militaire mêle ses accents sonores aux cris de la population.
Le train présidentiel est composé comme il l’était hier. Plusieurs étrangers de distinction y ont été admis. Nous avons remarqué entre autres M. le lieutenant général comte de Hirschfeld, gouverneur des provinces rhénanes prussiennes; son fils, son aide de camp; un colonel du 35e de ligne de Prusse, un capitaine du 36e, officiers d’ordonnance du général, et le baron Saulet, accompagné de plusieurs aides de camp.
Au moment où le train quitte la gare, cent un coups de canon annoncent le départ de S. A. Impériale, et s’unissent aux volées, des cloches de toutes les églises. Le convoi est déjà loin, que l’on entend encore, à travers les sifflements de la locomotive, les cris de: Vive Napoléon! vive l’Empereur! qui s’élèvent du sein de la foule. On dévore l’espace, et tout le long du chemin de fer on aperçoit des masses de villageois dont l’affluence et l’enthousiasme sont tels, que plus d’une fois les barrières du chemin de fer ont été rompues. Heureusement aucun accident n’est venu troubler ces manifestations, qui expriment à un si haut degré les sentiments des populations.
Je voudrais décrire les belles campagnes que l’on parcourt, mais le convoi vole, et c’est à peine si nous pouvons les entrevoir.
Comme je vous l’ai dit hier, le chemin de fer et le canal de la Marne au Rhin se séparent près de Nancy pour passer, l’un, par les faubourgs Saint-Stanislas et Saint-Jean; l’autre, par le faubourg Saint-Georges, situé de l’autre côté de la ville. Ils se rejoignent à quelque distance de la ville, et traversent ensemble la Meurthe sur un ouvrage commun de dix-neuf mètres de largeur. Ce pont qui supporte à la fois un chemin de fer et un aqueduc, a sept arches de treize mètres d’ouverture chacune. Pour éviter que les vibrations occasionnées par le passage des convois ne se communiquent à la cuvette du canal, et n’y occasionnent à la longue des fissures et des pertes d’eau, on a ménagé, entre ses maçonneries et celles qui supportent le balast du chemin de fer, une raînure qui se prolonge dans toute l’étendue des constructions jusqu’au-dessus des piles.
Jusqu’à Varangeville, le canal et le chemin de fer marchent parallèlement, pour se séparer à ce point et se retrouver plus tard. A Varangeville, les populations avaient élevé un arc de triomphe de feuillages et de fleurs, surmonté de cette inscription:
A Louis-Napoléon Bonaparte, sauveur de la France.
Les acclamations de Varangeville s’éteignaient à peine, que nous apercevions les clochers élégants d’une belle église gothique, qui s’élève à Saint-Nicolas. Tout autour sont de nombreuses filatures et de vastes carrières de plâtre. Saint-Nicolas possède un asile pour lesaliénés, qui a une grande importance.
Un peu plus loin, le canal et le chemin de fer se retrouvent et franchissent de nouveau la Meurthe sur un pont de cinq arches de quatorze mètres d’ouverture chacune; puis le chemin suit la vallée de la Meurthe jusqu’à Lunéville.
Dans toutes les communes, des arcs de triomphe sont élevés et les populations accourent. C’est un enthousiasme général.
Un arc de triomphe portant: La commune de Rosières à Louis-Napoléon, nous indique que nous sommes à la station de ce nom, renommée par son haras, fondé en 1703.
A Blainville, l’empressement est le même, la voie est ornée de fleurs et de couronnes de chêne. On aperçoit un pont. construit dans le système américain, pour mettre en communication avec le chemin de fer les localités situées sur la rive gauche de la Meurthe.
On approchait de Lunéville lorsqu’un orage violent a éclaté. Les longs roulements du tonnerre se confondent avec les volées des canons de l’artillerie, qui saluent l’approche du chef de l’État. La pluie tombe à flots et vient jeter le désordre dans les préparatifs qui avaient été faits pour la réception.
Malgré ce contre-temps, le sous-préfet, le maire et tous les fonctionnaires étaient réunis le long de la voie. De jeunes personnes, vêtues de blanc, et qui devaient offrir au Prince Impérial des corbeilles de fleurs, avaient affronté avec courage les insultes de la tempête. Le temps était trop affreux pour que Louis-Napoléon pût mettre pied à terre et prolonger une situation pénible. Le convoi s’est à peine arrêté. A peine, à travers les flots d’une pluie battante, nous avons pu apercevoir au loin le beau château qui a appartenu au maréchal prince de Hohenlohe, et les clochers de l’église où l’illustre amie de Voltaire, la marquise du Châtelet, a son tombeau.
On sait que c’est à Lunéville que fut signé, en 1801, le traité de paix de la France avec l’Autriche.
On arrive à la station d’Avricourt, et la pluie ne cesse de tomber. M. Solard, sous-préfet de Phalsbourg, le maire et le conseil municipal d’Avricourt et une foule nombreuse attendaient le convoi Impérial, qui n’a pu s’arrêter que deux minutes. Pendant ce moment d’arrêt, le Prince s’entretient avec le sous-préfet et l’invite à prendre place dans le train. Des dames qui ont bravé le mauvais temps s’approchent du wagon Impérial et y jettent des fleurs.
Le chemin de fer suit la vallée et traverse la Pérouze sur un pont de trois arches de neuf mètres d’ouverture chacune Il franchit ensuite le col qui sépare les eaux du Samon de celles de la Sarre. Rien de plus pittoresque et de plus curieux que ce parcours. Le chemin de fer et le canal semblent s’entrelacer à plaisir. Ils se suivent, ils se fuient, ils se cherchent, ils s’éloignent, ils se rapprochent, ils se traversent, tantôt le chemin de fer sous le canal, tantôt le canal sous le chemin de fer. C’est une véritable lutte engagée entre ces voies puissantes de communication. Autour, l’aspect de la campagne est merveilleux: à droite, les Vosges; à gauche, un immense rocher à pic que dominent des débris de tourelles en ruine; puis toujours le canal et la rivière qui se joue dans mille sinuosités.
A Sarrebourg est établi un magnifique arc de triomphe sous lequel le convoi s’arrête un instant. On est au pied des Vosges, dans un site pittoresque. Une foule d’hommes, de femmes, de vieillards, d’enfants, sont rangés en amphithéâtre sur le versant de la montagne. Des décharges de mousqueterie et des détonations de boîtes de campagne saluent la présence de Louis-Napoléon. Toutes les chaumières, disséminées dans les gorges des montagnes, sont décorées d’inscriptions en l’honneur de S. A. Impériale.
De Sarrebourg, le convoi ne met que quelques minutes pour atteindre Hommarting. C’est à ce point que la voie de fer se trouvait en face de grandes difficultés. Elle avait à franchir la chaîne des Vosges.
Des montagnes élevées, épaisses, escarpées, semblaient opposer une barrière infranchissable. C’est ici qu’éclate le génie moderne.
Il y a quelques années le passage des Vosges était un passage pénible et presque dangereux. Il fallait du temps, des efforts, et on ne passait pas toujours. Les ponts et chaussées firent construire dans la montagne de Saverne une roule qui ouvrait une communication plus aisée entre le département du Bas-Rhin et le reste de la France. Cette route, qui s’élevait en spirale insensible jusqu’au sommet de la montagne et qui rendait l’ascension plus facile, devint l’objet de l’admiration générale.
On considéra cette œuvre hardie comme un des efforts les plus étonnants de l’industrie humaine. Elle excita une vive curiosité. On ne parlait que de la chaussée de Saverne. Elle donna son nom à une mode du temps: des perles arrangées en formes de spirale, comme la chaussée, se plaçaient dans les cheveux des dames, et cette coiffure prit le nom de coiffure à la Saverne.
Aujourd’hui, et pour jamais, la merveilleuse chaussée est délaissée. Le chemin de fer s’enfonce brutalement dans la montagne, et passe sous les pics et sous les abîmes par un souterrain de deux mille six cent quatre-vingt-sept mètres de longueur, le plus important de la ligne. Du côté de la Lorraine, il est placé à gauche et au même niveau que le souterrain du canal; mais le chemin de fer, au lieu de rester de niveau, plonge sous la montagne avec une pente de cent millimètres par mètre, en passant au-dessous du canal, de sorte que du côté de l’Alsace il paraît à droite du canal et à douze mètres en contre-bas.
Une série de cinq autres tunnels de moindre importance: celui de Hoffmalt, de deux cent quarante-cinq mètres, au point où le chemin de fer débouche dans la vallée de la Zorn; celui de Lutzelbourg, de quatre cent trente-deux mètres, au-dessus duquel s’aperçoivent les ruines d’un ancien château, puis trois autres ouvrent à travers la chaîne des montagnes une voie que l’on franchit en quelques minutes. C’est à peine si on a le temps de réfléchir, en passant sous ces voûtes humides, à ce progrès de l’industrie qui, en si peu d’années, a permis d’accomplir ce travail de géant. Déjà le canal du Rhin avait pris les mêmes voies souterraines. Mais rarement l’on s’engageait dans ce passage encore lent et laborieux. A l’heure où nous écrivons, les Vosges n’existent plus pour les voyageurs qui se rendent de Paris à Strasbourg.
Nous regrettons presque, cependant, l’ascension de cette chaussée pittoresque de la montagne de Saverne. La diligence montait lentement, les chevaux suaient et soufflaient. On descendait un instant et l’on marchait. On trouvait la côte longue, mais au sommet on était dédommagé par un magnifique spectacle. On voyait tout d’un coup se dérouler à ses pieds la vaste étendue de l’Alsace. Des collines, des vignes, des champs, des prés, des bois, des bourgs, des villages et des villes, répandus çà et là, formaient un immense et merveilleux tableau. Au loin, roulait majestueusement le Rhin, baignant de ses eaux transparentes les rives de l’Allemagne, toutes couvertes de rochers et de forêts qui laissaient entrevoir, à travers des masses de verdure, les hautes tours de leurs vieux châteaux.
Le chemin que nous parcourons présente un autre spectacle, plus rapide, plus restreint, mais non moins imposant. Rien de plus sauvage et de plus pittoresque que la contrée où se trouvent accumulés tant de travaux d’art. Le dernier souterrain présente à son entrée l’aspect d’une forteresse féodale. En en sortant, on traverse le canal et la Zorn sur un viaduc plein de hardiesse, et l’on s’engage dans une tranchée taillée à pic dans le roc et qui rappelle les formes d’un château fort par les machicoulis qu’on a ménagés dans le haut. Au-dessus du souterrain de quatre cent trente-deux mètres, on voit les ruines du château de Lutzelbourg, et, avant d’arriver à Saverne, on passe sous les châteaux du moyen âge de Haut-Barr et de Géroldseck, perchés sur le sommet des montagnes.
Lutzelbourg, situé au fond de la vallée de la Zorn, est un lieu de promenade pour les habitants et la garnison de Phalsbourg. On y vient de Strasbourg les dimanches par des trains de plaisir.
A peu de distance au delà, on arrive sur le territoire du Bas-Rhin, où se succèdent trois autres souterrains ayant trois cent quatre-vingt-quinze mètres et trois cent huit mètres de longueur.
A Saverne, une foule immense attendait S. A. Impériale, qui s’y est arrêtée quelques instants. M. West, préfet du Bas-Rhin, s’y trouvait avec des membres du conseil général et un nombreux cortége d’autorités. La réception a été enthousiaste. Les cris de: Vive l’Empereur! se sont fait entendre avec chaleur.
De la station, on aperçoit à droite le château du cardinal de Rohan. Cette vaste construction, qui n’était pas achevée quand survint la révolution de 1789, est restée dans le même état et n’avait jamais pu recevoir de destination utile. Mais la haute sollicitude de l’héritier de l’empereur Napoléon Ier vient de l’affecter à un asile pour les veuves et les orphelins des serviteurs du pays. Des travaux importants y sont entrepris en ce moment.
A Monswilleer, à droite du chemin de fer, est une chapelle protestante, fondée par M. Goldenberg, directeur de l’usine de Zornhof, où se fabrique la quincaillerie.
En quittant Saverne, on reste dans la vallée de la Zorn jusqu’à Brumath.
Après quelques minutes d’arrêt à Wilwisheim, Hochfelden, Brumath et Vendenheim, où sont groupés les autorités et les habitants de chacune de ces communes, à midi trois quarts on approche du débarcadère, place immense où viennent aboutir les trois lignes de Bâle, de Wissembourg et de Paris.