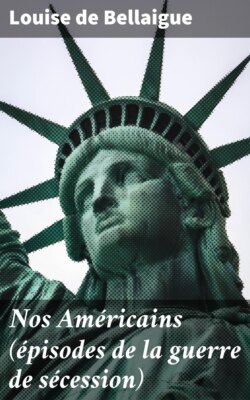Читать книгу Nos Américains (épisodes de la guerre de sécession) - Louise de Bellaigue - Страница 7
ОглавлениеV
La douleur voila de ses deuils et ensevelit dans le silence le chalet de Montmorency.
Quatre ans après la lugubre journée d’automne où Mme de la Jarnage était morte, la tristesse s’en prolongeait encore sur cet intérieur. Sa fragile existence n’en était-elle pas l’âme?
Le lendemain du fatal jour, Madeleine avait fermé son piano. Depuis bien peu de temps, et seulement sur les instances de Georges, elle commençait à le rouvrir quelquefois. Pour égayer les longues heures de solitude de la chère malade, la jeune fille avait étudié la musique avec une rare persévérance, et maintenant que sa mère n’était plus sur le grand fauteuil, tout près d’elle, dirigeant et goûtant tout ensemble les moindres inflexions de son jeu, cette délicieuse distraction était devenue pour elle une torture, un réveil cruel du passé. Le chant, même ces mélodies qui semblent apporter à nos souffrances de si calmantes douceurs, lui brisaient l’âme. Avec sa nature ardente et impressionnable, Madeleine éprouvait aux vibrations musicales une commotion nerveuse, les larmes gagnaient ses yeux, et si cette détente la soulageait un instant, elle en avait pour plusieurs heures à dominer ensuite l’affaissement moral de tout son être. Il lui fallait de violents efforts pour remonter le chemin de sa tristesse. D’ailleurs, elle craignait toujours que la vue de ses larmes ne troublât Georges et l’oncle Charles. Les qualités du cœur étaient développées chez elle d’une façon captivante. Tendre pour les siens, accessible à tous, elle se faisait aimer de ceux qui l’approchaient, et le malheureux qui prenait la route du chalet en revenait toujours secouru et consolé. Elle s’épanouissait au sein de cette maison dépeuplée par la mort, et y ramenait parfois encore la joie et l’espérance. Il y avait dans son âme comme un trésor longuement amassé de tendresse, de dévouement et d’amour, qu’elle déversait sur les êtres chers qui l’entouraient et qui ne vivaient que par elle.
Après les mille soins de détails absorbants qui incombent à la maîtresse de maison anxieuse d’en remplir les obligations, Madeleine donnait tout son temps à l’étude de la peinture. Ce travail calme, et qui lui permettait de développer de mille manières ses goûts d’artiste, l’avait séduite. Elle s’y livrait avec d’autant plus de suite et de plaisir qu’elle avait trouvé à sa portée un excellent professeur, pour lequel instruire Madeleine dans son art était un bonheur. Ce professeur n’était autre que l’oncle Charles. Doué d’un talent naturel et non sans originalité, M. de Pilter avait profité de ses longs et fréquents séjours en France pour se familiariser avec le génie de nos meilleurs maîtres, et aidé sans doute par cette opiniâtreté d’un travail que nul bruit ne pouvait distraire, il avait rapporté d’une longue contemplation du beau dans nos musées une réelle inspiration. Mais s’il éprouva jamais de douces fiertés d’artiste, ce fut bien moins en considérant les quelques portraits et paysages dont il avait orné Summer-Cottage et le chalet de Montmorency, qu’en voyant Madeleine atteindre sous sa direction à un très gracieux succès, et en pensant surtout aux adoucissements à sa douleur que la chère enfant trouverait dans cette récréation.
Ce goût de la peinture, commun à l’oncle et à la nièce, ajoutait un charme de plus à leurs rapports de tous les instants. Il donnait un but aux promenades de la belle saison et en multipliait les agréments. C’étaient de beaux jours que ceux où, partis de grand matin, ils allaient au loin, emportant le frugal repas de midi, esquisser une ferme ou les ruines de quelque vieux château.
Georges accompagnait quelquefois les artistes; mais s’il emportait ses crayons, c’était pour travailler à quelque question de droit, dont le recueillement de la campagne et le silence des bois facilitaient la solution. Il poursuivait, en effet, avec ardeur ses études de droit; il avait suivi les cours de la licence et ne reculait point devant les épreuves du doctorat. Sa vive intelligence et son zèle pour cette science ardue, complexe et délicate, ne tardèrent pas à le désigner à l’intérêt des plus éminents professeurs de l’École de Paris.
Comment n’eussent-ils pas pris garde à ce jeune étranger, jaloux de posséder, pour en reporter la lumière à son pays, les secrets de nos législations? Quelques-uns d’entre eux se souvenaient aussi d’avoir vu le grand-père de Georges, M. de Pilter, venir écouter leurs leçons, alors que, trop âgé pour être leur élève, il était fier d’être au moins leur auditeur. Georges de la Jarnage avait donc aisément conquis leurs sympathies, en même temps que ses succès lui avaient valu leurs éloges. Quand, frappé dans sa plus chère affection, il chercha courageusement dans là reprise de ses études le seul adoucissement possible à son mal, il reçut de ces mêmes hommes des témoignages touchants, et, plus tard, quand la première vivacité de sa douleur fut apaisée, quand il accepta quelques distractions, leur porte hospitalière s’ouvrit au jeune Américain. La sérénité de sa nature et le souvenir de son malheur l’avaient prédisposé à jouir de leur intimité un peu grave. Il arriva donc bien souvent que Georges ne prit pas seulement le chemin de l’École de de droit pour l’heure des cours, mais pour y retrouver, près du foyer et dans l’abandon de la famille, le professeur devenu un ami.
C’est là que, guidé par les sages réflexions de l’expérience, il apprenait à apprécier la France.
Il entendait aussi juger les hommes et les faits politiques.
L’écho de ces salons de l’École de droit qu’il reportait au chalet de Montmorency, était presque le seul bruit de l’extérieur qui y parvînt. L’étude et la tendresse mutuelle y étendaient leurs douces influences et, sous l’œil de Dieu, remplissaient la vie.
Dieu permit qu’elle s’adoucît pour les orphelins. Le temps, le travail et la prière leur versaient leurs baumes, et parfois les éclats de gaieté d’autrefois retentissaient encore dans le chalet.
Un soir d’hiver, Georges et Madeleine devisaient dans le salon sur le moyen de fêter de leur mieux l’anniversaire de la fête de Flavia qui approchait. L’oncle, que l’on consultait à l’aide d’une tablette, écrivit sur l’ardoise:
«–Très chère, faites-lui son portrait.»
Des gestes exclamatifs et joyeux indiquèrent à l’oncle à quel point l’idée était goûtée des deux jeunes gens.
Dès le lendemain, Madeleine esquissa les traits de sa nourrice. Quelle joie à mesure qu’elle atteignait la ressemblance! L’oncle et Georges, qui l’entouraient, tantôt approuvaient, tantôt critiquaient, riaient et applaudissaient aux coups de pinceaux qui rendaient d’une façon expressive la bonne vieille figure de leur servante.
Le fameux jour arriva. Le portrait, encadré dans une large baguette d’or à facettes. fut placé au milieu de l’atelier, sur le chevalet. La négresse y était splendide. Ses cheveux noirs jaillissaient en bandeaux abondants et crépus de dessous un madras à raies rouges et jaunes, dont les bouts étaient arrangés avec toute la symétrie que Flavia mettait à se coiffer dans les grands jours. Ses bons yeux noirs étincelaient de vie. Le nez était large et épaté. Le plus beau de ses sourires s’épanouissaient sur ses grosses lèvres et faisait apparaître deux rangées d’admirables dents blanches. Une collerette de mousseline encadrait son cou et faisait ressortir le noir luisant de cette étrange figure, dont un nœud de cravate rouge cerise parachevait le grotesque ornement. Une robe de soie noire, à l’européenne, produisait un phénoménal effet sur la taille volumineuse de Flavia.
Ses gros bras aux minces attaches, qui distinguent les femmes de sa race, s’étalaient gauchement, tandis que sa main grasse et petite serrait avec amour un portrait en médaillon de Mme de la Jarnage.
Les enfants placèrent un pot de fleurs de chaque côté du chevalet, et le moment vint de chercher Flavia.
Quand elle arriva, Georges ouvrit la porte de l’atelier à deux battants. En apercevant son portrait, les bras lui tombèrent, elle resta les yeux fixes et la bouche béante. Après le premier moment de surprise, frappée de la ressemblance, la pauvre créature cacha sa tête dans ses mains et s’écria:
–Oh! moi laide, mon Dieu! moi laide, mais moi contente, car c’est moi.
Puis, relevant la tête, dans un élan d’affection et de reconnaissance, elle prit la main de M. de Pilter qu’elle baisa, et attirant Madeleine et Georges, elle les embrassa.
–Comme êtes bons, pour Flavia, monsieur de Pilter…, enfants. vous pensez fête à moi. vous fêtez si joli.
Et s’approchant du portrait:
–Oh! Flavia contente, bien contente. Flavia a portrait maîtresse…
Et elle colla ses grosses lèvres sur le petit médaillon.
Mais Flavia n’était pas au bout des surprises. Il lui fallut, pour rendre plus complète la ressemblance du portrait, aller revêtir une robe de soie noire, donnée par l’oncle Charles, et le beau madras de l’Inde, la collerette et le ruban cerise qui figuraient également sur la toile et qui était un don de Georges. Ainsi parée, elle fut obligée, vu la circonstance, de prendre place à table et de figurer le soir au salon. Madeleine, toujours en son honneur, se mit au piano, et, après quelques préludes insignifiants, tout à coup, elle joua et chanta une berceuse américaine, avec laquelle la vieille neineine endormait les enfants dans leur jeune âge. L’instrument palpitait sous les doigts de la jeune fille. La négresse n’y tint plus et sa voix sonore, qu’elle cherchait en vain à adducir, finit par accompagner, puis par dépasser la voix fraîche et argentine de Madeleine. Bien plus, entraînée par ce chant, elle prit un coussin du sofa, et, arpentant le salon, elle le berçait dans ses bras tout comme jadis elle berçait les enfants. Des pleurs coulaient de ses yeux; sa voix, qui devint chevrotante, témoigna de son attendrissement; et quand Madeleine s’arrêta, Flavia, qui n’avait de longtemps fait semblable exercice tomba épuisée sur une chaise, vaincue par la fatigue et l’émotion.
Georges, sa sœur et l’oncle, furent fort impressionnés par cette petite scène. Elle aurait pu leur apprendre, s’ils ne l’eussent su déjà, combien le souvenir du passé était toujours présent et vif pour la négresse.
Quand elle revint à elle, tournant ses bons yeux vers ses maîtres:
–Oh! pardon, Flavia avait cru maîtresse encore là, chanter avec Flavia, pour dormir les petits.–Et, cette fois, elle sanglota tout à fait.
Cette journée, qui ne fut pas exempte de retours cruels, jeta cependant quelques reflets de joie sur cet intérieur paisible, où s’aimer et se le prouver était l’objet de toutes les pensées.