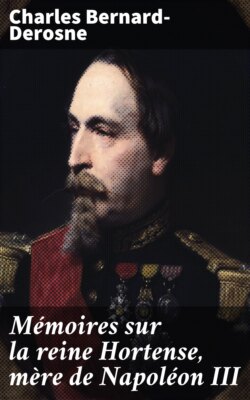Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 10
ОглавлениеLE GÉNÉRAL BONAPARTE.
Pendant que Joséphine, après plusieurs années dé misères et de privations, jouissait de jours sans nuages, la France était encore agitée de temps à autre par quelques rafales de l’orage qui l’avait bouleversée, et le pays n’avait pas encore retrouvé une parfaite tranquillité. Les clubs, ces serres chaudes de la Révolution, exerçaient encore une influence pernicieuse sur les habitants de Paris, et excitaient continuellement les masses à la révolte.
Mais alors sortit de la foule l’homme qui devait écraser ces masses sous son talon de fer, et réduire au silence tous les orateurs des clubs avec un éclair de ses yeux. Cet homme était Napoléon Bonaparte.
Il avait à peine vingt-neuf ans, et déjà la France tout entière parlait de lui comme d’un héros couronné de lauriers qui avait laissé derrière lui une trace de brillantes victoires. Comme chef de bataillon il s’était distingué par sa bravoure à la prise de Toulon, et après sa promotion au grade de général il avait été envoyé en Italie. Quand il rentra vainqueur en France, le Gouvernement, hostile à ce général de vingt-cinq ans, et peut-être effrayé de son génie, voulut l’envoyer comme général en chef à l’armée de Vendée. Bonaparte refusa parce qu’il voulait servir dans l’artillerie. Alors la République priva le jeune général de son commandement. et le mit en demi-solde.
Bonaparte resta donc à Paris, attendant que son étoile se levât. Et elle se leva cette étoile, brillant d’une telle splendeur qu’elle éblouit les yeux du monde! Avait-il déjà la prescience de sa grandeur future?
L’existence de Bonaparte à Paris était extrêmement monotone. Il la passait dans la méditation et dans la société de quelques amis fidèles, qui venaient au secours de sa pauvreté d’une façon très-délicate. Bonaparte était pauvre, en effet. Il avait perdu pendant la Révolution le peu qu’il avait; il ne possédait rien que les lauriers qu’il avait gagnés sur les champs de bataille d’Italie, et sa demi-solde d’officier général. Mais, comme Joséphine, il avait de vrais amis qui regardaient comme un honneur de l’avoir à leur table, et qui lui donnaient même du pain; car lui aussi, comme Joséphine, était trop pauvre pour en acheter. Son frère Louis et lui dînaient fréquemment chez un ancien ami, Bourienne, qui devint dans la suite le secrétaire de Napoléon. Le jeune général avait l’habitude d’apporter avec lui une part de pain de munition; son frère faisait de même; mais Madame Bourienne prenait toujours soin qu’il trouvât du pain blanc sur son assiette. Son mari et elle avaient fait passer clandestinement à Paris quelque farine provenant de leur propriété de Bourienne, et gagné un boulanger qui leur faisait du pain; fait qui, s’il avait été connu, les aurait certainement menés à la guillotine.
Bonaparte vivait donc tranquillement au milieu de ses amis; il attendait un changement de fortune, espérant que ses désirs se réaliseraient aussitôt que le gouvernement actuel serait remplacé par un autre. Ces désirs, à ce moment, paraissaient être fort modestes, car il dit une fois à Bourienne:
— Si je pouvais vivre convenablement à Paris, louer la petite maison d’en face, être entouré de mes amis et avoir un cabriolet, je serais le plus heureux des hommes.
Il pensait sérieusement «à louer la petite maison d’en face» avec son oncle Fesch (le futur cardinal), quand des événements importants vinrent agiter de nouveau la capitale de la France, et appeler son attention sur les affaires publiques. Le 13 Vendémiaire 1795, fit sortir le jeune général de son obscurité, et lui rendit son énergie et son ambition. Ce fut le 5 Octobre qu’éclata l’orage, depuis longtemps accumulé sur Paris. Les sections se révoltèrent contre la Convention Nationale, qui avait présenté à la France une nouvelle constitution, et décrété que les deux tiers de ses membres entreraient dans le nouveau corps législatif. Les sections de Paris ne voulurent pas accepter la Constitution, à moins que des élections complètement nouvelles ne réglassent la formation de l’assemblée législative. La Convention résolut de défendre ce qu’elle considérait comme ses droits, et appela les représentants, qui commandaient la force armée, pour protéger la République. Barras fut nommé commandant en chef de l’armée de l’intérieur, et Bonaparte eut le commandement en second. Il y eut bientôt combat entre la troupe et les sections révoltées; mais dans ce temps-là, l’art de construire les barricades était dans son enfance, et les insurgés furent bientôt obligés de céder devant le feu meurtrier d’une artillerie bien servie. Ils se retranchèrent dans l’église de Saint-Roch et au Palais-Royal; mais ils en furent bientôt expulsés, et le combat dans les rues recommença.
Au bout de deux jours, pendant lesquels le sang coula, Barras informa la Convention victorieuse que la tranquillité était rétablie, et que le courage et la prévoyance du Général Bonaparte avaient beaucoup contribué à cet heureux résultat.
La Convention Nationale récompensa le zèle de Napoléon en le confirmant dans le poste qu’il occupait provisoirement à l’heure du danger. A partir de ce jour, Napoléon appartient à l’histoire; et son étoile commence à se lever à l’horizon de la renommée.
Napoléon avait maintenant une position dans l’État, et il commença à comprendre la voix de son cœur qui lui parlait de grandes victoires et d’un avenir brillant, Il sentit qu’il avait devant lui un but éclatant pour lequel il fallait combattre; et quoiqu’il ne pût pas encore donner un nom à ce but, il était résolu à le conquérir.
Un jour, un jeune homme se présenta à la maison du jeune général, et demanda avec instance à lui parler. Bonaparte le fit entrer. Il fut frappé de la hardiesse et de la noble démarche du jeune homme, et lui demanda avec bonté ce qu’il désirait.
— Général, — dit le jeune homme,— mon nom est Eugène Beauharnais; je suis le fils d’un ci-devant, le Général Beauharnais, qui servit la République sur le Rhin; mon père fut calomnié par ses ennemis et traîné devant le tribunal révolutionnaire, qui l’assassina trois jours avant la chute de Robespierre.
— Qui l’assassina? — dit Bonaparte d’une voix menaçante.
— Oui, Général, qui l’assassina! — répondit Eugène hardiment. — Maintenant, je viens vous demander, au nom de ma mère, d’exercer votre influence sur le comité pour qu’on me rende l’épée de mon père. Je m’en servirai pour combattre les ennemis de mon pays, et pour défendre la République.
Ce langage hautain amena un sourire d’approbation sur les joues pâles du jeune général, et son œil prit une expression bienveillante lorsqu’il dit:
— Bien parlé, jeune homme! J’aime votre courage et votre piété filiale. Vous aurez l’épée de votre père. Attendez un instant.
Napoléon appela un de ses aides de camp, auquel il donna les ordres nécessaires, et l’officier revint bientôt après avec l’épée du Général de Beauharnais.
Bonaparte lui-même la remit à Eugène. Le jeune homme, profondément ému, la serra sur son cœur pendant que des larmes coulaient de ses yeux.
Le Général s’approcha de lui, et, mettant sa main blanche sur l’épaule du jeune homme, lui dit d’une voix sympathique:
— Mon jeune ami, je serai heureux si je puis faire quelque chose pour vous ou pour votre mère.
Eugène essuya ses larmes et le regarda avec un étonnement enfantin.
— Vous êtes bon, Général; ma mère et ma sœur prieront pour vous.
Cette réplique naïve amena un sourire sur la figure du Général. Il lui fit un signe de tête aimable, et dit à Eugène de présenter ses compliments à sa mère, et de venir bientôt le revoir.
Cette entrevue d’Eugène avec le Général Bonaparte fut le commencement des relations de Napoléon et de Joséphine. L’épée du Vicomte de Beauharnais décapité plaça un diadème Impérial sur le front de sa veuve, et éleva son fils à la royauté.