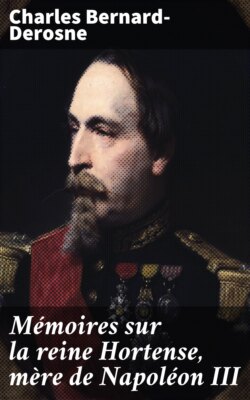Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 18
LOUIS BONAPARTE ET DUROC.
ОглавлениеLa première chose dont s’occupèrent les frères de Bonaparte fut l’éloignement d’Hortense. Ils commencèrent par représenter à Napoléon, qu’elle et Duroc s’aimaient passionnément, qu’ils avaient toujours entretenu une correspondance secrète, et proposèrent d’envoyer Duroc en Italie, où il pourrait occuper un rang plus élevé, qui le mettrait en position d’aspirer à la main d’Hortense. Mais le secret le plus absolu devait être gardé pour faire réussir ce plan, et Joséphine surtout devait l’ignorer. Ils persuadèrent donc à Napoléon (que l’on trompait facilement dans les petites choses, parce que son esprit était toujours occupé de grandes), de tenir le mariage projeté secret, pour faire une surprise agréable au jeune couple et à sa femme tout à la fois.
Mais Joséphine avait vu les intrigues hostiles de ses beaux-frères. Elle comprit bien que tout son avenir, son existence même, dépendaient absolument de la possibilité d’avoir des amis et des alliés dans la famille de son mari.
Il n’y avait qu’un des frères de Napoléon qui ne lui était pas hostile, mais qui, au contraire, aimait et estimait Joséphine, parce qu’elle était la femme de son frère bien-aimé : c’était Louis, le plus jeune des Bonaparte. Louis avait un caractère doux et tranquille, plutôt littérateur que soldat, qui convenait mieux à l’étude qu’à la tribune ou à la vie des camps. Mais ce corps frêle, et presque efféminé, renfermait un courage et une énergie qui ne faillirent jamais au moment du danger, et que ni promesses ni menaces ne purent ébranler. Son extérieur n’était pas gracieux, il était inculte en quelque sorte, mais il était susceptible d’une grande dignité quand il remplissait un grand rôle. Alors ses grands yeux bleus, plus habitués à regarder en dedans qu’en dehors, brillaient, dans ces circonstances, d’un feu plein de résolution.
Son caractère était remarquable, mais en apparence insignifiant; ces espèces de caractères sont rarement compris et estimés à leur juste valeur; dans le trouble et les agitations de la vie, on n’a pas le temps de les étudier avec soin. Une mère ou une sœur, peuvent seule apprécier de tels hommes, car une intimité continuelle et une observation constante leur permettent de voir l’intérieur de cette sensitive, qui se ferme au grossier contact du monde. Ils trouvent peu de femmes qui les aiment, car ils sont trop timides pour en chercher, et semblent trop insignifiants pour qu’on les remarque.
Ce fut donc le plus jeune frère de son mari, à peine âgé de vingt-quatre ans, qui sembla à Joséphine le plus propre à devenir son allié de tous les membres de la famille de Napoléon.
Louis était le favori de Madame Lœtitia, et l’enfant gâté de tous ses frères, qui n’avaient rien à redouter de son ambition ou de son égoïsme. Il ne contrariait jamais leurs plans, et ne se mêlait jamais de leurs affaires; mais il demandait en revanche à avoir la même liberté et à n’être pas contrarié dans ses goûts. Il était le confident de ses sœurs, qui trouvèrent toujours en lui un sage conseiller qui ne les trahit jamais. Napoléon l’aimait particulièrement pour ses nobles qualités, et parce qu’il ne l’importunait jamais comme ses autres frères. Car l’ambition de Joseph, de Lucien et de Jérôme, dérangeait constamment Bonaparte.
«Si on entendait mes frères me demander tous les jours de nouvelles sommes, et le ton avec lequel ils le font, on pourrait vraiment croire que j’ai gaspillé leur patrimoine,» dit un jour Napoléon à Bourienne, après une scène qu’il avait eue avec Jérôme, et qui se termina comme toujours, ce dernier ayant reçu un nouveau bon sur les fonds particuliers du Premier Consul.
Jérôme, de tous les frères de Napoléon, était le plus exigeant, et nous prenons dans le premier volume de ses Mémoires, récemment publiés, cette anecdote caractéristique.
A l’âge de quinze ans, Jérôme était l’enfant gâté du Premier Consul, dont la surveillance paternelle était souvent trompée par cette nature ardente.
Un jour le jeune homme se sauva des Tuileries, et alla se promener sur les Boulevards. 11 choisit le plus beau magasin d’articles de toilette, et entra pour les examiner. Ne trouvant rien d’assez joli à son gré, il se fit montrer les plus belles choses, tant comme objets d’art que comme valeur intrinsèque. Le marchand, étonné du sang-froid du jeune homme, lui montra un nécessaire de 16,000 francs.
— Celui-ci me plaît, — dit Jérôme. — Envoyez-le aux Tuileries, et l’aide de camp du Premier Consul payera.
Il sortit, et le nécessaire fut envoyé aux Tuileries. Duroc, supposant que le Général Bonaparte avait acheté cet objet, le paya, et inscrivit la somme sur la liste des factures qu’il mettait tous les soirs sous les yeux du Premier Consul. Ce dernier, étonné, demanda ce que cela signifiait. Duroc raconta ce qui était arrivé. Le lendemain, on envoya chercher le marchand, et tout fut expliqué. A l’heure du dîner, Bonaparte entra dans la salle où tout le monde l’attendait. Prenant Jérôme par une oreille, il lui dit:
—C’est donc toi qui as jugé convenable d’acheter un nécessaire de 16,000 francs.
— Ah! oui,— répondit-il sans le moindre embarras, — voilà comme je suis, je n’aime que les belles choses.
C’est Mademoiselle Cochelet qui nous fournit cette autre anecdote sur le jeune prince.
Il paraît qu’un jour il avait tout à fait besoin de vingt-cinq louis, car sa bourse était complètement vide, quoique Murât, Gouverneur de Paris, qui lui était très-attaché, lui eût souvent ouvert la sienne. Il n’avait pas cette ressource pour cette fois, et le quartier de la pension qu’il recevait de l’Empereur était dépensé d’avance. Comment faire?... Qui aller trouver?... Ses autres frères?... Ils étaient absents, —Joseph et Louis étaient à leurs régiments, et Lucien était ambassadeur en Espagne ou en Portugal. Quant à sa mère, elle ne voulait pas entendre parler d’argent à donner à ce petit vaurien qu’elle aimait beaucoup, mais auquel elle prodiguait plus ses conseils que sa bourse. L’idée lui vint de rendre une visite à son oncle, le Cardinal Fesch. Il alla le trouver, et fut parfaitement bien reçu, et comme il y avait un grand dîner ce jour-là, il l’invita même à y assister. Quand le dîner fut fini, les convives passèrent au salon pour prendre le café. Jérôme vit en ce moment le Cardinal entrer dans une autre pièce, il le suivit et tirant vers l’embrasure d’une fenêtre cet oncle qu’il avait fréquemment cajolé, il lui fit sa demande, mais celui-ci le refusa.
On sait que le Cardinal était grand amateur de tableaux, et la pièce dans laquelle il était alors formait le commencement de sa splendide galerie. En entendant ce refus positif, Jérôme se retourna tout à coup:
— Voilà un vieux coquin, — dit-il, — qui semble se moquer de l’affront que je reçois; je vais me venger.
En même temps il tira son sabre, et en dirigea la pointe vers la figure d’un vieux gentilhomme peint par Van Dyck, et se prépara à lui crever les yeux. On peut se figurer dans quel état fut le Cardinal en voyant un chef-d’œuvre sur le point d’être anéanti; il essaya d’arrêter le jeune homme par le bras, mais il ne voulut pas entendre raison tant qu’on ne lui eut pas donné vingt-cinq louis. L’oncle capitula, la paix fut faite, et on s’embrassa. La plaisanterie fut trouvée excellente et, quelques jours après, quand on la raconta au Premier Consul, il s’en amusa beaucoup.
Louis, au contraire, ne demandait jamais d’argent. Il se contentait toujours de ce que Bonaparte lui donnait, et son frère n’eut jamais à payer aucune dette, ni à s’arranger pour lui avec aucun marchand.
Cette dernière circonstance inspira à Joséphine une espèce de respect pour son jeune-beau frère. Il était si raisonnable, si rangé qu’il n’avait jamais de dettes! Cela lui paraissait merveilleux à elle qui ne pouvait éviter d’en faire, et à laquelle l’économie était complètement inconnue. Combien de fois déjà ses dettes l’avaient-elles désagréablement embarrassée, et combien de fois l’avaient-elles fait blâmer par son mari; combien de fois lui avait-elle promis de ne plus rien acheter sans pouvoir payer! Pourtant elle faisait de nouvelles dettes, toujours et toujours. Joséphine avait un caractère généreux, même irréfléchi; il lui était impossible de s’observer de ce côté, et quelque peur qu’elle eût des regards furieux de Napoléon, elle ne put jamais se corriger de sa prodigalité, et retombait toujours dans ta même faute.
Louis, avec son caractère économe, lui parut être le mari qui convenait à Hortense; Joséphine s’imagina qu’ils pourraient vivre très-heureux ensemble, et qu’ils dirigeraient leurs cœurs aussi bien que leurs fortunes. Elle résolut donc de faire son gendre de Louis Bonaparte; et en même temps l’allié naturel sur lequel elle s’appuierait pour conserver son influence dans la famille de son frère. Joséphine avait déjà un triste pressentiment de l’avenir; elle regardait l’Aigle Impériale planer au-dessus d’elle comme un mauvais augure, et entendait des voix lamentables dans le calme des nuits.
La négresse de la Martinique avait dit qu’elle deviendrait plus qu’une reine, c’est vrai, mais une autre devineresse, qu’elle avait consultée à Paris (la célèbre madame Villeneuve), lui avait dit qu’en effet elle était destinée à porter une couronne, mais que «ce serait pendant peu de temps.»
Pendant peu de temps? Pourquoi, elle était trop jeune, trop heureuse, pour croire la mort si proche; — que voulait donc dire la prophétie? Le danger qui la menaçait était le divorce. Elle n’avait pas donné d’enfants à Napoléon, et déjà il désirait ardemment avoir un fils! Ses frères lui disaient tous les jours que c’était une nécessité politique d’avoir un héritier.
Joséphine n’osait plus penser à ce sujet; elle tremblait pour son avenir, et elle regardait autour d’elle pour trouver un appui qui l’empêchât de tomber. Avec l’égoïsme de la douleur, elle demanda à sa fille de sacrifier ses rêves de bonheur pour le bien-être réel de sa mère.
Et cependant Hortense aimait. Son jeune cœur se révoltait à l’idée d’abandonner sa chaîne et de se marier à un homme pour lequel elle n’avait pas d’affection, et qui, lui-même, n’avait jamais fait attention à elle. Elle considérait comme impossible que l’on pût sérieusement lui demander de refouler son noble et pur amour pour servir une intrigue de famille. Elle se promit de mourir plutôt que d’abandonner l’homme qu’elle aimait.
— Mais Duroc n’a ni fortune ni avenir à te donner, mon enfant,— dit Joséphine; — tout ce qu’il est, il le doit à Bonaparte; il n’a ni rang, ni nom, et si Napoléon cessait de s’intéresser à lui, il retomberait dans l’obscurité et l’oubli.
Hortense répondit, en souriant au milieu de ses larmes «qu’elle l’aimait et que sa seule ambition était d’être sa femme.»
— Mais lui, sais-tu s’il n’a pas d’autre ambition que d’être ton mari. Crois-tu qu’il t’aime pour toi seulement?
—J’en suis certaine! — répliqua la jeune fille, les yeux brillants. — Duroc me l’a souvent répété ; il m’aime et n’aime que moi. Il a juré de m’aimer toujours, Nous ne demandons rien de plus que d’être l’un à l’autre.
Joséphine haussa les épaules d’un geste de pitié, et dit:
— Mais je suis sûre que Duroc ne veut t’épouser que parce qu’il est ambitieux, et qu’il pense que Napoléon l’élèvera plus rapidement quand il sera ton mari.
— C’est une basse calomnie! c’est impossible, — s’écria Hortense, la rougeur de la colère au front. — Duroc m’aime, et son noble cœur est incapable d’un calcul aussi honteux.
— Suppose que je te prouvé le contraire! — dit Joséphine, irritée de la résistance de sa fille et cruelle dans ses craintes pour son avenir.
Hortense devint pâle, et sa confiance enthousiaste se changea en appréhension.
— Si vous le pouvez, —dit-elle d’une voix à peine intelligible, — si Duroc ne m’aime que comme l’instrument de son ambition... Alors je serai prête à l’oublier et à épouser qui vous voudrez.
Joséphine triompha.
— Aujourd’hui,— dit-elle,— Duroc revient de son voyage, et dans trois jours je t’aurai prouvé qu’il ne t’aime pas, mais qu’il désire seulement entrer dans la famille de Bonaparte.
Hortense n’entendit que les premiers mots de la réponse, de sa mère: «Duroc revient aujourd’hui.» Que lui importait le reste? Elle allait revoir celui qu’elle aimait, elle allait être confirmée dans sa foi par un regard de cette belle tête. Mais elle n’avait pas besoin d’être raffermie dans sa foi, puisqu’elle croyait en lui. Comment la plus petite méfiance aurait-elle pu s’élever dans son esprit et venir troubler la joie de leur première entrevue?
Cependant les jolies mains de Joséphine étaient occupées à serrer de plus en plus les filets de son intrigue. Elle avait besoin d’un allié dans la famille de Napoléon pour conserver sa position, donc Louis devait devenir le mari d’Hortense.
Bonaparte lui-même était opposé à l’union de son frère avec sa belle-fille, et était fermement décidé à la donner à Duroc. Mais Joséphine parvint bientôt à ébranler cette résolution. Elle pleura, implora, caressa jusqu’à ce qu’on lui promit que, si ce qu’elle disait était vrai, si Duroc voulait seulement épouser Hortense parce qu’elle était pour lui un parti avantageux, il ne s’opposerait plus au mariage de sa fille et de son frère. Il résolut d’abord d’éprouver son aide de camp.
Peu après cette conversation avec Joséphine, Napoléon revint à son cabinet, où Bourienne était, comme toujours, assis à sa table, occupé à écrire.
— Où est Duroc? — demanda tout à coup le premier Consul.
— Il est sorti; je crois qu’il est à l’Opéra.
— Aussitôt qu’il rentrera, dites-lui que, d’après ma promesse, je suis décidé à lui laisser épouser Hortense; mais il faut que ce soit fait dans deux jours. Je donne à ma belle-fille un douaire de 500,000 francs. Je nomme Duroc commandant de la 8e division, mais, le lendemain de ses noces, il partira avec sa femme pour Toulon, et nous resterons touj ours séparés. Comme je veux terminer cette affaire, faites-moi savoir cette nuit même si Duroc accepte ou refuse mes propositions.
— Je ne pense pas qu’il accepte, général.
— Très-bien; dans ce cas, Hortense épousera mon frère Louis.
— Mais, y consentira-t-elle?
— Elle sera bien forcée d’y consentir, Bourienne.
Vers la fin de la soirée Duroc revint, et Bourienne lui répéta, mot pour mot, l’ultimatum, du premier Consul.
Duroc écouta attentivement et sans interrompre son interlocuteur; mais sa figure se rembrunit de plus en plus à mesure que le secrétaire parlait.
— Si c’est ainsi, — répliqua-t-il quand Bourienne eut terminé, — si Bonaparte ne peut pas faire plus pour son gendre, je serai obligé de renoncer à l’idée d’épouser Hortense. Cela me chagrine profondément d’agir ainsi, mais je ne veux pas aller à Toulon; j’ai besoin de rester à Paris.
Et sans la plus petite émotion, Duroc prit son chapeau et quitta l’appartement.
Le soir même Joséphine reçut le consentement de son mari au mariage de sa fille et de Louis Bonaparte.
Le soir même aussi Joséphine informa Hortense que Duroc n’avait pas supporté l’épreuve, qu’il avait renoncé à elle par ambition comme il l’avait aimée par égoïsme.
Hortense regarda fixement sa mère. Pas une larme ne brilla dans ses yeux, pas une plainte ne s’échappa de sa bouche; mais elle ressentit une commotion semblable à celle d’un éclair qui l’aurait frappée et aurait détruit pour toujours son amour, ses espérances et son bonheur.
Elle n’eut pas le courage de lutter plus longtemps et de chercher à éviter le sort qui la menaçait; elle se soumit tranquillement. Puisque l’amour l’avait trahie, elle ne s’inquiétait pas de la forme que prendrait son avenir. Elle savait que son bonheur était irrévocablement perdu; car, le seul homme qu’elle aimait l’avait trompée, et toutes ses espérances étaient foulées aux pieds.
Hortense, le lendemain matin, entra posément, et même en souriant, dans la chambre de sa mère, et lui annonça que, voulant complaire à ses désirs, elle ne s’opposerait plus à son union avec Louis Bonaparte.
Joséphine embrassa joyeusement sa fille. Elle ne pensa pas quelle nuit d’angoisses, de prières et de désespoir Hortense avait dû passer. Elle ne soupçonna pas que le maintien composé de sa fille n’était que la résignation désespérée d’un cœur brisé.
Hortense sourit, car Duroc ne pouvait pas voir ce qu’elle souffrait. Son amour pour lui était mort, mais l’orgueil d’une femme trahie existait en elle. Ce fut cet orgueil qui sécha ses larmes, et qui amena un sourire sur sa lèvre pâlie.
Joséphine avait atteint son but. Un frère de Bonaparte devint ainsi son gendre. Elle n’avait plus qu’un doute: ce gendre la protégerait-il contre les deux autres frères de son mari?