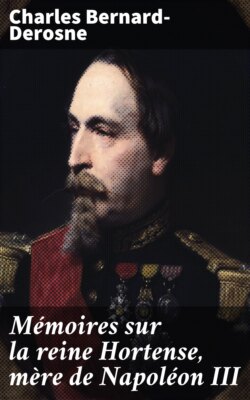Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 12
ОглавлениеBONAPARTE EN ITALIE.
Comme nous l’avons dit, Joséphine passa quelques mois heureux à Paris, mais ils furent bien courts. Quand Bonaparte fut parti pour l’Italie, elle se trouva bien isolée; surtout parce qu’elle avait quitté ses enfants, en même temps que son mari. Eugène accompagna son beau-père en Italie, et Hortense fut mise en pension chez Madame Campan.
Cette dame, qui avait été dame d’atours de Marie-Antoinette, avait établi une pension à Saint-Germain, et toutes les grandes familles de la France révolutionnaire aimaient à envoyer leurs filles chez Madame Campan pour qu’elles pussent y acquérir l’élégance des manières de la vieille France royaliste.
Hortense resta plusieurs années à Saint-Germain; elle avait pour compagne sa tante Caroline, la sœur de Bonaparte, — celle qui fut plus tard Reine de Naples, — et sa cousine, la jeune Comtesse Stéphanie de Beauharnais.
Ces années se passèrent dans l’étude, et les rêves de jeunes filles. Hortense travaillait beaucoup, elle apprenait la musique, le dessin, plusieurs langues, en même temps que l’histoire et la géographie; une bonne partie de son temps était employée à acquérir les manières de la société élégante, et ce savoir-vivre aristocratique, que personne n’enseignait mieux que Madame Campan. Les meilleurs maîtres furent chargés de l’éducation de la jeune fille; Isabey lui donnait des leçons de dessin, Lambert des leçons de chant, Coulon des leçons de danse, et le célèbre d’Alvimare des leçons de harpe. Il y avait un théâtre d’amateurs chez Madame Campan, sur lequel Hortense jouait des rôles héroïques ou tendres; des bals et des concerts y étaient fréquemment donnés par la directrice, pour faire admirer à l’élite de la société les talents de ses élèves. Hortense reçut donc une éducation de grande dame. Il est probable qu’alors elle ne se doutait pas de l’importance qu’auraient pour elle toutes ces choses qui paraissaient des bagatelles, ni du bénéfice qu’elle retirerait d’avoir été mise en pension chez Madame Campan, et d’avoir été élevée comme une princesse.
Joséphine marchait de triomphe en triomphe. L’étoile de son mari s’élevait de plus en plus; le nom de Bonaparte était répété par tout le monde, et faisait frissonner l’Europe, qui pressentait son maître futur. Les bulletins des victoires remportées en Italie se succédaient sans interruption, et sous le talon de fer de Bonaparte des États s’écroulaient, et d’autres États s’élevaient sur leurs ruines.
La vieille république de Venise, — autrefois la terreur du monde entier, — la Reine victorieuse de la Méditerranée, — fut forcée de baisser sa tête altière, et de se prosterner aux pieds de son vainqueur. Le lion de Saint-Marc ne fit plus trembler le monde par ses rugissements, et les colonnes élevées sur la Piazzetta, en mémoire des anciennes victoires, furent les seuls trophées que Venise déchue put garder de sa conquête de Candie, de la Morée et de Chypre. Par l’ordre de Bonaparte, il s’éleva, sur les ruines de la République de Venise, un nouvel État qui fut nommé la République Cisalpine; ce fut la fille aînée de la République Française. Tandis que le dernier doge de Venise, Luigi Manin, était forcé de déposer aux pieds de Napoléon sa couronne, et s’évanouissait de douleur, un autre Vénitien, Dandolo, était placé à la tête de la nouvelle République. Dandolo était issu d’une noble famille qui avait donné à Venise ses plus illustres doges, et il était lui-même «un homme,» comme le disait Bonaparte.
«Mon Dieu,» disait un jour Napoléon à Bourienne,
«comme il est difficile de rencontrer des hommes en ce monde. Il y a dix-huit millions d’âmes en Italie, et je n’y ai trouvé que deux hommes: Dandolo et Melzi.»
Mais au milieu de ses victoires, tout en désespérant des hommes, Bonaparte conservait son ardent amour pour sa femme, à laquelle il écrivait tous les jours les lettres les plus tendres, et dont il attendait les réponses avec la plus vive impatience.
Les lettres de Joséphine seules ne subissaient pas l’étrange coutume que Bonaparte adopta pendant une partie de ses campagnes d’Italie; cette coutume était de jeter toutes les lettres, à l’exception de celles qui étaient apportées par des courriers extraordinaires, dans un grand panier, où elles restaient vingt et un jours sans être décachetées. Bonaparte n’était pas si dur que le Cardinal Dubois, qui brûlait chaque lettre aussitôt son arrivée, et qui disait, en regardant les flammes dévorer la pétition d’une mère au désespoir, ou peut-être d’une épouse inconsolable:
«— Voilà ma correspondance faite.»
Bonaparte, — disons-nous, — n’était pas si dur; il lisait au moins ses lettres, quoiqu’elles dussent attendre trois semaines. Ces trois semaines d’attente lui épargnaient ainsi qu’à son secrétaire Bourienne un énorme travail; car lorsque les lettres étaient décachetées, il arrivait que les circonstances avaient rendu les réponses des quatre cinquièmes inutiles, et on n’avait besoin d’écrire qu’à très-peu de gens. Bonaparte riait de tout cœur en voyant un résultat si inespéré, et s’amusait beaucoup de son heureuse idée.
Les lettres de Joséphine n’attendaient pas une heure, pas une minute, pour être lues. Le cœur de Bonaparte battait toujours en les recevant, et il leur répondait en termes si passionnés que l’on sentait bouillonner le sang Corse dans ses réponses, et que les lettres de Joséphine semblaient froides à côté des siennes.
Marmont rapporte dans ses Mémoires, qu’à Vérone Bonaparte ayant brisé par accident le verre de la miniature de Joséphine, il devint pâle et dit:
— Marmont, ou ma femme est très-malade ou elle me trompe.
Bonaparte ne se contenta bientôt plus des lettres de Joséphine. Aussitôt que la guerre fut un peu calmée il l’appela à Milan. Elle obéit avec joie, et se hâta de se rendre en Italie rejoindre son époux, avec lequel elle passades journées d’amour et de triomphe. Toute l’Italie acclamait le héros victorieux, toute l’Italie rendit hommage à la femme qui portait son nom, et dont la grâce, la beauté et l’affabilité avaient su captiver tous les cœurs. La vie de Joséphine à cette époque ressemble à une longue marche triomphale, à une fête inouïe, à une légende des Mille et une Nuits réalisée, et dont elle est la fée étincelante.