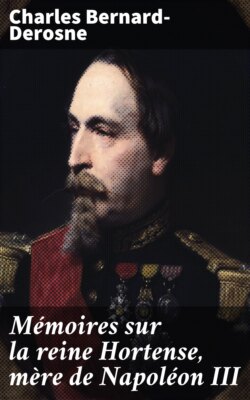Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 13
ОглавлениеVARIATIONS DE FORTUNE.
Bonaparte, à son retour d’Italie, fit une entrée triomphale à Paris. Devant le Luxembourg, où siégeait le Corps Législatif, un vaste amphithéâtre avait été construit, au milieu duquel s’élevait un immense autel à la Patrie, entouré par trois statues gigantesques représentant la Liberté, l’Egalité et la Paix, et par toutes les notabilités de France.
Quand Bonaparte arriva sur la place, tous les hommes qui encombraient les sièges de l’amphithéâtre se levèrent et se découvrirent pour saluer le vainqueur de l’Italie. Les fenêtres du palais étaient garnies de dames en grande toilette qui applaudissaient le jeune héros et agitaient leurs mouchoirs. Cette solennité fut interrompue tout à coup par un fatal accident. Un des officiers du Directoire qui, poussé par la curiosité, avait grimpé tout en haut de l’échafaudage de l’aile droite du Luxembourg, tomba de cette hauteur, et mourut aux pieds de Bonaparte. Un cri d’horreur retentit. Les dames pâlirent et se retirèrent des fenêtres. Une consternation soudaine se répandit parmi le Corps Législatif; on pouvait entendre courir çà et là un murmure qui disait que la chute de l’officier du Directoire était de mauvais augure, et que le Directoire lui-même viendrait bientôt expirer aux pieds du général victorieux.
Malgré ce pressentiment, le Directoire fit honneur au vainqueur d’Arcole dans une suite de fêtes. Quand Bonaparte rentrait chez lui après de tels banquets, fatigué des discours et des toasts, le peuple de Paris était heureux de se presser sur son passage. Il était obligé de répondre, par des mouvements de tête et des sourires, aux vivats et aux félicitations.
La nation Française semblait folle de joie; chacun voyait en Bonaparte sa propre gloire, chacun le considérait comme la plus brillante incarnation de son être, et par conséquent, le chérissait avec bonheur.
Joséphine se réjouissait de toute son âme de la gloire de son époux, tandis que Bonaparte cherchait à éviter toutes ces ovations des Parisiens. Lorsqu’au théâtre, il s’efforçait de se cacher derrière le fauteuil de sa femme, Joséphine sentait son cœur battre de plaisir et d’orgueil, et aurait volontiers remercié le public des preuves d’amour qu’il donnait à son héros.
Mais Bonaparte ne se laissait pas aveugler par ces ovations. Un jour que l’enthousiasme du public atteignait un délire inaccoutumé et que les cris de: «Vive Bonaparte!» semblaient devoir être interminables, Joséphine se tourna vers lui et lui dit:
— Voyez comme ces bons Parisiens vous aiment!
— Bah! — répondit Napoléon, — ils m’insulteraient tout autant si j’allais à l’échafaud.
A la fin, les fêtes et les démonstrations cessèrent et la vie reprit encore son cours calme et naturel. Bonaparte vivait dans sa maison de la Rue Chantereine que Joséphine avait splendidement et élégamment meublée. Peu de temps après, cette rue prit le nom de Rue de la Victoire, en l’honneur du vainqueur d’Arcole et de Marengo. C’est là qu’il se reposait de ses triomphes dans le sein de sa famille, au milieu de laquelle il passait ses jours dans le bonheur le plus complet.
Cette inactivité, cependant, lui pesa bientôt; il avait besoin de nouvelles victoires; il sentait qu’il avait à peine commencé sa carrière de grandeur; nuit et jour il entendait la trompette guerrière qui résonnait à son oreille, et qui semblait l’appeler sur le champ de bataille. L’amour apaisait son cœur, mais il ne put jamais le remplir entièrement. L’inaction lui paraissait le commencement de la mort.
— Si je reste plus longtemps ici sans rien faire, — dit-il, — je suis perdu. Les Parisiens ont peu de mémoire pour toutes choses; dans cette Babylone extraordinaire les choses étonnantes se succèdent avec une telle rapidité que je serai bientôt oublié, si je ne leur fais voir quelque chose de nouveau.
Il entreprit donc quelque chose de nouveau, quelque chose dont on n’avait pas encore entendu parler, et qui excita l’étonnement de toute l’Europe. Il quitta la France à la tête d’une armée pour aller conquérir, pour la République, la vieille Égypte sur les pyramides de laquelle s’était amoncelée la poussière des siècles.
Joséphine n’accompagna pas son mari; elle resta à Paris. Elle avait encore besoin de consolations et d’encouragements dans sa solitude, que Bonaparte lui avait dit devoir durer six mois, ou six ans. Pouvait-elle avoir une consolation plus douce que la présence de sa fille? Elle avait donné son fils à son mari, qui l’avait emmené avec lui en Égypte; mais sa fille lui restait, car elle était récemment sortie de pension.
L’éducation d’Hortense était alors terminée; l’enfant qui était entrée deux ans auparavant dans l’institution de Madame Campan, était maintenant une charmante et timide jeune femme, possédant tous les charmes de l’innocence et de la jeunesse, de la grâce et de l’élégance. Hortense avait seize ans, mais elle avait encore la gaieté d’un enfant, et la naïveté d’une petite fille. Son cœur ressemblait à une page immaculée sur laquelle aucune main profane n’avait encore osé écrire un nom. Elle n’aimait que sa mère, son frère, les arts et les fleurs. Elle avait une sorte de crainte de son jeune beau-père. Son œil fier l’effrayait, et sa voix impérieuse la faisait trembler; elle avait trop de respect pour lui, pour pouvoir l’aimer. Pour elle il était toujours le héros, le maître, le père auquel elle devait une obéissance aveugle, et qui ne pouvait pas être l’objet d’une tendre affection.
. Hortense regardait l’avenir avec cette curiosité d’enfant qui fait voir le monde à travers les riantes couleurs du prisme. Elle s’attendait à quelque grand ét brillant événement qui devait la rendre parfaitement heureuse, sans cependant savoir, ni chercher à savoir, quel il serait. Elle aimait tous les hommes, et croyait encore à leur fidélité et à leur sincérité. Aucune épine n’avait encore blessé son cœur, aucun espoir déçu, aucune illusion perdue n’avait encore jeté l’ombre d’un mécontentement sur son front si pur. Son œil bleu brillait de joie et de bonheur, et sa gaieté était si innocente, qu’elle rendait quelquefois sa mère mélancolique. Elle savait bien que cet heureux âge, où la vie nous paraît toute tissue d’or, ne peut pas durer longtemps.
Telle était Hortense quand sa mère alla la chercher à la pension de Saint-Germain pour aller avec elle aux eaux de Plombières. Dans cette ville, Hortense faillit perdre sa mère.
Un jour, elle était avec Joséphine et quelques autres dames dans le salon, la fenêtre était ouverte et laissait entrer une chaude brise d’été. Hortense était assise près de la fenêtre, occupée à dessiner un bouquet de fleurs des champs qu’elle avait cueillies dans les montagnes voisines. Joséphine trouva l’air de la chambre étouffant et proposa aux dames de se mettre sur le balcon. Tout à coup on entendit un craquement et des cris confus. Hortense s’élança et vit sa mère précipitée dans la rue, avec le balcon et toutes les dames qui s’y trouvaient. Hortense eut un tel chagrin qu’elle se serait précipitée derrière sa mère si on ne l’eût pas retenue. Mais la Providence avait été miséricordieuse, et sa mère en fut quitte pour la peur et une légère contusion au bras. Une des dames eut les deux jambes brisées.
Joséphine ne devait pas encore mourir. La prophétie de la diseuse de bonne aventure n’était pas encore accomplie. Elle était, il est vrai, la femme d’un général célèbre, mais elle n’était pas encore plus qu’une reine!