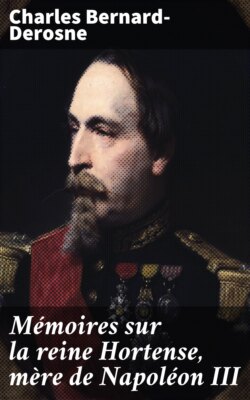Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 11
ОглавлениеLE MARIAGE.
Peu de jours après cette entrevue, Joséphine rencontra le jeune général à une des brillantes soirées données par Barras, le commandant en chef. Elle demanda à Barras de la présenter à son collègue, et alors, en lui tendant la main avec cette manière franche et modeste qui lui était particulière, elle remercia Bonaparte pour la bonté qu’il avait témoignée à son fils.
Bonaparte regarda avec étonnement cette belle jeune femme, qui se disait la mère d’un fils déjà grand. Ses traits avaient encore le charme de la jeunesse, son œil noir et fier annonçait une nature passionnée, tandis que le doux sourire qui errait sur ses lèvres révélait un cœur aimant et une modestie toute féminine.
Napoléon n’eut jamais l’art de faire des compliments aux femmes avec l’air enjoué d’un petit-maître; chaque fois qu’il essaya il ne put réussir; ses compliments étaient toujours brutaux ou comiques, et pouvaient être aussi bien pris pour des railleries. Lorsqu’il fut Empereur, il dit un jour à la belle Duchesse de Chevreuse:
— Comme vos cheveux roux sont beaux!
— C’est très-probable, — répondit la dame, —mais je vous assure que c’est la première fois que j’entends dire pareille chose.
Dans une autre circonstance, il dit à l’une des dames de son entourage, dont le beau bras avait attiré son attention:
— Mon Dieu! que votre bras est rouge!
Et à une autre:
— Vous avez vraiment de magnifiques cheveux, mais votre manière de les arranger est d’un mauvais goût horrible.
Bonaparte, nous le répétons, ne savait pas faire de compliments en paroles, mais il savait parler le langage des yeux, et Joséphine comprenait facilement ce langage muet. Elle vit qu’à partir de ce moment elle avait enchaîné le jeune lion, et elle fut heureuse de le constater, car son propre cœur, qu’elle avait cru mort depuis longtemps, battait pour le jeune héros.
Ils se rencontrèrent fréquemment, et bientôt Joséphine entendit l’aveu de l’amour de Napoléon. Elle l’accueillit favorablement et lui promit sa main. En vains ses amis qui étaient au pouvoir, Barras et Tallien, lui conseillèrent de ne pas épouser ce jeune général pauvre, qui pouvait être tué dans une bataille prochaine, et la laisser veuve une seconde fois. Elle se décida à suivre son inclination, et elle secoua la tête avec un sourire significatif. Se rappelait-elle la prophétie de la vieille négresse? Lisait-elle sur le large front de Bonaparte et dans son œil fier, quel homme il devait être un jour; ou l’aimait-elle assez passionnément pour préférer une humble position avec lui à un mariage plus avantageux?
Quoi qu’il en soit, les conseils de ses amis ne purent ébranler sa résolution; elle s’était dit qu’elle serait la femme du pauvre officier. Le jour de leur mariage fut fixé, et tous deux commencèrent à monter leur maison. Bonaparte n’avait pas encore pu réaliser son rêve de bonheur, il n’avait ni cheval, ni cabriolet, et Joséphine non plus n’avait pas de voiture. Ils étaient donc obligés d’aller àpied; mais il est très-probable qu’ils ne le regrettaient pas, puisque cela leur permettait d’avoir une conversation suivie, non interrompue par le bruit du carrosse. Il avait souvent le bonheur d’entendre admirer la beauté de Joséphine, quand il se promenait avec elle. Alors un sourire éclairait sa figure, et quand le peuple se rassemblait pour voir passer le héros du 13 Vendémiaire, et murmurait son nom, sa fiancée était fière à juste titre de l’homme qu’elle avait choisi, malgré l’opposition de ses amis, et sur lequel elle comptait pour réaliser la prophétie qui lui avait était faite.
Un jour Bonaparte accompagna la Vicomtesse chez M. Ragideau, l’homme le plus petit, mais l’un des premiers notaires de Paris, qui, pendant longtemps, avait été le conseil de la famille Beauharnais, et s’était en cette circonstance chargé de lui procurer de l’argent pour meubler sa maison. Bonaparte resta dans un premier salon, pendant que Joséphine entra dans le cabinet de l’homme de loi.
— Je suis venue pour vous dire que j’ai l’intention de me remarier,—dit Joséphine à M. Ragideau, avec un délicieux sourire.
Le petit notaire fit un signe de tête approbateur.
— Vous faites bien, — répliqua-t-il, — et je vous en félicite sincèrement, car vous n’avez pu que faire un bon choix.
— Certainement, — répondit Joséphine, avec l’heureux orgueil d’une femme qui aime; — mon futur mari est le Général Napoléon Bonaparte.
Le petit notaire recula stupéfait.
—Comment, vous, la Vicomtesse de Beauharnais, vous avez l’intention de vous marier avec ce petit Général Bonaparte, ce général de la République, qui l’a déjà renvoyé une fois, et qui peut le renvoyer encore demain.
Joséphine répondit simplement:
— Je l’aime!
—Oui, vous pouvez l’aimer maintenant,—répliqua l’homme de loi, dans une excellente intention, —cependant, vous ne devez pas l’épouser, car vous le regretterez un jour. Je vous le répète, vous avez tort, Vicomtesse, vous allez commettre une folie en épousant cet homme, qui n’a rien que la cape et l’épée.
— Mais qui a de plus un grand avenir, —répondit gaîment Joséphine.
Et, changeant de conversation, elle parla des affaires qui l’amenaient à l’étude.
Quand elle eut terminé avec M. Ragideau, Joséphine retourna au salon où le Général l’attendait. Il s’approcha d’elle avec un sourire, mais il lança à M. Ragideau, qui la suivait, un tel regard de colère et de mépris, que le pauvre petit homme s’éloigna épouvanté. Joséphine remarqua aussi que la figure de Bonaparte était plus pâle que de coutume, et qu’il parlait moins; mais elle savait que, dans de pareilles circonstances, il ne fallait pas le questionner sur la cause de sa mauvaise humeur; elle fit donc semblant de ne pas la remarquer, et elle réussit bientôt à chasser les nuages de son front.
Le mariage de Bonaparte et de Joséphine eut lieu le 9 mars 1796: les témoins étaient, outre Eugène et Hortense Beauharnais, Barras, Jean Le Marrois, Tallien, Calmelet et Leclercq.
L’acte civil contient une erreur très-flatteuse pour Joséphine. Bonaparte, dans l’intention d’égaliser son âge et celui de sa fiancée, avait rajeuni Joséphine de quatre ans, tandis qu’il s’était vieilli, lui, de plus d’un an. Bonaparte n’était pas né le 5 février 1768, comme le disait l’acte de mariage, mais bien le 15 août 1769, et le jour de la naissance de Joséphine n’était pas le 23 juillet 1767, mais le 23 juin 1763.
Joséphine récompensa la délicate flatterie de Bonaparte d’une manière princière. Le jour de son mariage, il reçut le commandement en chef de l’armée d’Italie, avancement qu’il devait à l’amitié de Barras et de Tallien pour sa femme.
Avant que le jeune mari ne partît pour la guerre, où il allait conquérir de nouveaux lauriers et une plus grande renommée, il passa quelques mois heureux auprès de sa femme. Il habitait avec sa famille dans une petite maison de la rue Chantereine, qu’il avait achetée peu de temps auparavant, et que Joséphine avait meublée avec beaucoup de goût.
Ainsi la moitié du rêve de bonheur de Bonaparte était réalisé ; il avait une maison à lui. Le cabriolet était la seule chose qui lui manquât pour être «le plus heureux des hommes.»
Malheureusement, les désirs de l’homme croissent en même temps que sa fortune; et Bonaparte ne se contenta bientôt plus de sa maison à Paris; il voulut encore en avoir une à la compagne.
«Veuillez voir,» écrivait-il à Bourienne, qui vivait dans sa propriété, auprès de Sens, «s’il n’y a pas dans votre belle vallée de l’Yonne quelque propriété qui pourrait me convenir. J’aimerais à m’y retirer; seulement faites attention que je ne veux pas acquérir une propriété nationale.»
Quant au cabriolet, la paix de Campo-Formio donna au général victorieux un magnifique attelage de six chevaux blancs, cadeau de l’Empereur d’Autriche au Général de la République. L’empereur pensa-t-il, à ce moment, que ce général devait être son beau-fils dix ans plus tard?
Ces six chevaux splendides furent la seule chose que Bonaparte rapporta d’Italie, si nous exceptons les lauriers qu’il gagna à Arcole, Marengo et Màntoue, et furent le seul présent que le général accepta.
Les six chevaux blancs ne pouvaient pas s’atteler à un. cabriolet, c’est vrai; mais ils eurent l’air très-princier lorsqu’ils traînèrent la voiture éblouissante dans laquelle, un an plus tard, le Premier Consul fit son entrée solennelle aux Tuileries.