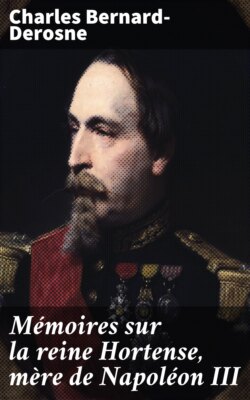Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 21
CALOMNIE.
ОглавлениеLe mariage d’Hortense avec le frère de Bonaparte n’eut pas les résultats que Joséphine avait attendus. Elle avait fait un mauvais choix, car, de tous les frères du premier Consul, Louis était celui qui aimait le moins à se mêler d’intrigues politiques; de plus, Louis n’eut plus la même amitié qu’auparavant pour Joséphine; son cœur franc et honnête l’accusait d’avoir mal agi en sacrifiant le bonheur de sa fille à ses propres intérêts; il était furieux contre elle parce qu’elle l’avait obligé à se marier sans amour, et quoiqu’il ne fût pas encore dans les rangs des ennemis de Joséphine, il n’était déjà plus son ami.
La vie que menait le jeune couple était étrange; les deux époux se disaient ouvertement l’un à l’autre qu’ils ne se plaisaient pas et qu’ils avaient été unis par force. Dans cet étrange état d’indifférence, ils s’apitoyaient l’un sur l’autre, comme des amis, sur leur malheur conjugal, et se répétaient souvent qu’ils étaient convaincus de ne jamais s’aimer; mais leur compassion mutuelle devint assez forte pour se convertir aisément en affection.
Déjà Louis passait quelques heures auprès de sa femme, s’efforçant de l’amuser par sa conversation spirituelle, et Hortense commençait à considérer comme son devoir le plus sacré de faire oublier à son mari, par toutes les attentions possibles, qu’il n’était pas heureux à côté d’elle. Ils espéraient tous deux que l’enfant qu’ils attendaient les consolerait de leur malheureuse union et de la liberté qu’ils avaient perdue.
— Si je vous donne un fils, — dit Hortense en souriant, — la première fois qu’il vous appellera son père, vous me pardonnerez peut-être d’être sa mère.
—Et, en pressant ce fils sur votre cœur et en sentant combien vous l’aimez, vous oublierez que je suis son père. Tout au moins vous cesserez de me haïr, car je serai le père de votre enfant bien-aimé.
Très-probablement, si les jeunes époux avaient été laissés à eux-mêmes, ils auraient fini par se comprendre; ils auraient vaincu leur destinée, — et leur antipathie se serait changée en amour. Mais le monde les traita cruellement: il écrasa sans pitié le germe d’affection qui commençait à se développer dans le cœur d’Hortense.
Joséphine avait marié sa fille à son beau-frère, afin de la garder près d’elle. Ses ennemis le savaient bien, et par conséquent cette fille devint l’objet de leurs attaques incessantes et de leurs malignes calomnies. Comme ils n’avaient pas pu arriver à leur but par son mariage ils essayèrent, pour l’atteindre, de la calomnier.
Dans cette intention, on répandit le bruit que Bonaparte avait marié Hortense à son frère parce qu’il l’aimait lui-même, et qu’il était jaloux de Duroc. Quelques-uns poussaient même cette infâme calomnie plus loin, et insinuaient que l’enfant qu’Hortense portait dans son sein appartenait plus à Napoléon qu’à son frère.
C’était un affreux mensonge, mais il était bien calculé. Ils savaient combien Napoléon haïssait même le plus léger soupçon en ces sortes de choses; combien il était sévère sur ses principes; et par conséquent combien il lui serait pénible d’être l’objet de pareilles calomnies.
Ils pensaient que, pour imposer silence à de pareils bruits, Napoléon éloignerait Louis et Hortense de Paris; alors Joséphine aurait été seule et il aurait été plus facile de la priver de son influence et de séparer Napoléon de l’ange gardien qui lui disait:
— Ne sois pas roi, contente-toi d’être le plus grand homme de ton siècle, ne mets pas de couronne sur ta tête.
Ces calomnies ne se répétaient que tout bas, à Paris; mais elles circulaient librement à l’étranger. Les ennemis de Bonaparte saisirent cette occasion de le blesser comme homme, puisque comme héros il était au-dessus de leurs attaques.
Un jour, Napoléon lisait un journal anglais qui lui avait toujours été hostile, et qu’il savait être l’organe du Comte d’Artois, qui vivait à Hartwell. Tout à coup un nuage de colère passa sur son front. Par un geste d’indignation il froissa le papier dans sa main. Puis son visage s’éclaira et un sourire d’orgueil vint l’illuminer. Il se leva, ordonna au maître des cérémonies de l’attendre, et lui dit d’envoyer des invitations pour un bal qu’il voulait donner le jour suivant à Saint-Cloud. Après cela Bonaparte alla trouver Joséphine pour l’informer des dispositions qu’il venait de prendre, et lui dire de faire venir Hortense à ce bal, quelque indisposée qu’elle fût.
Hortense était trop habituée à obéir à son beau-père pour faire une seule objection. Elle se leva de la chaise longue sur laquelle elle restait couchée depuis quelque temps, et commanda à ses femmes de l’habiller pour le bal; elle se trouva très-mal à l’aise dans sa riche toilette, qui correspondait peu à sa disposition d’esprit; mais la pauvre femme n’osa même pas se plaindre de la contrainte que lui imposait son beau-père.
A l’heure indiquée elle était dans la grande salle de bal de Saint-Cloud; Bonaparte vint au-devant d’elle avec un sourire plein de courtoisie; mais, au lieu de la remercier d’être venue faire une apparition, il l’invita à danser.
Hortense, très-étonnée, regarda Napoléon; elle savait que d’habitude il n’aimait pas la vue d’une femme enceinte; il avait souvent dit que c’était très-désagréable à l’œil et fort inconvenant de voir danser une femme dans une pareille situation, et maintenant il lui demandait de le faire?
Hortense refusa d’accéder au désir du premier Consul, mais Bonaparte devint de plus en plus pressant.
— Tu sais combien j’aime te voir danser, Hortense, — dit-il avec un sourire engageant; — danse seulement une fois, je regarderai cela comme une grande faveur, ne fût-ce qu’un quadrille.
Alors Hortense, quoique avec répugnance et en rougissant beaucoup, obéit à son beau-père.
Ceci se passait pendant la nuit. Quel fut l’étonnement d’Hortense de voir dans le journal du lendemain une pièce de vers qui vantait dans les termes les plus flatteurs son amabilité d’avoir consenti à danser un quadrille, malgré l’événement qu’elle attendait dans quelque temps.
Hortense ne fut pas flattée, mais au contraire très-offensée par ces vers emphatiques. Elle se rendit en toute hâte aux Tuileries pour se plaindre et pour demander à sa mère comment il se faisait que le journal pût imprimer le matin ce qui s’était passé dans la nuit précédente. Bonaparte, qui se trouvait avec Joséphine quand Hortense entra, et auquel elle s’adressa d’abord, répondit en souriant d’une façon évasive et quitta l’appartement. Hortense se tourna alors vers sa mère, qui était étendue en larmes sur un sofa. Joséphine savait ce qui s’était passé, car Napoléon lui avait tout raconté, et son cœur était trop plein d’amertume pour garder le secret.
Elle dit à sa fille que Bonaparte ne lui avait demandé de danser un quadrille avec lui que parce qu’il avait ordonné à M. Esmenard de faire son éloge, et que le bal avait été uniquement arrangé pour qu’Hortense pût danser, et que la pièce de vers faite sur elle pût paraître dans le journal.
Quand Hortense demanda la raison de tout cela, Joséphine eut le cruel courage d’apprendre à sa fille les bruits calomnieux qu’on répandait partout; elle eut la barbarie de lui dire que Napoléon avait ordonné vers, quadrille et bal, parce qu’il avait lu récemment dans un journal anglais que Madame Louis Bonaparte était accouchée, quelque temps auparavant d’un garçon, et qu’il voulait donner un démenti irréfutable à cet article.
Hortense reçut cette nouvelle blessure en souriant avec mépris; elle n’eut pas un mot d’indignation pour cette infâme calomnie; elle ne pleura pas, ne se plaignit pas; mais quand elle se leva pour s’éloigner elle s’évanouit et tomba lourdement sur le parquet. Il fallut des heures pour la faire revenir à elle.
Peu de temps après Hortense donna le jour à un fils mort-né. Ainsi sa dernière espérance de bonheur s’était évanouie: il n’y avait plus aucun lien entre le mari et la femme.
Hortense, après sa maladie, se releva le cœur ferme et résolu. Pendant les longs jours qu’elle avait passés dans le lit, elle avait pensé à beaucoup de choses, et elle avait découvert les intrigues ourdies autour d’elle. Elle vit clairement sa position. Elle avait été mère, et quoiqu’elle n’eût pas d’enfant, elle avait conservé le courage d’une mère. La jeune fille rêveuse, au cœur tendre, était devenue tout à coup une femme énergique, et à l’esprit fortement trempé, qui ne voulait pas courber la tête plus longtemps sous le joug du malheur, mais qui voulait le braver en face. Son destin ne pouvait pas changer, mais au lieu d’être menée par lui, Hortense était résolue à le dominer, et, puisqu’elle ne pouvait pas être heureuse par le cœur, elle voulait l’être par l’esprit; puisqu’elle ne pouvait pas avoir un intérieur paisible, sa maison allait devenir le lieu de réunion de tous les hommes de génie et de science. Les poëtes et les artistes, les chanteurs et les sculpteurs devaient en faire le temple des arts.
Depuis longtemps déjà on parlait dans Paris du salon de Madame Louis Bonaparte; des fêtes et des concerts qui s’y donnaient; les artistes les plus distingués de l’Opéra chantaient les mélodies composées par Hortense, et Talma récitait de sa voix pleine et sonore les poésies qu’elle avait écrites. Chacun recherchait la faveur d’être invité à ces soirées où les exécutants et les auditeurs se mêlaient les uns aux autres, et où, au lieu de médire et de critiquer, on causait et on voyait avec plaisir revivre le goût de la littérature et des sciences.
Hortense semblait s’être réconciliée avec la vie et en jouir. Elle éloignait toutes les choses désagréables qui en sont inséparables, elle fermait les yeux pour ne pas les voir, ou les regardait avec un froid mépris. Elle ne fit jamais la plus petite allusion à la calomnie que sa mère lui avait révélée; elle regarda comme au-dessous d’elle de chercher à venger son honneur. Elle comprenait qu’il y a des accusations auxquelles le silence est la meilleure réponse, et qu’un seul mot d’explication peut rendre possibles. L’accusation portée contre elle d’une façon si infâme était si au-dessous d’elle qu’elle n’aurait pas pu l’atteindre même si elle avait voulu s’abaisser.
Cependant Bonaparte ressentait encore le coup de cette calomnie, surtout parce que ces bruits insultants continuaient à se répandre. Ses ennemis s’efforçaient de la faire revivre, car ils voulaient flétrir les lauriers de Napoléon en l’accusant d’un crime odieux.
— Ils persistent toujours à répandre le bruit d’une liaison entre Hortense et moi, —dit-il un jour à Bourienne, — ils ont même été si loin qu’ils ont fait de misérables insinuations sur la légitimité de son fils. J’ai cru d’abord que ce bruit s’était répété parce que la nation désirait que j’eusse un fils, mais je crois que maintenant on parle d’une liaison intime, n’est-il pas vrai?
—C’est vrai, Général. Et j’avoue que je n’aurais jamais cru que ces calomnies eussent un si grand crédit.
— C’est vraiment abominable, — répliqua Napoléon, d’une voix émue;— vous savez, Bourienne, si ce bruit est fondé ou non. Vous voyez et vous entendez tout. Rien de ce qui se passe dans ma maison ne peut échapper à votre observation. Vous étiez le confident d’Hortense dans son roman avec Duroc; j’espère donc, si jamais vous écrivez quelque chose qui me concerne, que vous détruirez cette infâme accusation. J’espère bien qu’elle ne s’attachera pas à ma mémoire. Je compte sur vous, Bourienne, parce que je sais que vous n’y avez jamais ajouté foi.
— Jamais, Général!
— C’est bien, je compte sur vous. Non-seulement pour moi-même, mais encore pour cette pauvre Hortense. Elle est déjà assez malheureuse et mon frère aussi. J’en suis fâché pour eux, car je les aime tous les deux. Vous vous rappellerez ce que je viens de vous dire quand vous parlerez de moi dans vos écrits?
— Je me le rappellerai, Général. Je dirai la vérité ; seulement il n’est malheureusement pas en mon pouvoir d’y faire croire tout le monde.
Bourienne a tenu sa parole. Il a dit la vérité. Il parle avec indignation de la misérable calomnie par laquelle, pendant si longtemps, les ennemis de Napoléon essayèrent de ternir la mémoire de l’Empereur et celle d’Hortense. Dans sa juste colère, il oublie même le langage poli et modéré du diplomate, qu’il emploie dans toutes les autres occasions.
«C’est une abominable calomnie,» dit Bourienne,
«de prétendre que Bonaparte eut jamais pour Hortense
» d’autres sentiments que ceux d’un père.
» Hortense n’avait pour lui qu’une admiration respectueuse.
» Jamais elle ne parla au premier Consul
» sans trembler; elle n’osa jamais l’interroger sur
» n’importe quel sujet et s’adressait souvent à moi
» pour demander ce qu’elle voulait; et ce n’est que
» lorsque j’avais essuyé un refus que je disais le
» nom de celle qui demandait.
» —La petite sotte, —répondait le premier Consul.
» — pourquoi ne parle-t-elle pas elle-même?
» Napoléon eut toujours pour elle les sentiments
» d’un père, et depuis le premier jour de son mariage,
» il l’aima comme si elle eût été sa propre fille. Moi,
» qui, pendant des années, ai été le témoin constant de
» toutes les actions de sa vie privée, je déclare solennellement
» que je n’ai jamais vu ou entendu quelque
» chose qui pût justifier ce soupçon d’intimité criminelle.
» Cette calomnie est une de celles que l’envie
» dirige contre un homme qui, par son propre
» mérite, s’est élevé à une haute position, et que ceux
» qui en sont jaloux croient trop volontiers. Si j’avais
» eu le moindre doute relativement à cette horrible
» accusation je l’avouerais ouvertement. Bonaparte
» est mort aujourd’hui: un historien impartial ne
» peut pas, ne doit pas accuser sans raison le père et
» l’ami d’avoir été un vil débauché. Des auteurs sans
» foi ont attesté sans preuves qu’une intimité coupable
» existait entre Bonaparte et Hortense; mensonge!
» indigne mensonge! et le bruit cependant en a été
» généralement répandu en Prusse et dans toute
» l’Europe. Hélas! serait-il vrai que la calomnie a
» des forces si puissantes que dès qu’on en a été
» atteint il n’est plus possible de s’y soustraire.»