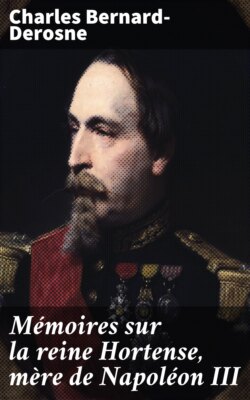Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 19
ОглавлениеCONSUL OU ROI?
Deux jours seulement s’étaient écoulés entre les fiançailles et le mariage du jeune couple. Le 7 janvier 1802, Hortense devint la femme de Louis Bonaparte. Napoléon, qui, lui-même, s’était contenté de la cérémonie civile et n’avait jamais donné à son mariage avec Joséphine de consécration religieuse, voulut que son frère et Hortense fussent unis par un lien plus sacré. Jamais mariage n’eut en effet plus grand besoin que le leur des bénédictions du Ciel! Peut-être Napoléon pensa-t-il que la conscience d’une union irrévocable pousserait les nouveaux époux à des efforts plus consciencieux et plus honorables pour arriver à une affection mutuelle; peut-être aussi eut-il l’intention d’éloigner toute idée de divorce. Quoi qu’il en soit, le cardinal Caprera, après que le mariage civil eut été signé, fut appelé aux Tuileries pour donner au jeune couple la bénédiction de l’Église.
Pas un mot, pas un regard ne fut échangé entre l’époux et l’épouse. Ils montèrent silencieusement dans la voiture qui devait les conduire chez eux. Ils habitaient la petite maison de la Rue de la Victoire, qui, pendant les premières semaines de leur union, avait été habitée par Bonaparte et Joséphine.
A cette époque, un heureux couple en avait franchi le seuil; mais celui qui, aujourd’hui, en prenait possession, n’apportait avec lui ni amour, ni bonheur. Joséphine y était entrée le visage radieux de joie; les joues d’Hortense étaient pâles, dans ses yeux brillait une larme.
Louis aussi avait été contraire à ce mariage. Il n’aimait pas sa femme. Tous deux se détestaient même. Hortense ne put jamais lui pardonner d’avoir accepté sa main, sachant que son cœur appartenait à un autre, et Louis pensait qu’elle avait mal agi en consentant à devenir sa femme, bien qu’il ne lui eût jamais dit qu’il l’aimât.
Tous deux avaient obéi à cette volonté de fer qui soumettait à ses lois, non-seulement la France, mais sa propre famille. Tous deux s’étaient mariés par obéissance, non par amour, et la conviction de cette contrainte restait entre ces deux natures, fières et indépendantes, comme une barrière insurmontable.
Ils n’essayèrent point de s’aimer, ni de trouver dans leurs cœurs le bonheur qu’il ne leur était pas permis de trouver ailleurs. Richement vêtue, mais pâle et triste, Hortense parut aux fêtes qui eurent lieu en l’honneur de son mariage. Louis reçut avec tristesse les félicitations de ses amis et des courtisans. Tandis que chacun semblait joyeux, tandis que l’on s’égayait, que l’on riait, que l’on dansait, le jeune couple seul restait triste et taciturne. Louis évitait de parler à sa femme, et elle se détournait pour qu’il ne vit pas la froide indifférence qu’exprimait son visage.
Cependant, ils étaient tous les deux forcés d’accepter leur destinée; ils étaient enchaînés l’un à l’autre, et devaient au moins essayer de supporter la vie commune. Hortense, quoique sous une apparence douce, flexible et naïve, possédait déjà un cœur fort et énergique. Elle était trop fière pour permettre à personne de la plaindre; elle se contentait de pleurer quand elle était seule et s’efforçait de sourire quand elle paraissait dans le monde, — car Duroc ne devait pas voir les traces de ses larmes.
Mais si Hortense avait banni l’amour de son cœur, la blessure qu’elle s’était faite était encore toute saignante. Si elle n’espérait plus être heureuse, sa jeunesse et son amour-propre de femme se révoltaient à l’idée de ne plus être désormais qu’une esclave; et elle se disait en elle-même:
— On doit pouvoir vivre sans être heureux, j’essayerai.
Elle essaya; elle recommença à rire et à danser, et assista aux fêtes qui se donnèrent à Saint-Cloud, à la Malmaison et aux Tuileries, et qui semblaient être le chant du cygne de la République mourante, ou la chanson de berceau dé la Monarchie naissante, — comme on voudra.
Le jour approchait à grands pas où la nation Française allait avoir à choisir entre un semblant de république et une véritable monarchie. La France avait déjà cessé d’être réellement en république. La monarchie, il est vrai, n’était encore qu’un nouveau-né, dénué de tout, mais il ne manquait qu’une main hardie, possédant un courage suffisant pour le vêtir de la pourpre, et cet enfant deviendrait alors un homme fort et puissant.
Bonaparte eut ce courage. Il eut le courage plus grand encore de le faire lentement et résolument. Il laissa l’enfant nu et sans force, grelotter quelque temps encore à ses pieds, et, pour l’empêcher de mourir de froid, il le couvrit du manteau du Consulat à vie. Sous ce manteau, l’enfant put se réchauffer et sommeiller pendant quelques mois, en attendant que ses langes de pourpre fussent préparés.
Bonaparte, par la volonté de la nation, avait été fait Consul à vie. Comme le Général Monk, il était au pied du trône, et avait l’alternative de le restituer à un roi. exilé, ou d’y monter lui-même. Les frères de Napoléon désiraient lui voir prendre ce dernier parti. Joséphine souhaitait que le contraire eût lieu. C’était une femme trop aimante pour nourrir l’espoir de conserver son bonheur au milieu des grandeurs d’une ambition trop promptement satisfaite, et trop désireuse d’assurer sa tranquillité domestique pour vouloir la risquer. Si Bonaparte se plaçait une couronne sur le front, il deviendrait naturellement le fondateur d’une nouvelle dynastie, et, pour affermir son trône, il désirerait avoir un fils. Mais Joséphine ne lui avait pas donné d’enfants; elle savait que Jérôme et Lucien avaient plus d’une fois proposé à leur frère la dissolution de cette union stérile. Pour elle donc le couronnement de Napoléon signifiait le divorce.
Elle aimait son mari d’une façon trop égoïste pour vouloir se sacrifier à son élévation. De plus, au fond du cœur elle était royaliste, et elle appelait le Comte de Lille, qui avait trouvé un asile à Hartwell, le légitime Roi de France.
Les lettres que le Comte de Lille, — plus tard Louis XVIII, — avait écrites à Bonaparte l’affectaient profondément. Elle pria son mari de répondre avec bonté et d’un ton conciliant au malheureux frère du roi décapité ; elle alla même jusqu’à conjurer Bonaparte de faire ce que Louis lui demandait: rendre à l’exilé le trône de ses pères. Napoléon avait regardé sa proposition comme une plaisanterie; il considérait comme impossible qu’on s’attendît à le voir déposer ses lauriers auprès d’un trône, qui devait être occupé par un Bourbon et non par lui.
Louis avait écrit à Bonaparte ce qui suit: —
«Je ne puis croire que le héros de Lodi, de Castiglione,
» et d’Arcole, que le conquérant de l’Italie
» et de l’Egypte ne préfère pas une gloire réelle à
» une vaine célébrité. Mais, par votre hésitation,
» vous perdez un temps précieux. Nous pourrions
» aujourd’hui assurer la grandeur de la France. Je
» dis nous, parce qu’il me faut un Bonaparte pour
» y parvenir, et parce qu’il serait incapable de le
» faire sans moi.»
Bonaparte fut d’avis qu’il pouvait mettre «Je» au lieu de «nous» ; il se sentait de force à assurer la grandeur de la France; il fit donc la réponse suivante:
«Vous ne pouvez désirer rentrer en France, puiques
» pour cela vous seriez obligé de passer sur les
» cadavres de cent mille Français. Sacrifiez-donc vos
» intérêts à la paix et au bien de votre pays. L’histoire saura
» apprécier votre conduite.»
Louis, dans sa lettre à Napoléon avait dit:
«Vous êtes libre de choisir la situation qui vous
» convient pour vous et vos amis.» Napoléon profita de la permission; mais malheureusement il choisit le poste que le Comte de Lille aurait voulu se réserver à lui-même.
Joséphine, nous le répétons, aurait été bien aise de voir le roi rentrer en France, si par cet arrangement elle eût pu conserver son mari. Elle ne désirait point de couronne; on l’admirait et on l’honorait assez sans cela. Bourienne lui dit un jour:
— Vous aurez de la peine à ne pas être reine ou impératrice.
En entendant ces paroles, Joséphine pleura et répondit:
—Mais je n’ambitionne pas d’être reine. Si je puis rester la femme de Bonaparte premier Consul, je suis satisfaite. Dites-lui cela, Bourienne, suppliez-le de pas se faire roi.
Joséphine n’en resta pas là ; elle eut elle-même le courage d’entreprendre de dissuader son mari.
Un jour que Bonaparte s’était montré particulièment gai et aimable à déjeuner, elle entra dans son cabinet sans s’être fait annoncer, et s’approchant sans bruit par derrière, elle jeta son bras autour de son cou, et s’assit sur ses genoux. Elle tint ses yeux fixés sur le pâle visage de son mari et lui caressant affectueusement les cheveux, elle lui dit:
— Je t’en supplie, Bonaparte, ne te fais point roi. Je sais que ton frère Lucien t’y engagerait volontiers, mais ne l’écoute pas.
Bonaparte se mit à rire.
— Tu vois des fantômes où il n’y en a pas, ma pauvre Joséphine; tes vieilles douairières du Faubourg Saint-Germain, et avant tout ton La Rochefoucauld, t’ont conté leurs fables. Mais elles m’ennuient, ainsi ne m’en parle plus.
Bonaparte, qui avait répondu aux conseils de sa femme par une plaisanterie évasive, commençait à parler sérieusement à ses conseillers intimes de. son projet de mettre une couronne sur sa tête. Dans le cours de la conversation sur ce sujet, Bourienne lui dit:
— Comme premier Consul, vous êtes l’homme le plus célèbre de l’Europe, mais si vous montez sur le trône, vous serez le plus jeune des rois, et rangé bien loin derrière eux tous.
Les yeux de Bonaparte s’illuminèrent en entendant cette réponse, et avec cette expression particulière qu’il savait prendre au moment d’une importante décision, il reprit:
— Le plus jeune des rois!... Eh bien! je chasserai tous les princes de leurs trônes, et je suis sûr alors d’être reconnu comme le plus ancien!