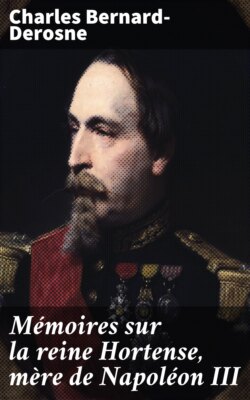Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CONSÉQUENCES DE LA RÉVOLUTION.
ОглавлениеLa France respirait encore une fois librement. Le règne de la Terreur était passé, un gouvernement plus juste et plus doux tenait les rênes de cette malheureuse nation encore palpitante. Ce n’était plus un crime qui méritait la mort de porter un nom noble, d’être mieux vêtu que les sans-culottes, de ne pas mettre le bonnet rouge, ou d’être en relation avec un émigré. La guillotine qui, pendant les deux dernières années, avait fait couler tant de larmes dans Paris, se reposait enfin de son horrible activité, et les Parisiens avaient autre chose à penser qu’à faire leur testament ou à se préparer à la mort.
Comme ils pouvaient, à tous égards, appeler l’ère présente la leur, ils voulurent se réjouir avant qu’elle ne prît fin, et avant que de nouveaux jours d’anxiété ne vinssent troubler leur sécurité si nouvelle. Ils avaient tant pleuré qu’ils avaient besoin de rire; ils étaient restés si longtemps dans le deuil et la crainte qu’il leur tardait de s’amuser. Les jeunes femmes de Paris, que la guillotine et le règne de la Terreur avaient privées de leur empire, et renversées de leur trône, eurent assez de courage pour ressaisir le sceptre qu’elles avaient laissé échapper, et reprendre la place d’où la tourmente révolutionnaire les avaient arrachées. Madame Tallien, la femme toute-puissante d’un des cinq directeurs qui étaient alors à la tête de la nation Française, Madame Récamier, l’amie de tous les hommes distingués de son siècle, et Madame de Staël, fille de Necker et femme de l’ambassadeur de. Suède, dont le pays avait seul reconnu la République Française, — ces trois dames rendirent à Paris ses salons, ses réunions, ses splendeurs, et ses modes.
Paris avait l’air complètement différent de ce qu’il avait été peu de temps auparavant. Quoique les églises ne fussent pas encore publiquement réouvertes, quelques personnes commençaient cependant à croire à l’existence de Dieu. Robespierre avait eu le courage de placer au-dessus des autels des églises transformées en temples dédiés à la Raison, cette inscription: «Il est un Être Suprême,» et il put bientôt expérimenter par lui-même qu’il ne s’était pas trompé. Trahi par ses collègues, accusé de vouloir s’élever au rang de dictateur, d’être un nouveau César pour cette nouvelle République, Robespierre fut conduit comme prisonnier devant l’odieux tribunal qu’il avait lui-même créé. Il était occupé à signer les sentences de mort à l’Hôtel-de-Ville quand une nuée de Jacobins et de gardes nationaux forcèrent la porte et vinrent l’arrêter. Il essaya de se faire sauter la cervelle avec un pistolet, mais il ne réussit pas, il s’enleva seulement un des côtés de la mâchoire.
Couvert de sang, il fut traîné devant Fouquier-Tinville pour entendre son arrêt, et pour être remis ensuite entre les mains du bourreau. Selon la coutume, il fut cependant conduit aux Tuileries où le Comité de salut public siégeait alors. Robespierre fut traîné dans cette pièce et jeté d’une façon brutale et insultante sur la grande table qui était au centre. La veille, il s’était assis à cette même table ayant plein pouvoir sur la vie et la propriété des Français, mais la veille il n’avait fait que signer des sentences de mort. Elles étaient encore là, toutes éparses, et c’était maintenant ces papiers qu’il avait pour tous bandages pour étancher le sang qui coulait à flots de sa blessure. Il était étrange de voir ces papiers boire le sang de l’homme qui les avait signés. Un sans-culotte, qui était à côté de lui, fut ému de pitié et donna à Robespierre un morceau d’un vieux drapeau tricolore, pour couvrir la blessure de son visage. En voyant le dictateur étendu et hurlant au milieu de ces papiers teints de sang, un vieux garde national leva le bras, et le dirigeant vers ce spectacle terrible, s’écria:
— Robespierre avait raison, — il y a un Être Suprême.
Le temps de la terreur et du sang était donc passé. Robespierre était mort, Théroigne de Méricourt ne représentait plus la Déesse de la Raison, et Mademoiselle Maillard avait cessé déjà d’être le type de la Liberté et de la Vertu. Les femmes étaient fatiguées de jouer le rôle de déesses, et de représenter des personnages symboliques; elles désiraient redevenir elles-mêmes, et relever encore une fois dans leurs salons, par la grâce et par l’esprit, ce trône que la Révolution avait brisé en éclats.
Madame Tallien, Madame Récamier et Madame de Staël reconstituèrent la société dans Paris, et chacun était désireux d’être admis dans leurs salons. Ces soirées et ces réunions avaient certainement un caractère étrange et attrayant; il semblait que la mode qui s’était tenue si longtemps à la carmagnole et au bonnet rouge voulût prendre sa revanche de ce long exil, en satisfaisant tous ses caprices et toutes ses extravagances, et en affectant souvent un air politique et réactionnaire. Les femmes ne s’habillèrent plus à la Jacobine, mais à la Victime et au Repentir; pour montrer le bon goût classique, elles adoptèrent les draperies des statues de l’ancienne Grèce et de l’ancienne Rome. On donnait des fêtes Grecques dans lesquelles figurait le brouet noir de Lycurgue, tandis que, dans les banquets Romains, on déployait un tel luxe et une telle profusion que ces derniers pouvaient rivaliser avec les fêtes de Lucullus.
Ces banquets Romains avaient généralement lieu au Luxembourg, où les cinq directeurs de la République s’étaient logés, et où Madame Tallien fit connaître à la nouvelle société Française ces merveilles de luxe. Trop fière pour porter la tunique de la république Grecque généralement adoptée, Madame Tallien choisit celle des patriciennes Romaines. Sa robe de pourpre flottante, brodée d’or, et le diadème éblouissant qui couronnait ses cheveux noirs comme le jais, donnaient à cette belle républicaine l’air imposant d’une Impératrice. Elle avait aussi une cour brillante autour d’elle, car chacun désirait présenter ses hommages à la toute-puissante femme du tout-puissant Tallien, et de gagner ainsi ses bonnes grâces. Sa maison devint le lieu de réunion de tous ceux qui occupaient une place importante dans Paris, et de tous ceux qui désiraient en obtenir une. Pendant que dans le salon de Madame Récamier qui, en dépit de la République, était restée royaliste, tout le monde soupirait en songeant au temps heureux de la Monarchie, et faisait des remarques caustiques sur la République, — pendant que dans le salon de Madame de Staël on ne s’occupait que de science et d’art, — dans ceux de Madame Tallien on ne songeait qu’à jouir du moment présent, et des splendeurs de la position élevée qu’occupaient les dictateurs.
Cependant Joséphine de Beauharnais et ses enfants vivaient très-retirés. Le jour vint, néanmoins, où elle fut obligée d’abandonner ses tristes réflexions sur ses malheurs, car la pauvreté frappait à sa porte; elle devait protéger ses enfants contre la faim et la misère. La Vicomtesse fut forcée d’adresser une pétition à ceux qui avaient le pouvoir de lui accorder comme une faveur ce qui n’était que son droit, et qui pouvaient lui rendre une partie de sa fortune. Joséphine avait connu Madame Tallien quand cette dernière était encore Madame de Fontenay. Elle se rappela cette connaissance pour le salut de ses enfants, car elle espérait pouvoir peut-être, par ce moyen, leur faire recouvrer l’héritage de leur père. Madame Tallien, la merveilleuse du Luxembourg, que ses admirateurs avaient aussi l’habitude d’appeler Notre-Dame de Thermidor, fut extrêmement flattée de voir une vraie Vicomtesse, qui avait occupé un rang distingué à la cour du Roi Louis XVI, réclamer sa protection; elle la reçut avec beaucoup d’affabilité et chercha à s’en faire une amie.
Cependant ce n’était pas une chose facile que de recouvrer une fortune confisquée; la République était toujours prête à prendre, mais ce n’était pas du tout son habitude de rendre, et l’amitié même de la toute-puissante Madame Tallien ne put venir au secours de Joséphine aussi vite que le réclamait son dénûment. La Vicomtesse souffrit grandement; elle dut passer avec ses enfants par la rude école du besoin et de l’humiliation qui suivent toujours la pauvreté. Mais, au milieu de cette misère, elle avait quelques amis, qui entretinrent sa table et celle de ses enfants, et leur fournirent les objets de première nécessité. En ce temps-là, on ne considérait pas comme une humiliation d’accepter l’aide de ses amis, car ceux qui avaient tout perdu ne l’avaient pas perdu par leur faute, et ceux qui avaient été assez heureux pour conserver leurs propriétés dans ce désastre général, savaient qu’ils n’avaient que le hasard à remercier, et nullement leur propre mérite ni leur prévoyance. Ils considéraient par conséquent comme un devoir sacré de partager avec ceux qui avaient été moins heureux qu’eux, et ces derniers pouvaient,accepter sans rougir les offrandes de l’amitié. La Révolution avait donné, naissance à une espèce de communisme.
Joséphine accepta donc avec beaucoup de reconnaissance, et sans rougir, les prévenances de ses amis: Elle permit à Madame de Montmorin de l’habiller ainsi qu’Hortense, et elle accepta les invitations qui, deux fois par semaine, la conviaient à la table de Madame Dumoulin. Dans la maison hospitalière de cette dame on rencontrait, à certains jours, nombre de personnes que la Révolution avait privées de tous leurs biens. Madame Dumoulin, femme d’un riche fournisseur des armées, faisait ces jours-là préparer à dîner pour ses amis, mais chaque hôte devait apporter son pain avec lui, cet aliment étant considéré comme un grand luxe à cette époque. Le blé était si rare à Paris que la République édicta une loi d’après laquelle, dans chaque section de Paris, on ne devait cuire qu’un certain nombre de pains par jour et chaque individu n’avait droit qu’à deux. Dans de pareilles circonstances, il était très-ordinaire d’ajouter à chaque invitation: «Vous êtes prié d’apporter votre pain,» car souvent il était impossible de se procurer cet aliment en plus grande quantité que le gouvernement ne le permettait, et de plus il était extrêmement cher. Joséphine Beauharnais cependant n’était pas assez riche pour acheter les deux onces auxquelles elle avait droit; elle était la seule qui vînt aux dîners de Madame Dumoulin sans son pain; mais son aimable hôtesse s’arrangeait toujours de façon à trouver un pain pour elle et pour la petite Hortense.
Le temps était venu où la Vicomtesse de Beauharnais allait voir la fin de sa misère. Un jour, en dînant chez Madame Tallien, le dictateur lui dit que, par son intervention, «le gouvernement voulait faire quelques concessions en faveur de la veuve d’un vrai patriote, qui était devenu victime des erreurs du temps,» et qu’il avait donné un ordre à l’administration des domaines, grâce auquel les scellés seraient levés de toutes ses propriétés mobilières. La République lui donnait aussi un mandat, payable par le Trésor, et lui promettait que ses biens seraient prochainement libérés du séquestre.
Joséphine ne put trouver de paroles pour exprimer ses remerciements; elle pressa sa fille sur son cœur et s’écria au milieu de ses larmes:
— Nous allons encore être heureux, puisque mes enfants ne souffriront plus du besoin!
C’étaient les premières larmes de joie que Joséphine versait depuis bien des années.
La misère n’était plus à craindre. Joséphine pouvait donner à ses enfants une éducation en rapport avec leur rang, et elle-même pouvait maintenant occuper dans le monde cette place à laquelle sa naissance, son éducation et son amabilité lui permettaient de prétendre. Elle ne vint plus comme une solliciteuse chez Madame Tallien, mais elle était actuellement la reine de ce salon, et chacun s’empressait de rendre hommage à la jeune et belle Vicomtesse que l’on savait être l’amie intime de la maison. Mais Joséphine préférait la compagnie de ses enfants aux brillantes réunions de la meilleure société ; elle se retira de plus en plus de cette vie bruyante pour se vouer à ses chers enfants, dont les caractères devenaient de jour en jour plus prononcés et plus intéressants.
Eugène était alors un jeune homme de seize ans, et comme il n’y avait plus nécessité de renier son rang et de cacher son nom, il demanda à reprendre l’un et l’autre;.il quitta donc la boutique de son maître, et il abandonna la blouse. Guidé par d’excellents professeurs, il se préparait à entrer dans l’armée, et il les étonnait par son zèle et ses dispositions extraordinaires. La gloire de la guerre et les actions d’éclat des Français remplissaient son cœur d’enthousiasme, et un jour qu’un de ses maîtres lui racontait les hauts faits de Turenne, Eugène s’écria les yeux brillants:
— Moi aussi, je serai un jour un grand général!
A la même époque, Hortense avait douze ans et vivait avec sa mère qui n’avait que trente ans, plutôt comme une jeune sœur que comme une fille. Elles étaient toujours ensemble. La nature avait doué Hortense d’une grande beauté, et sa mère sut lui inculper la grâce et la douceur qui devaient compléter cette beauté. D’habiles professeurs instruisaient son esprit, pendant que Joséphine instruisait son cœur. Accoutumée de bonne heure à l’infortune, au besoin, à la misère, l’enfant n’avait pas ces dispositions légères et insoucieuses que l’on rencontre communément chez les jeunes filles de son âge. Elle avait trop vu l’instabilité et la vanité des grandeurs de la terre pour ne pas mépriser toutes ces bagatelles si généralement prisées par les jeunes filles. Elle ne mettait pas son ambition à s’habiller d’une façon élégante et à se plier à tous les caprices de la mode. Elle connaissait de plus grands plaisirs que ceux de la vanité, et elle n’était jamais si heureuse que lorsque sa mère refusait pour elle les soirées de Madame Tallien ou de Barras. Elle s’amusait alors avec ses livres et sa harpe, et ces distractions lui plaisaient infiniment plus que celles qu’elle aurait pu trouver dans les salons des puissants du jour.
A l’école du malheur Hortense avait acquis une raison prématurée, qui donnait à cette jeune fille de douze ans la gravité et l’indépendance des sentiments d’une femme; mais ses traits admirables portaient encore l’expression de l’enfance, et il y avait tout un ciel de paix et d’innocence dans son profond œil bleu.
Quand à l’heure du crépuscule elle s’asseyait dans l’embrasure d’une fenêtre, avec sa harpe à côté d’elle, — quand les derniers rayons du soleil couchant doraient ses traits et mettaient une auréole autour de sa tête, — on aurait pu la prendre pour un de ces anges d’innocence et d’amour que le pinceau de l’artiste ou les vers du poëte nous ont révélés. Joséphine avait l’habitude d’écouter avec une espèce de dévotion les douces mélodies que sa fille tirait de sa harpe, auxquelles elle mariait, avec sa voix charmante, les vers qu’elle avait faits elle-même, vers passionnés, mais pleins d’une innocence enfantine. Ces vers étaient le miroir fidèle de ses sentiments intimes, la véritable image de cette jeune fille chaste et. pure qui était arrivée à la limite «où le ruisseau devient rivière, où commence la femme et où finit l’enfant.»