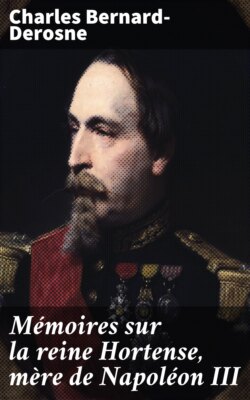Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 7
LA PROPHÉTIE.
ОглавлениеCe fut vers la fin de 1790 que Joséphine arriva à Paris avec sa fille Hortense; elle se logea dans un modeste hôtel. Elle apprit bientôt après que sa mère avait été sauvée, et que la tranquillité avait été rétablie à la Martinique. En France, cependant, la Révolution continuait avec une fureur toujours croissante, et la guillotine et le drapeau rouge de la Terreur étendaient leur ombre sanglante sur Paris. La crainte et l’effroi s’étaient emparés de tous les cœurs; personne ne pouvait dire le soir s’il serait libre le lendemain matin, et s’il vivrait jusqu’au coucher du soleil. La mort veillait à chaque porte, et trouvait de nombreuses victimes dans chaque maison, presque dans chaque famille. Au milieu de telles horreurs, Joséphine oublia les querelles et les humiliations du passé ; son ancien amour pour son mari_se réveilla, et, comme elle n’était pas sûre de vivre le lendemain, elle désira employer le moment présent à se réconcilier avec son mari, et à embrasser encore une fois son fils.
Mais toutes les tentatives pour aboutir à cette réconcialiation semblaient devoir être inutiles. Le vicomte avait regardé son départ pour la Martinique comme une telle insulte, comme un acte de cruauté si délibérée, qu’il paraissait ne jamais plus vouloir rouvrir les bras à son épouse. Quelques bons amis des jeunes gens, finirent enfin par amener une entrevue, quoique sans consulter M. de Beauharnais. Sa colère fut par conséquent très-grande, lorsque, en entrant dans le salon du Comte de Montmorin, il se trouva en présence de sa femme, Joséphine, qu’il avait évitée si obstinément. Il allait quitter le salon quand une petite fille se précipita vers lui, les bras ouverts, en l’appelant «papa.» Le vicomte s’arrêta tout à coup, et il ne lui fut plus possible de conserver sa colère. Il souleva la petite Hortense et la pressa sur son cœur. Elle lui demanda innocemment d’embrasser sa mère comme il l’avait fait pour elle. Il regarda sa femme dont les yeux étaient remplis de larmes et quand il vit son père s’approcher et lui dire: — «Mon fils, réconciliez-vous avec ma fille; je ne lui donnerais pas ce nom si elle n’en était pas digne,» quand il vit Eugène s’élancer dans les bras de sa mère, — il ne put résister davantage. Tenant toujours Hortense dans ses bras, il s’avança vers sa femme qui cacha sa figure dans sa poitrine, en poussant un cri de joie.
La paix fut ainsi conclue, et le couple réuni s’aima plus tendrement qu’il ne l’avait jamais fait. Il semblait que leurs querelles de ménage étaient passées, pour ne plus revenir, et qu’à partir de ce moment rien ne devait plus les séparer. Mais la Révolution devait bientôt détruire leur récent bonheur.
Le Vicomte de Beauharnais avait été choisi par la noblesse de Blois pour la représenter aux États-Généraux, mais il avait renoncé à cet honneur pour servir son pays avec son épée au lieu de la servir par sa parole. Malgré les larmes et les prières de Joséphine, il partit pour l’armée du Nord dans laquelle il occupa le rang d’adjudant-général. L’épouse entendait dans son cœur une voix qui lui disait qu’elle ne devait plus le revoir, et cette voix ne la trompait pas. L’esprit d’anarchie et de rébellion régnait non seulement dans le peuple, mais encore dans l’armée qui était sous son influence. Les aristocrates, qui, à Paris, tombaient sous la hache du bourreau, étaient regardés par les soldats avec des yeux méfiants et remplis de haine; et c’est ainsi qu’il arriva qué lé Vicomte de Beauharnais qui, en récompense de sa bravoure à la bataille de Soissons, avait été élevé au rang de commandant en chef, fut peu de temps après accusé par ses propres officiers d’être ennemi de son pays et hostile au nouveau régime. Il fut arrêté et envoyé prisonnier à Paris, où on le logea dans les prisons du Luxembourg, avec un grand nombre d’autres victimes de la Révolution.
Joséphine apprit bientôt le malheureux destin de son mari, et ces tristes événements forcèrent son dévouement et son amour à agir. Elle résolut de sauver son mari, le père de ses enfants, ou de mourrir avec lui. Sans songer au péril, elle brava tous les dangers, toutes les craintes qui auraient pu la détourner de son entreprise, et elle usa de tous les moyens en son pouvoir pour obtenir une entrevue avec son époux et lui apporter des consolations.
Mais en ce temps, on regardait même l’amour et la fidélité comme des crimes méritant la mort, et par conséquent, deux fois coupable,— d’abord, parce qu’elle était aristocrate elle-même; et, ensuite, parce qu’elle aimait un noble, traître à sa patrie —Joséphine fut arrêtée et envoyée en prison à Sainte-Pélagie.
Eugène et Hortense pouvaient être considérés comme orphelins, car à cette époque, les prisonniers du Luxembourg et de Sainte-Pélagie ne quittaient leurs cachots que pour monter à l’échafaud. Isolés, privés de tous secours, abandonnés par ceux qui avaient été autrefois leurs amis, ces deux enfants étaient exposés à la faim et à la misère. La fortune de leurs parents avait été confisquée à l’heure même où Joséphine avait été jetée en prison, toutes les portes de leur maison avaient été mises sous les scellés, de sorte que les pauvres enfants n’avaient pas même un toit pour s’abriter. Cependant ils ne furent pas tout à fait abandonnés, car une amie de Joséphine, Madame Holstein, eut le courage de venir en aide aux malheureux enfants et de les garder chez elle.
Il était nécessaire d’agir avec précaution pour ne pas éveiller les soupçons et la haine de ceux qui, sortis des bas-fonds de la populace, étaient devenus les gouvernants de la France, et qui teignaient la pourpre de leur pouvoir dans le sang de l’aristocratie. Un mot inconsidéré, un regard aurait suffi pour faire soupçonner Madame Holstein, et la conduire à l’échafaud. On regardait comme un crime d’adopter les enfants des traîtres; il était donc absolument nécessaire de tout faire pour éloigner les soupçons de ceux qui étaient au pouvoir. Hortense fut obligée de se joindre avec sa protectrice aux processions solennelles de chaque décade, en honneur de la République une et indivisible; mais elle ne fut jamais appelée à prendre une part active dans ces fêtes. On ne la jugeait pas digne de marcher de pair avec les filles du peuple; on ne lui pardonnait pas d’être la fille d’un vicomte, d’un ci-devant emprisonné. Eugène fut mis en apprentissage chez un menuisier, et l’on put voir souvent le fils d’un gentilhomme vêtu d’une blouse, et portant une pièce de bois sur son épaule, une scie ou un rabot sous son bras.
Pendant que les enfants passaient ainsi leur vie dans une sécurité momentanée, l’avenir de leurs parents devenait de plus en plus sombre, car ce n’était pas seulement la vie du Général de Beauharnais, mais encore celle de sa femme, qui était sérieusement menacée. Joséphine avait été transportée de la prison de Sainte-Pélagie au couvent des Carmélites, et avait ainsi fait un pas vers la guillotine. Elle ne tremblait pas pour elle-même, elle pensait seulement à ses enfants et à son mari. Elle écrivait aux premiers des lettres très-tendres, qu’elle leur faisait parvenir par un geôlier qu’elle avait gagné, mais tous ses efforts pour communiquer avec son mari furent inutiles.
Tout à coup elle reçut avis qu’il avait été conduit devant le tribunal révolutionnaire. Joséphine attendait dans une cruelle anxiété de plus amples détails. Le tribunal l’avait-il acquitté ? Avait-il été condamné à mort? Etait-il libre? Etait-il délivré d’une autre manière—était-il mort? S’il eût été libre il aurait trouvé moyen de l’informer de son bonheur; s’il avait été exécuté, pourquoi son nom n’était-il pas sur la liste des condamnés? Joséphine passa toute une journée d’angoisses, et quand la nuit vint, il ne lui fut pas possible de fermer l’œil. Elle s’assit avec ses compagnons d’infortune, qui tous, comme elle, s’attendaient à mourir bientôt.
Les personnes qui étaient réunies dans cette prison étaient de rang et de naissance. C’étaient la Duchesse Douairière de Choiseul, la Vicomtesse de Maillé , dont le fils, malgré ses dix-sept ans, venait de monter sur l’échafaud, — la Marquise de Créqui, cette femme spirituelle qu’on a souvent nommée la dernière Marquise de l’ancien régime, et qui nous a laissé dans ses mémoires, écrits il est vrai à un point de vue tout aristocratique, l’histoire de France pendant le XVIIIe siècle. Il y avait aussi cet Abbé Terrier, qui, lorsqu’il fut appelé devant les propagateurs de la terreur pour donner un gage de fidélité au nouveau gouvernement, et menacé sur son refus de le faire, d’être pendu à la lanterne, demanda à ceux qui l’entouraient: «Y verriez-vous plus clair?» Avec toutes ces personnes se trouvait aussi un Monsieur Duvivier, élève de Cagliostro, qui, comme son maître, pouvait deviner l’avenir, et déchiffrait les mystérieuses énigmes du destin à l’aide d’une carafe d’eau et d’une colombe, c’est-à-dire d’une jeune fille innocente au-dessous de sept ans. Joséphine s’adressa à lui, comme au Grand Cophte, après ce jour d’angoisses, et lui demanda de lui révéler le sort de son mari.
Ce fut une scène étrange, que celle qui se passa dans le silence de la nuit, dans cette froide et obscure prison. Le geôlier, gagné par un assignat de cinquante livres, qui valait alors à peu près quarante sous, avait consenti à ce que sa fille jouât le rôle de la colombe, et avait fait tous les préparatifs nécessaires. Au milieu de la chambre était une table, sur laquelle on avait placé une carafe remplie d’eau, et trois bougies en triangle. Ces bougies étaient placées aussi près que possible de la carafe, pour permettre à la colombe de voir plus distinctement. La petite fille venait d’être réveillée, et elle s’assit sur une chaise près de la table, vêtue de sa robe de nuit; derrière elle, se tenait l’imposant prophète. Les Duchesses et les Marquises, qui peu de temps au paravant, avaient fait partie d’une cour brillante, et qui conservaient même en cet endroit, l’étiquette et les manières de Versailles, s’étaient rangées tout autour. Celles qui avaient joui de l’insigne privilège du tabouret, avaient le pas sur les autres et étaient traitées avec tout le respect possible. De l’autre côté de la table, la malheureuse Joséphine se tenait debout, pâle, et suivant des yeux avec une anxiété terrible l’expression des traits de la jeune fille; dans le fond, on apercevait les figures du geôlier et de sa femme.
Le prophète étendit les deux mains sur la tête de l’enfant et dit d’une voix forte:
— Ouvre les yeux et regarde.
L’enfant devint pâle et tressaillit en regardant la carafe.
— Que vois-tu? — demanda le Cophte. — Je t’ordonne de pénétrer dans la prison du Général de Beauharnais... que vois tu?...
— Je vois — répondit l’enfant très-émue — un jeune homme qui dort sur un lit de camp. A côté de lui, il y a un homme qui écrit quelque chose sur une feuille de papier posée sur un grand livre.
— Peux-tu lire?
—Non, citoyen! Oh!... regardez... le gentilhomme coupe une mèche de ses cheveux, et la met dans du papier.
— Celui qui dort?
— Non, non, celui qui vient d’écrire. Il recommence à écrire, il écrit quelque chose sur le papier dans lequel il met ses cheveux; maintenant il prend un petit portefeuille rouge, il l’ouvre, il compte quelque chose: à présent il referme le portefeuille, et il marche sans aucun bruit... sans aucun bruit...
— Comment sans bruit...? avais-tu entendu du bruit auparavant?
— Non, mais il marche sur la pointe des pieds
— Que vois-tu maintenant?
— Il cache sa figure dans ses mains, je crois qu’il pleure.
— Où met-il son portefeuille?
— Parbleu, il le met dans la poche de l’habit de celui qui dort, et la lettre aussi.
— De quelle couleur est l’habit?
— Je ne puis le voir parfaitement; mais je crois qu’il est rouge ou mauve avec des boutons luisants.
—C’est assez, enfant, dit le devin; retourne à ton lit.
Il se baissa vers la petite fille et lui souffla sur le front. Elle se réveilla comme si tout cela n’était qu’un songe, et ses parents l’emmenèrent.
— Le Général de Beauharnais est encore vivant, — dit le grand Cophte, en s’adressant à Joséphine.
— C’est vrai, — dit-elle tristement. — mais il se prépare à mourir.
Elle avait raison; quelques jours plus tard, la Duchesse d’Anville reçut une lettre et un paquet, envoyés par un prisonnier de la Force, dont le nom était de Ségrais. Il avait été emprisonné avec le Vicomte de Beauharnais, et le jour de l’exécution du Général, il avait trouvé la lettre et le paquet adressés à la Duchesse dans la poche de son habit.
Dans cette lettre, Beauharnais priait la Duchesse de faire remettre à sa femme le paquet qui contenait une mèche de ses cheveux, et ses derniers adieux à elle et à ses enfants.
Ce fut le seul héritage que le Général laissa à sa famille. Quand Joséphine reçut ces gages d’affection, son chagrin fut si vif qu’elle s’évanouit, et qu’une écume sanglante parut sur ses lèvres. Ses compagnons d’infortune s’empressèrent de la secourir autant qu’ils le purent, et prièrent le geôlier d’aller chercher un médecin.
— A quoi bon un médecin? — dit cet homme d’un ton indifférent. — La mort est le meilleur docteur. Aujourd’hui même elle a guéri le Général, demain ou après demain, elle guérira sa femme.
Cette prophétie fut presque réalisée. Joséphine était à peine remise, qu’elle reçut l’acte d’accusation du Tribunal Révolutionnaire. C’était le signe certain d’une mort prochaine, et Joséphine se prépara à la subir courageusement, quelque peine qu’elle ressentît en pensant à ses enfants qui allaient rester orphelins.
Un événement inattendu lui sauva la vie. Les chefs des terroristes étaient arrivés à l’apogée de leur pouvoir, et une pareille fortune ne pouvait être très-stable; ils furent précipités de cette hauteur, et tombèrent dans l’abîme qu’ils avaient eux-mêmes creusé.
La chute de Robespierre ouvrit les prisons à des milliers de gens que l’on considérait déjà comme les victimes de la Révolution. La Vicomtesse de Beauharnais fut mise en liberté, et on lui permit de rejoindre ses enfants; mais elle quitta la prison, veuve et sans argent, car sa fortune, aussi bien que celle de son mari et de tous les aristocrates, avait été confisquée par la République une et indivisible.