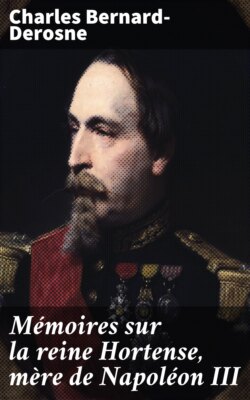Читать книгу Mémoires sur la reine Hortense, mère de Napoléon III - Charles Bernard-Derosne - Страница 15
BONAPARTE REVIENT D’EGYPTE.
ОглавлениеBonaparte était revenu d’Egypte. La victoire d’Aboukir avait ajouté un nouveau laurier à ceux qui couronnaient déjà son front. Toute la nation Française salua le retour du héros. Hortense, pour la première fois, fit partie des fêtes que la ville de Paris offrit à son beau-père; elle vit, pour la première fois, les hommages rendus au vainqueur de l’Égypte par les vieillards et les jeunes gens, par les hommes et les femmes de l’élite de la société.
Ces fêtes et ces ovations l’alarmèrent presque, tout en remplissant son cœur de joie. La jeune fille se rappelait la prison dans laquelle sa mère avait langui, l’échafaud sur lequel son père était mort, et, souvent, en regardant l’uniforme brodé de son frère, elle pensait au temps où Eugène, apprenti menuisier, traversait les rues de Paris, vêtu d’une blouse et portant une planche sur son épaule.
Le souvenir des tristes années de son enfance empêcha l’orgueil et la fierté de s’emparer de son cœur. Elle garda cet esprit de modestie et de douceur qui, en la garantissant de la présomption dans le bonheur, lui donna du courage dans l’adversité. Elle ne compta jamais sur une grandeur perpétuelle; ses souvenirs d’enfance lui firent toujours voir la réalité ; aussi, quand arrivèrent les orages de la vie ils la trouvèrent prête à les combattre.
Elle profitait de ces jours radieux, elle était heureuse de voir sa mère bien-aimée porter un diadème de gloire et d’amour, et, en pensant à son père mort sur l’échafaud, elle ressentait la plus profonde gratitude pour le Général Bonaparte, qui avait rendu si brillante l’existence d’une femme si malheureuse dans son premier mariage.
Mais, hélas! de nouveaux nuages allaient bientôt obscurcir leur bonheur et troubler leur tranquillité. Une révolution devint imminente; la France allait encore être le théâtre de la guerre civile, et Paris eut bientôt l’aspect d’un camp, divisé en deux partis cherchant à s’écraser mutuellement. D’un côté étaient les républicains démocrates, qui regrettaient le terrorisme parce que la paix leur enlevait le pouvoir, et qui voulaient consolider la République par le régime de l’échafaud. Ce parti appela les sans-culottes et les républicains exaltés pour défendre la nation. Ils déclarèrent que la liberté et la constitution étaient en danger, et désignèrent Napoléon d’une main menaçante comme celui qui voulait renverser la République, et charger de nouveau la France des chaînes de la tyrannie.
De l’autre côté étaient les patriotes prudents, les républicains par force, qui, au fond, détestaient la République, et qui ne lui avaient juré fidélité que pour sauver, leurs têtes de la guillotine. C’étaient des gens d’esprit, des artistes, des poëtes, qui désiraient une nouvelle ère, parce qu’ils savaient bien que le règne de la terreur et de la démocratie est aussi fatal aux muses qu’à la vie et aux propriétés des hommes. De ce côté étaient aussi les marchands, les propriétaires, les banquiers, les commerçants, qui tous désiraient voir la République établie sur des bases plus modérées, afin de croire à sa stabilité, et de pouvoir recommercer leurs travaux et leurs affaires avec une plus grande chance de succès. A la tête de ce parti modéré était Bonaparte.
Le 18 Brumaire fut le jour décisif. Un grand combat, quoique peu sanglant, fut livré. Les principes surtout, et non pas les hommes, furent tués.
Le Conseil des Anciens, le Conseil des Cinq-Cents, le Directoire, la Constitution de l’an III, tout fut renversé et des ruines de la République rouge, souillée de sang, s’éleva la République modérée de 1798. Trois Consuls la dirigeaient: Bonaparte, Cambacérès et Lebrun.
Le 19 Brumaire, les trois Consuls firent leur entrée au Luxembourg, au milieu des acclamations du peuple, et dormirent vainqueurs dans les lits occupés la veille par les membres du Directoire.
Une nouvelle ère date de ce jour. L’étiquette, qui, pendant la durée de la République démocratique, s’était cachée dans les coins les plus obscurs du Luxembourg et des Tuileries, commença à reparaître au grand jour. On n’était plus forcé de confondre, pour rendre hommage au principe d’égalité, le rang et l’éducation, en se servant du mot: «Citoyen;» le peuple n’était plus obligé de supporter, au nom de la fraternité, la familiarité insolente des héros de la rue; et on n’exigeait plus que personne sacrifiât sa liberté personnelle et son bien-être sur l’autel de la liberté.
L’étiquette avait donc reparu. On appelait les trois Consuls: «Monsieur;» et Joséphine, qui vint le lendemain avec sa fille occuper les appartements préparés pour elles au palais du Luxembourg, fut appelée: «Madame.» Un an auparavant les mots Monsieur et Madame auraient été cause de soulèvements et de sang répandu. Le Général Augereau avait adressé un ordre du jour à sa division, dans lequel il interdisait les mots Monsieur et Madame soit en parole, soit en écrit, et il avait menacé ceux qui n’obéiraient pas à ses ordres de les chasser de l’armée comme indignes de servir sous les drapeaux de la République.
Ces mots proscrits rentrèrent avec les trois Consuls au Luxembourg, qui avait été délivré des tyrans démocratiques.
Joséphine était maintenant, à tous égards, Madame Bonaparte, Hortense, Mademoiselle de Beauharnais; et Madame Bonaparte pouvait avoir un plus grand nombre de serviteurs, et vivre d’une façon plus brillante qu’elle ne l’avait fait jnsqu’ici. Pour dire vrai, il n’y avait pas encore de cour ni de dames d’honneur, et le Luxembourg n’était pas une très-spacieuse résidence; mais le jour était proche où Monsieur et Madame Bonaparte allaient changer leur humble titre contre celui de «Majesté,» et où les Tuileries allaient recevoir les hôtes du Luxembourg.
Ce dernier palais fut bientôt trop petit pour les trois Consuls; trop petit pour l’ambition de Bonaparte, qui n’aimait pas à vivre aussi près de ceux qui partagaient son pouvoir; trop petit pour la réalisation des désirs qui s’élevaient maintenant distinctement dans le cœur de Bonaparte, et qui le poussaient en avant dans la carrière des grandeurs. Il savait alors ce à quoi il avait aspiré ; ce qui, peu de temps auparavant lui apparaissait comme la fata Morgana de ses rêves, était maintenant l’objet d’une mûre réflexion. Cependant ce n’était pas une tâche facile que de s’ouvrir le chemin du palais des Bourbons! Jusqu’alors les représentants du peuple avaient siégé aux Tuileries: il était impossible de renvoyer tous ces hommes d’un seul coup; une telle mesure aurait fait surgir des soupçons dans tous les cœurs des vrais républicains, auxquels il fallait cacher avec beaucoup de soin le désir d’établir une monarchie. Il était nécessaire, avant d’aller aux Tuileries, de faire croire au peuple qu’un homme peut être bon républicain, tout en ayant le désir d’aller habiter la demeure des Rois.
Avant que les Consuls ne changeassent de résidence, le Palais des Tuileries fut orné et distribué de façon à remplir sa nouvelle destination. On plaça le buste de Brutus, qui avait été rapporté d’Italie par Napoléon, dans une de ses galeries; et David fut chargé de faire exécuter plusieurs autres statues des héros des Républiques Grecque ou Romaine qui furent placées dans d’autres salons.
Nombre de républicains, qui avaient été exilés après le 13 Vendémiaire purent rentrer en France; et comme justement la nouvelle de la mort de Washington venait d’arriver, Napoléon fit porter le deuil pendant dix jours à l’armée. Chaque soldat devait porter un crêpe au bras, et les drapeaux et les trompettes furent également revêtus des mêmes insignes de deuil. Quand ces dix jours furent terminés, quand la France et son armée eurent suffisamment manifesté leur chagrin de la mort du grand républicain, les trois Consuls firent leur entrée aux Tuileries. Ils entrèrent par la grande porte de face, de chaque côté de laquelle était planté un arbre de la liberté qui portait les inscriptions républicaines de 1792. Sur l’arbre de droite il y avait cette date: «10 août;» sur l’arbre de gauche il y avait cette phrase: — «La Royauté a été détruite en France, et elle n’y sera jamais rétablie!»
Bonaparte et ses collègues passèrent entre ces deux arbres pour entrer aux Tuileries: une longue file de voitures les suivait et animait les rues de Paris; mais la splendeur et la magnificence qui caractérisèrent plus tard les solennités de la France Impériale faisaient complètement défaut en cette circonstance. 11 n’y avait qu’une brillante voiture: c’était celle qui contenait les Consuls, et qui était traînée par les six chevaux blancs que l’Empereur d’Autriche avait donnés à Napoléon. La plupart des autres voitures étaient des fiacres dont les numéros avaient été recouverts de papier. La nouvelle France n’avait pas encore eu le temps de faire construire des voitures de gala, et celles de la vieille France avaient été si horriblement abîmées qu’elles étaient pour toujours hors d’état de servir. En Septembre 1793, elles avaient servi de tombereaux pour transporter des chiens morts.
A cette époque il y avait dans Paris des milliers de chiens sans maîtres, qui avaient appartenu précédemment à l’aristocratie, et qui alors erraient dans les rues, se nourrissant du sang qui coulait à torrents de la guillotine, et qui teignait les rues de Paris. Cette horrible nourriture avait rendu à ces chiens leur férocité et leur soif de sang natives. Les personnes qui avaient été assez heureuses pour échapper à l’échafaud étaient alors en danger d’être déchirées en morceaux par ces animaux furieux, qui ne faisaient pas de distinction entre les aristocrates et les républicains, et les attaquaient tous indistinctement: il devint donc nécessaire de détruire ces nouveaux ennemis de la République. En conséquence la force armée entoura les Champs-Élysées, conduisit les chiens dans la Rue Royale, et là on les tua à coups de fusil. Dans un seul jour on en tua plus de trois mille et leurs corps restèrent épars dans la rue. Ils y demeurèrent trois jours: une discussion s’étant élevée entre les autorités pour décider qui devait les enlever.
A la fin, poussée par la nécessité, la Convention prit sur elle d’examiner la chose, et elle donna des ordres à M. Gasparin qui dut prendre les mesures nécessaires. Ce fonctionnaire s’arrangea pour convertir l’ensevelissement des chiens en une démonstration républicaine. Comme ces animaux avaient appartenu aux ci-devants, on devait les conduire à leurs tombeaux avec les honneurs aristocratiques.
Gasparin rassembla toutes les voitures de gala de la noblesse guillotinée ou exilée, et dans ces splendides voitures portant encore les armoiries de leurs maîtres, il plaça les restes des chiens. Six voitures royales ouvraient la marche, et derrière les brillants panneaux des portières on pouvait voir les queues, les pattes et les têtes des victimes de la Rue Royale entassées en désordre.
Après cette démonstration de la France républicaine, il fut impossible de se servir des voitures de la noblesse, et, par conséquent, les équipages convenables furent rares le jour de l’entrée des Consuls aux Tuileries.
La Révolution finit au moment où Napoléon entra aux Tuileries. Bonaparte plaça son épée victorieuse sur l’abîme sanguinaire qui avait englouti sans distinction le sang des nobles et celui des roturiers; il fit de cette épée un pont sur lequel la nation passa d’un siècle à l’autre, et de la République à l’Empire.
Lorsque le lendemain de son arrivée aux Tuileries, Napoléon se promena avec Joséphine et Hortense dans la Galerie de Diane pour examiner les statues qu’il y avait fait placer, il s’arrêta devant le buste du jeune Brutus, à côté duquel se trouvait une statue de César. Bonaparte, pensif, regarda longtemps ces deux figures; puis, comme s’il sortait d’un rêve, il releva fièrement la tête, et plaçant sa main sur l’épaule de Joséphine, il dit d’une voix énergique:
— Ce n’est pas assez d’être aux Tuileries, un homme comme moi doit savoir y rester! Combien de personnes ont déjà passé dans ce palais! Oui, des bandits et des Conventionnels. N’ai-je pas vu de mes yeux comment les Jacobins et les bandes de sans-culottes ont assiégé le Roi Louis XVI et l’ont emmené prisonnier? Mais ne crains rien, Joséphine, qu’ils y viennent à présent!
Pendant que Bonaparte parlait ainsi en demeurant devant les statues de Brutus et de Jules César, sa voix résonnait comme un tonnerre dans la longue galerie, et faisait trembler sur leurs piédestaux les statues des héros des anciennes républiques.
Napoléon leva son bras d’une façon menaçante vers le buste de Brutus comme s’il eût voulu défier, dans la personne de ce farouche républicain qui assassina César, la France républicaine, de laquelle il voulait être tout à la fois le César et l’Auguste.
La Révolution était terminée; Bonaparte vivait aux Tuileries avec sa femme et ses enfants. Le fils et la fille de ce Général Beauharnais que la République avait guillotiné avaient trouvé un second père qui était destiné à venger ce meurtre sur la République elle-même.
La Révolution était donc définitivement terminée.