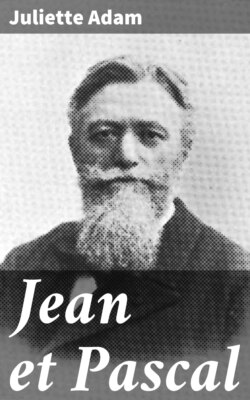Читать книгу Jean et Pascal - Juliette Adam - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
JEAN A PASCAL.
ОглавлениеTable des matières
Brieg, 1er octobre.
Merci de tes deux lettres qui sont pour moi pleines d’invitation à la pensée, lorsque j’aurai le temps de me recueillir.
Ah! tu trouves des druidesses qui ressemblent à Madeleine! Voilà une découverte que tu n’emporteras pas au cercle d’Abred. Si j’étais moins généreux, je dirais... Non, je me tais, la générosité étant silencieuse.
Je recopie mes notes à Brieg, et je te les adresse dans leur suite.
Nous quittons Lausanne et faisons en chemin de fer un petit voyage au bord du Lac.
Ma jolie sœur continue de médire sur les montagnes de l’Helvétie, qui ne sont pas une suite majestueuse de sommets, qui sont bien plutôt un fouillis de dents, de pics, de hachures déchiquetées, de blocs sans contours, de masses informes. Point de lignes, point de dessin; rien de noble, partant rien de beau!
Le paysage suisse, recommence Madeleine, ne peut fournir qu’au crayon noir et à la sculpture sur bois, il est indigne de la peinture. Elle nie l’école suisse et prétend, non sans raison, que tous les peintres de talent, nés dans la verte Helvétie, ont peint des paysages italiens.
A Sierre nous prenons un voiturin.
Madeleine regarde autour d’elle et se tait. Le paysage, vraiment grandiose, est inattaquable. Il serait par trop humiliant d’en convenir. La couleur est encore un peu brusque, un peu tranchée, selon l’expression de la petite Mademoiselle, mais les gorges ont un caractère de sauvagerie qui défie toute satire. Le Rhône, écumant, lumineux, maître de ses rives, court avec emportement vers notre France.
Dans la gorge de Pfin je montre à Madeleine un torrent qui coupe le flanc noir d’une haute cime et tombe en poussière d’eau, en nuage de rosée, à pic sur le Rhône. Plus loin le soleil couchant lèche en langues de feu un magnifique sommet de granit rouge, la Jemmie, pierre précieuse sertie dans des coulées de neige.
Les montagnes, en effet, sont moins hachées, moins déchiquetées. Elles prennent des physionomies, des figures, et se penchent sur le Rhône profond. Elles sont sœurs de l’abîme, y plongent, l’interrogent.
Ici, un grand sphinx pose au fleuve une énigme à laquelle chaque flot se hâte d’échapper. Plus loin, un homme couché, la tête levée, regarde passer le temps sur les hauteurs. Que cette gorge est resserrée! Le Rhône seul a pu la creuser à force de violence, de luttes incessantes, d’assauts hardis contre de telles roches.
Des prairies marécageuses, fleuries dans chaque brin d’herbe, nourrissent d’admirables troupeaux de chèvres luisantes, à la longue soie noire ou blanche. Les vaches brunes et rousses descendent des collines et secouent leurs colliers de clochettes qui tintent avec des notes pressées dans l’air du soir.
La nuit vient, monte du fond de la gorge, étend ses voiles sur les eaux du fleuve, habille d’ombres le pied et les flancs des montagnes, et nous entoure d’une brume grise, tandis que le soleil empanache encore les cimes de ses dernières flammes.
Notre mère s’endort. J’ouvre mon carnet, je t’écris. Madeleine me demande si c’est pour toi que je prends toutes ces notes. Je réponds «oui». Elle me gronde, et déclare qu’elle te refuse pour compagnon et pour témoin de notre voyage. Elle ne doute pas que je ne te raconte ses faits, gestes et paroles, et elle s’oppose à ces confidences, à ces indiscrétions.
Je suis forcé de convenir que déjà je t’ai entretenu de ses jugements ou plutôt de ses paradoxes sur la Suisse. Elle me supplie de cesser de t’écrire. Je résiste avec un courage dont je m’étonne et qui m’honore.
«Je m’observerai», dit solennellement Madeleine.
Elle boude, mais cela dure peu.
«Crois-tu donc, me demande-t-elle, que Pascal te rende l’amitié que tu lui prodigues?
— J’en suis certain.
— Comment le pourrait-il? Tu es expansif, il est retenu; tu es enthousiaste, il est réfléchi; tu te répands, il se garde; tu es ardent, il est froid. C’est une nature qui reçoit, qui s’alimente, qui emmagasine sans avoir conscience des devoirs du retour et de l’échange.
— Cependant le bienfait de son affection pour moi est manifeste. Sans lui, je n’eusse été qu’un traîneur de sabre, ne songeant qu’à vivre, livré à l’unique passion d’être jeune.
— Pascal, certes, n’est pas nuisible. Je nie seulement sa générosité. Il est comme un trop-plein qui se déverse et s’arrête au niveau qui entamerait ses réserves. Cet homme n’écoute que ses voix intérieures, n’aime que les images peintes en lui et par lui!
— C’est peut-être un visionnaire, ce n’est pas un égoïste.
— Je vois en son esprit un monde à part, Jean, un monde inutile. Sans doute, il est riche de trésors amassés. Si ce n’est pas un égoïste, c’est un avare. Il a l’excessif respect de son intégrité. Contemplatif, il préfère à son meilleur ami la solitude. Il est fatalement voué au faux en tout. Il vivra incompris et mourra sectaire. Créateur d’un idéal qu’il a fait à sa ressemblance, qu’il évoque en soi, auquel il se consacre, qu’il encense des fumées de lui-même, il se consumera sans profit pour les autres. C’est un orthodoxe d’une religion patriotique étroite, exclusive. Il sacrifie à l’erreur, et dérobe à la patrie réelle des richesses, des forces que nul homme propre à l’action n’a le droit de dissiper en rêveries. Ton amitié, mon frère, le maintient à des hauteurs où d’autres que vous deux seraient pris de vertige. Ta gaieté le réveille, l’avertit et le gare. Sans toi, il courrait à l’absurde. Pascal se complaît parfois dans une sorte de prison cellulaire. Il est son prisonnier. Il s’interdit tout commerce avec l’extérieur. Le manque de relations le rendra insensé. Vois-le: écoute-t-il? Parle-lui: entend-il? Il n’est jamais présent que pour lui-même, visible que pour lui, attentif qu’à sa seule pensée.»
Et comme elle se taisait:
«Est-ce tout? demandai-je.
— Puisque tu le chéris, continua-t-elle, sans se soucier de mon impatience, tu devrais le forcer à se verser, à se partager, à aimer. Il idolâtre la France, eh bien, qu’il soit Français! Oblige ce cœur à battre pour autre chose que pour des simulacres. Fais-lui honte de sa sécheresse, au lieu de le louer comme un héros, de l’encenser comme un saint. Crois-moi, Jean, la dignité raide ne vaut pas l’expansion sans désordre, et l’affectation de la sagesse est toujours inférieure à l’énergie naturelle d’un tempérament qui sait se gouverner. Qu’est l’inertie tranquille à côté de la force endiguée? Combien je préfère à ce géant de granit immobile, ce Rhône impétueux et puissant qui gronde, mais qui garde le lit ouvert par ses flots.
— Tu oublies les inondations.
— Bah! le limon a quelquefois sa raison d’être. Pour féconder les terres il est plus utile que l’eau distillée. Pascal a de ces qualités négatives qui feraient admettre des défauts nécessaires. Tu l’estimes au-dessus de toi-même, Jean, et tu n’es point persuadé qu’il vaille mieux que toi!
— Mieux, il y a question; plus, j’en suis sûr.
— Plus! lorsque je t’ai démontré que son intelligence aboutira forcément à la stérilité ! De sa bonté, parlons-en! Son cœur, il est facile à mesurer! Cet artilleur met les femmes au défi de l’attendrir. Je crains plutôt pour lui que l’amour ne l’épouvante. Aimer, c’est donner la moitié de soi-même, et Pascal n’y saurait consentir. C’est un Narcisse! Il est beau pour se plaire, séduisant pour se charmer, instruit pour se distraire, rêveur pour rêver en soi. Ton ami aurait plus besoin d’un tout petit grain d’abandon que des récoltes successives qu’il amasse, qu’il engrange, et qu’il compte dévorer à lui tout seul.
— J’en grignoterai bien quelque chose, répliquai-je, car douter de la générosité d’esprit de Pascal,, c’est commettre une injustice.
— Tu m’as écoutée, ne me réponds pas, repartit Madeleine. Tout ce que tu me dirais me viendrait de toi et ne prouverait rien pour lui. Quand j’ai bien pénétré un cœur comme celui de Pascal, je m’efforce de ne m’y point attacher. Je sais que la pire des tortures est l’épreuve du tonneau des Danaïdes. Je connais ton ami comme je me connais moi-même. J’ai été un moment fort occupée de lui, je te l’avoue, et je souriais à l’idée d’apporter la lumière à cette belle âme ténébreuse. Mais j’ai précipité de ma pensée, de mes sentiments, ce Lucifer, orgueilléux et ingrat. Si tu lui écris, répète tout ce que je viens de te dire. Après-demain, probablement j’aurai fixé mon sort. J’ai vingt ans, et je ne me refuse pas à choisir un fiancé, fou de moi, dit-on, sans m’avoir jamais vue. Le destin m’offre là une compensation qui me flatte, à laquelle je suis sensible. Ajoute à mon homélie chrétienne sur Pascal cette bonne aventure que je lui prédis sans sorcellerie: Tout en lui est préméditation. Sa route morale est tracée; il en redressera les courbes, en écartera les rencontres, en marquera les étapes, en touchera le but. Il atteindra le développement monstrueux de sa volonté et de sa raison. Il voudra tout ce qu’on peut vouloir, raisonnera tout ce qu’on peut raisonner. Au profit de qui et de quoi? De la conception du vrai, de la recherche de son bonheur, de son abnégation envers les autres? non; au bénéfice de son orgueil. Mais cessons, Jean. Nous voici à Brieg. Tu m’as fatiguée. Ne me parles plus jamais de Pascal, je te le défends!»
Ma mère s’éveilla ou feignit de s’éveiller. Elle avait entendu la fin de notre conversation, j’en jurerais.
«Ta sœur a la fièvre, dit-elle, en prenant la main de Madeleine. Vous avez trop jasé. Tu lui fais mal, Jean. Est-ce là ce que tu te proposes? »
Madeleine, en effet, avait la fièvre. Le diable m’emporte, si demain je prononce une syllabe de ton nom!
Il est trois heures du matin, et nous partons à huit pour Stresa.
C’est là que nous embrasserons, mon, son, notre cousin Spedone-Bruzella. Quelle fête!
Bonjour,
JEAN.