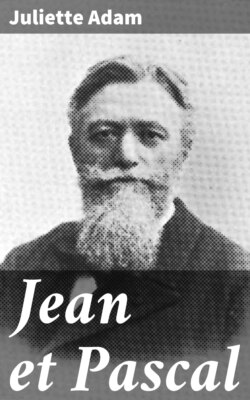Читать книгу Jean et Pascal - Juliette Adam - Страница 7
ОглавлениеRUE DE LUXEMBOURG, A PARIS.
Fontainebleau, 23 septembre.
Il m’a fallu deux jours, mon cher Jean, pour me rendre un compte à peu près exact de l’étrange, de l’irrésistible puissance qui m’a entraîné l’autre soir hors de chez toi, et m’a, pour ainsi dire, jeté dans la rue.
Tout d’abord, je demande pardon à ta mère de mon inconvenance. Fais-lui mes excuses de vive voix, car tu ne liras cette lettre à personne. Je reconnais, en outre, avoir mérité l’accusation de Madeleine. Oui, j’ai paru manquer de cœur; peut-être même, de certaine façon, en ai-je manqué, et c’est à ce propos, sur ce point, que je me suis le plus interrogé.
Lorsque je vous quittai, je croyais bien revenir. Une fois descendu, le bruit de vos rires, les sons du piano, ces chants dont vous accompagniez vos danses, m’ont poursuivi et chassé. Je me suis senti tout à coup accosté, saisi, étranglé par une émotion poignante, presque tragique. Le chagrin s’est emparé de moi sans que je pusse lui reconnaître une forme. J’étais harassé, comme si les fatigues de mes veilles laborieuses avaient voulu m’accabler toutes à la fois. Le but atteint, visible, que je touchais du doigt un moment plus tôt, cette carrière militaire dans laquelle j’entrais brillamment, tout cela se ruinait, devenait poussière et disparaissait. Une sorte d’écroulement se fit en moi!
A mesure que je m’éloignais de ta maison, ma vie passée la plus lointaine se déroulait devant mes yeux comme en dehors de moi-même. Mon enfance marchait, grandissait là-bas, dans un village de Lorraine, à la frontière. Je savais à peine courir seul que déjà je jouais au soldat; à peine rêver que je rêvais d’ennemis allemands; à peine comprendre que j’écoutais fiévreusement les légendes des guerres du Rhin.
Dans ma famille on est militaire; nul ne me demandait ni chez moi, ni ailleurs, ce que je ferais un jour, quels goûts j’avais. Le maître d’école, mes camarades, nos voisins, ma mère, un oncle amputé d’un bras, colonel en retraite, qui m’aimait fort, me disaient: «Quand tu seras à l’armée.» Quand je serai artilleur! pensais-je.
A trois ans j’avais vu passer des canons dans la grande rue de mon village. Le souvenir du bruit étourdissant des caissons et du bronze sur le pavé me donnait une sorte de vertige qui exaltait mon jeune cerveau, et j’ambitionnai alors de commander à cet orage, de le traîner derrière moi.
Je fus mis au collége, à Metz, et j’y travaillai dans un but unique: entrer à l’École d’application d’artillerie. Tu m’as connu, Jean, à la fin de mes classes. J’étais déjà un piocheur, un sauvage, un sérieux. J’avais l’idée fixe de la guerre, d’une invasion. Je connaissais l’Allemagne, les Allemands. Ma haine était telle alors que nos malheurs n’y ont point ajouté. Ai-je discuté avec vous les conséquences néfastes de la victoire prussienne à Sadowa? Y ai-je lu l’arrêt de notre destin? A force de vous moquer de mes craintes, vous m’aviez obligé à les raisonner davantage, à lire les journaux allemands, les nôtres, à m’instruire, à m’éclairer sur notre état politique. J’en remontrais, tu te le rappelles, à notre jeune professeur d’histoire. J’amassai en moi une passion violente, jalouse, irritable, ardente, presque frénétique de la patrie.
Toi seul, Jean, avec ton caractère aimable, tu te pris de curiosité pour ce voyant, pour cet absorbé, si triste et si sombre.
Après la déclaration de guerre, à notre première défaite, tu me compris, et tu fis d’une affection demi-bienveillante un amour fraternel.
Nous avons pleuré les mêmes larmes de sang. A moitié préparés pour l’École polytechnique, nous nous sommes engagés tous les deux pour la durée de la guerre, à dix-sept ans. Prisonniers de Bazaine dans Metz, plus tard prisonniers des Allemands à Coblentz, nous sommes parvenus enfin à rentrer en France. Nous avons cherché alors toutes les occasions de nous battre pour l’honneur de notre patrie idolâtrée, pour le sol de ma pauvre Lorraine.
Jean, c’est notre seule joie au milieu de tant de douleurs! Tour à tour soldats, sous-officiers, nous offrant pour instruire, nous enorgueillissant d’obéir, incorporés à l’armée de l’Est, blessés dans la retraite sur la Suisse, toi et moi, frère, nous avons fait notre devoir, et la France qui pleure en nous pleure fièrement.
Oui, je l’ai défendue jusques à la mort, ma France de Lorraine, et je n’aurais pas survécu à ses mutilations si tu ne m’avais soigné, sauvé, supplié de vivre.
Je me remémorais toutes ces choses passées, que ma mémoire ressuscitait une à une.
Mais comment se fit-il, Jean, qu’après avoir quitté ta maison, cette fête, nos amis, je me retrouvai dans ma chambre, inconscient de mon retour à Fontainebleau?
Mon existence déroulée sous mes yeux se replia lentement, image sur image, et se rangea comme une carte dans son étui. Je revis bientôt ma personne actuelle en son état présent. Qu’avais-je fait pour revenir ici, qui m’avait conduit moi-même?
Je me rappelai mon voyage de Paris à Fontainebleau comme un récit qu’un autre m’en eût fait. Je me crus halluciné ! Je n’essayai pas de résister à une courbature d’esprit qui m’empêcha de penser jusqu’au lendemain, malgré mon insomnie. Quoique je n’eusse pas dormi, cependant, à l’aurore, il me sembla que je m’éveillais. J’avais la tête endolorie, le cœur serré. Je me souvins de ma fuite absurde, je me représentai ta surprise d’abord, ton inquiétude ensuite.
Le croiras-tu? Au lieu de m’accuser, de te faire amende honorable, de me traiter comme je le mérite, j’accusai les autres, et surtout Madeleine. Une irritation pleine de griefs contradictoires que je ne réussirai certainement pas à coordonner, s’empara de moi, et je veux te la dépeindre dans toute sa confusion et dans toute son injustice.
Madeleine est si belle qu’il ne m’est jamais venu à l’idée de t’exprimer mon admiration pour sa beauté. Je t’ai souvent parlé de son esprit, qu’elle a si finement railleur, ou qu’elle affecte d’avoir tel pour être en droit de ne point prendre au sérieux ses adorateurs et pour se mettre à l’abri des avalanches de leurs compliments, de leurs déclarations.
Jamais je ne l’avais vue plus moqueuse, plus étincelante, plus spirituelle que dimanche. Votre ressemblance d’air, de physionomie, de traits, que je détaillais en vous regardant, me causait une émotion joyeuse. Tous deux, animés, contents, heureux, vous me combliez de votre tendresse. Je vous appartenais, malgré mes réserves, et je me sentais, à chaque minute qui s’écoulait, plus attaché à votre amitié.
Madeleine vint me prendre par la main et me pria de la faire danser. Je demandai grâce. Elle me força de la suivre, me mit en ligne, et me signifia d’avoir à me bien tenir. Elle confirma devant la rieuse assemblée tous ses droits sur moi.
Entre les figures du quadrille ta sœur me prévint que vous alliez m’emmener dans un long voyage en Italie, m’accaparer, m’opprimer, sans le moindre scrupule, sans le plus léger respect de mon indépendance.
«Jean et moi, me dit-elle, nous vous enchaînerons quelle que soit votre force, nous vous tyranniserons quel que soit votre amour de la liberté.»
La menace était sérieuse, faite par Madeleine du ton impérieux qu’elle sait prendre lorsqu’elle commande. Elle l’accompagna d’un «je le veux!» significatif. Ses grands yeux noirs me défièrent d’oser répondre, sa bouche ne sourit pas, les ailes de ses narines eurent un battement orgueilleux et provocateur, la lumière courut sur ses cheveux d’or, et sa tête levée secoua des étincelles. Petite, elle me sembla grandie; mignonne et délicate, elle parvint à m’entraîner dans le tourbillon d’un galop interminable.
Lassés par la danse, il vous plut un moment de jouer aux petits jeux. Étourdi, presque chancelant, je me retirai dans une embrasure de fenêtre, derrière un rideau. Madeleine seule me voyait et ramenait à chaque instant son triomphant regard sur moi.
J’éprouvais à la fois pour elle de l’attrait et de la froideur. Une angoisse poignante envahissait mon cerveau en même temps qu’une douceur attendrie, engourdissante, pénétrait mon cœur. Je n’eus bientôt qu’une idée fixe: me secouer! Ma volonté, comme une sentinelle attentive, se dressa, s’exerça, montant une garde sévère, et combattit aussitôt provoquée.
Madeleine avec la variété, la souplesse de son esprit, semait vos conversations de traits éblouissants et répandait sur ces jeux une belle humeur tantôt comique, tantôt gracieuse, tantôt folle, tantôt poétique, toujours amusante et toujours jeune.
A je ne sais quel moment l’un de nos camarades interrogea ta sœur pour un gage. Madeleine réfléchit et répliqua gaiement:
«L’homme de mes rêves! vous supposez qu’il n’existe pas? il existe! Vous croyez que je ne l’ai jamais vu? je le connais! Vous allez vous écrier: elle aime! Non, pas encore! Celui que j’eusse choisi se dispute, et je ne suis pas faite pour subir l’humiliation d’une résistance. »
Elle riait, On crut à une plaisanterie.
«Un homme de ses rêves qu’elle n’aime pas, répétaient les jeunes filles, ce n’est pas l’homme de ses rêves!»
Et elles tournèrent et retournèrent en tous sens les phrases de Madeleine.
Ta sœur me fit signe de venir à ses côtés, où elle me montra une place. Jamais dans aucune circonstance de ma vie, rien ne m’avait plus bouleversé que cet appel. Je n’y répondis pas. J’étais rivé à ma fenêtre. J’essayai en vain de m’élancer vers Madeleine. L’anxiété, l’effarement m’étreignirent et me retinrent. Elle me considéra longuement, puis se leva et se remit à danser. Au milieu d’un quadrille elle demanda une valse et tourbillonna devant moi.
Mais elle s’arrête, pâle, dédaigneuse, les lèvres amincies. Elle lève le premier doigt de sa main. C’est un ordre, mais lequel? Dans mon trouble je ne sus quelle interprétation donner à ce geste. Madeleine me priait-elle encore d’aller vers elle ou m’ordonnait-elle de partir? Je m’enfuis.
Pascal, mon ami, mon frère d’armes, je ne veux pas aimer, je n’aimerai pas! Un signe ne peut à lui seul changer le cours d’une existence lentement acheminée vers un but fixé. Comment me dirigerait l’amour d’une femme aussi belle, aussi orgueilleuse, aussi entourée, aussi désirable que Madeleine? Est-ce que je puis le deviner, le prévoir, le soupçonner?
Je me garde pour celle à qui je me suis voué âme et corps, qui m’a demandé trop peu de mon sang, à qui je ne me suis pas assez consacré, assez livré. Ma douleur patriotique n’a point encore soulevé en moi la satiété. Je l’éprouve, au contraire, avec une ardeur qui exclut les lassitudes. Souffrir une grande souffrance est un réconfort quand elle provoque, non l’absurde résignation, mais le vouloir énergique de ne la porter ni un jour ni une heure de plus qu’il ne sera nécessaire!
Je l’avoue, ma passion pour la France fait de moi un sectaire, un fanatique. Mon cœur, frappé par son nom, même lorsque ma voix seule le prononce, bat à me rompre la poitrine, car je l’adore! Je la préfère aux créatures les plus séduisantes parce qu’elle est la beauté à la fois réelle et idéale. Nulle que ma France, je le lui jure, ne me fera plus tressaillir. On n’est pas infidèle à un pareil amour! Quand une âme française a été un moment le tabernacle d’une telle divinité, elle ne saurait se résoudre à devenir sacrilège en renfermant une autre image. Qu’une apparition unique me visite, qu’un seul nom en moi soit glorifié !
Tandis que le vautour allemand se repaît de ma Lorraine, qu’il arrache et dévore le cœur de la France, est-ce que je peux, moi, Lorrain comme Jeanne, ma payse, sourire à une joie, est-ce que je dois cesser de pleurer, est-ce que j’ai le droit d’être heureux? Non!
A toi, en notre patrie malheureuse!
PASCAL.