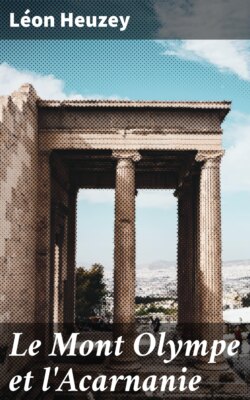Читать книгу Le Mont Olympe et l'Acarnanie - Léon Heuzey - Страница 11
4. Vlacho-Livadhi: les Valaques de l’Olympe.
ОглавлениеJe ne m’engagerai pas tout de suite dans les passages de Pétra et du Sarandaporos, et je retrouverai plus tard l’occasion de les décrire. Mais, avant de quitter le versant occidental de l’Olympe, je dois parler d’une ville et de plusieurs villages, qui se trouvent dans la montagne, au-dessus de l’ancienne Tripolide. Il n’y a là rien à faire pour l’archéologie; jamais les anciens n’auraient été s’établir sur ces escarpements, loin des routes fréquentées et des terres cultivables. Ce sont des établissements fondés depuis quelques centaines d’années par une colonie de Valaques. Les Valaques, avec leur goût pour les lieux élevés et pour l’air vif des montagnes, trouvèrent l’endroit à leur convenance et s’y arrêtèrent.
Vlakho-Livadhi est une petite ville de quatre cents maisons; il y a cinquante ans elle en comptait le double. La montagne où elle est située, et qui s’étend entre les deux défilés, s’appelle Chapka ; c’est le revers des monts Piériens. Les Livadhiotes nous parurent affables et hospitaliers; ils s’empressèrent de nous faire les honneurs de leur ville. Ils ont une école grecque fréquentée par cent cinquante enfants. Ils sont fiers surtout de leurs cloches et de leurs cinq églises. Ces églises sont grandes et décorées d’assez belles peintures dans le goût byzantin. Je fus étonné d’y trouver de beaux ouvrages de boiserie, un évangile magnifique, dont la couverture était ornée de miniatures sur porcelaine; les habitants ne me cachèrent pas que ces riches présents leur venaient de la Russie. Livadhi est la résidence d’un évêque, qui porte aussi le titre d’évêque de Pétra. L’administration de la ville est entre les mains de deux magistrats, appelés, comme partout en Turquie, kodja-bachi; il paraît qu’elle ne souffre pas de ce partage.
Les autres villages qui composent la petite colonie valaque sont Néokhori, Phtéri, Milia et Kokkinoplo; ce dernier est le plus important; il compte deux cents maisons. Il est aussi le plus éloigné de Livadhi; on l’aperçoit suspendu au flanc même de l’Olympe, presque au-dessus de Sélos. De là partent plusieurs sentiers qui traversent la montagne, et dont l’un conduit en cinq heures à ses plus hauts sommets.
C’est une curieuse population que ces Valaques, descendants de tribus errantes. Ils ont bâti des maisons, formé des villages et même une ville; mais ils sont restés pasteurs au fond de l’âme. C’est à peine s’ils cultivent quelques champs et quelques vignobles au bord de la plaine; ils vivent surtout du produit de leurs troupeaux. Ils se sont établis à portée des meilleurs pâturages; le mont Chapka, dont les pentes sont arides et escarpées, a sur ses plateaux des pâtis excellents; de là même est venu le nom de Vlakho-Livadhi, qui veut dire le Pré-aux-Valaques. Ceux qui ne font pas paître les troupeaux s’occupent à travailler la laine. L’industrie n’est ici que le développement naturel des habitudes et des besoins de la vie pastorale. Leurs femmes surtout sont devenues habiles à fabriquer la grosse étoffe qu’on appelle skouti. Chaque maison a ses métiers, son petit atelier où l’on tisse la laine en famille. Les plus entreprenants ou les plus riches exportent et font le commerce.
Cependant, il ne faut pas s’y tromper, le travail et le gain n’ont pu rendre ces Valaques tout à fait sédentaires, et détruire en eux l’esprit inconstant des nomades. J’appris à Livadhi un fait singulier: en 1854, à l’approche des bandes venues de Grèce, la ville, n’étant ni grecque ni turque et ne sachant trop quel sort l’attendait, prit le parti d’émigrer tout entière: on chargea les mulets, et l’on alla camper pendant plusieurs jours dans le voisinage des sommets de l’Olympe. La population, même en temps ordinaire, est toujours plus ou moins flottante; les approches de la mauvaise saison, un peu de gêne ou d’ennui font partir les plus pauvres. J’ai rencontré bien souvent dans les chemins de l’Olympe de ces familles en voyage; jamais ils n’ont l’air plus gai et plus heureux que lorsqu’ils ont plié bagage et pris en main leur bâton de route. Ils s’établissent dans quelque autre village, mais il est rare qu’ils y achètent ou qu’ils y bâtissent une maison; ils louent un logement et s’en vont quand il leur plaît. Le Grec méprise le Valaque; il le traite de vagabond, d’homme qui n’a ni feu ni lieu. L’idée du foyer domestique, l’amour du sol et de la maison sont gravés profondément dans l’esprit des paysans grecs. Le Valaque se défend; il prétend qu’il est plus libre, qu’il va où bon lui semble, et qu’il y trouve en même temps son agrément et son profit.
Du reste ces Valaques, malgré leur humeur changeante, paraissent au fond plus judicieux que les Grecs. Ils ont tout autant d’astuce, avec moins de vivacité. Ils sont en général grands de corps, un peu lourds. Leurs costumes n’ont rien d’élégant; ils se couvrent des étoffes qu’ils fabriquent, et leur vie dans la montagne demande avant tout des habits épais et tombants. Les femmes portent une coiffure haute tout à fait désagréable. La langue qu’ils parlent est à peu près la même que celle de la Valachie, avec un mélange de mots grecs, surtout pour les choses de la vie un peu civilisée. Ils disent en roumain du pain, un mouton; en grec une table, une fenêtre. Ils savent bien qu’ils ne parlent pas le pur dialecte de leur race; c’est pour cela qu’on les appelle , c’est-à-dire Valaques boiteux.
Ils n’ont conservé aucune tradition sur l’époque où ils s’établirent dans ces parages. Ils disent seulement qu’ils vinrent des montagnes, que Livadhi fut leur premier établissement, et que les autres villages n’ont été fondés que beaucoup plus tard. Toutes leurs églises, refaites et repeintes au commencement du dix-huitième siècle, ne fournissent aucun renseignement. On me montra dans l’une d’elles une vieille image de saint-Dimitri, peinte sur bois, qui portait la date de 1119; elle avait été apportée, disait-on, d’un village maintenant détruit, qui existait dans la montagne avant l’arrivée des Valaques. Il est probable que cette petite colonie n’est que le débris d’une colonie plus considérable, qui, vers la fin du moyen âge, occupa toutes les montagnes de la Thessalie. Dès l’an 969 un chroniqueur nous parle de Valaques voyageurs qui parcourent le pays entre le Pinde et l’Olympe. Au douzième siècle, la Thessalie ne s’appelle plus autrement que Grande Valachie ; ce nom lui reste jusqu’à l’arrivée des Turcs, et Cantacuzène, dans un acte officiel, obligé de renoncer à la loi qu’il s’est faite ailleurs de tout embrouiller par l’emploi des noms anciens, l’appelle encore principauté de Valachie.