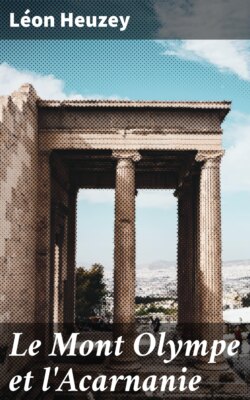Читать книгу Le Mont Olympe et l'Acarnanie - Léon Heuzey - Страница 7
2. Tzaritzéna, Alassona: position d’Oloossone.
ОглавлениеDes ruines de Gonnos et du village de Déréli, une assez bonne route conduit en deux heures à l’endroit où s’ouvre la Thessalie. C’est aussi la seule par laquelle on puisse tourner les montagnes abruptes, inhabitées et presque impraticables, qui se groupent autour de Kokkinopétra. Alors, après avoir franchi ce qu’on appelle le pas de Mélouna, on se trouve dans une autre petite plaine bornée à l’ouest par les pentes du bas Olympe, et entourée de tous les autres côtés par des hauteurs, qui s’en détachent. Le cercle est si bien formé qu’un voyageur géologue, M. Boué, croit y reconnaître le bassin d’un ancien lac. Au nord-est, sur le penchant des montagnes, sont situés deux grands villages, ou plutôt deux petites villes toutes voisines l’une de l’autre, mais différentes d’aspect. L’une est grecque et se nomme Tzaritzéna. L’autre est turque; on le voit aux coupoles de ses mosquées et à ses minarets; mais elle porte un nom plus vieux que les Turcs: c’est Alassona, une ville homérique, celle que le poëte appelle la blanche Oloossone. Au-dessus du village, sur une colline crayeuse , un grand monastère entouré de murailles rappelle encore de loin et remplace peut-être l’antique acropole.
Tzaritzéna a le titre de bourg libre, ϰεϕαλοχώρɩ ; c’est une de ces petites Communes grecques qui doivent à leur position au milieu des montagnes, à l’énergie de leurs habitants, quelquefois à l’insouciance administrative de l’ancien Divan, plus ou moins de liberté selon les temps, et le droit de se gouverner elles-mêmes. Les habitants de Tzaritzéna nomment donc leurs magistrats; ils sont maîtres de leurs maisons, cultivent pour leur propre compte, et possèdent les terres qu’ils cultivent. Ces terres sont de grands vignobles, de belles plantations de mûriers, des champs de maïs. On se demande comment les Turcs, qui sont si voisins, ont laissé aux mains des Grecs ce riche territoire. Ali-Pacha le convoita, mais il ne put s’en saisir; il le fit ravager à plusieurs reprises par ses Albanais, et toujours il échoua devant une résistance énergique.
C’est avant cette lutte acharnée, disent les habitants, qu’il fallait voir leur ville enrichie par ses nombreux métiers à tisser le coton et la soie, et comptant plus de deux mille maisons. La liberté était si grande alors qu’à chaque carnaval on ne manquait pas de promener par les rues une image grotesque du Sultan, souvent même en présence du pacha de Larisse, qui venait se divertir à ces réjouissances. Un Tzaritzéniote était reçu à Constantinople avec toutes sortes d’égards. Mais, après les coups redoublés portés par Ali-Pacha et par son fils Véli-Pacha, la petite ville de Tzaritzéna n’a jamais pu se relever; plusieurs maladies contagieuses sont encore venues décimer ou disperser ses familles, qui sont réduites aujourd’hui à deux cents. Pourtant ses maisons hautes, son monastère d’Hos Athanasios qui s’élève à quelque distance au milieu des vignes, son palais épiscopal, où réside l’évêque d’Alassona, lui donnent encore l’aspect de la prospérité. Deux ponts en pierre jetés sur le lit d’un torrent, des fontaines, des places ombragées, deux écoles, une école primaire et mutuelle, l’autre où l’on enseigne quelque peu de grec littéral, attestent la richesse et l’intelligence de son ancienne population.
On ne rencontre dans cette ville aucun débris de monuments antiques ni byzantins. Son nom n’est même pas grec, mais slave; et, bien que les habitants soient grecs, ne parlent et ne comprennent que le grec, tout porte à croire qu’elle a été fondée pendant le moyen âge par une colonie de Bulgares. Un petit monastère bulgare, nommé Valetziko, s’élève encore à deux lieues vers l’est, au milieu des montagnes; il n’est plus habité que par un vieux moine grec, mais la tradition du pays n’a pas oublié son origine. On raconte qu’un roi puissant, qui régnait alors à Servia, vint à Tzaritzéna avec son enfant, qui était malade. Là il eut une vision, et son fils fut guéri; c’est alors qu’il fonda Valetziko, dont le nom veut dire l’Enfant. Cette tradition s’accorde bien avec le nom même de Tzaritzéna , qui veut dire en slave Village Royal.
Les Bulgares ont certainement occupé cette contrée, où plus tard la race grecque, plus vivace, a repris le dessus. Une des rivières voisines, le Vourgaris , en a tiré son nom. En 996, nous les voyons, sous leur roi Samuel, qui justement occupait Servia, se répandre dans toute la Thessalie, y fonder partout des établissements, entre autres à Larissa : l’empereur Basile II, qui refoula plus tard cette invasion, ne détruisit pas sans doute toutes leurs colonies. Du reste, Tzaritzéna a pu être fondée à toute autre époque par quelque parti de ces barbares; car, pendant une partie de l’histoire byzantine, il y eut comme une longue invasion, une immigration journalière des Bulgares dans l’empire. C’était un fait si commun que les historiens byzantins ne notent pas ces migrations; on en voit pourtant un curieux exemple en 813: «Cette année, dit un chroniqueur,
«des Bulgares, sortis de leurs cantonnements,
«entrèrent en masse dans l’empire; l’empereur les
«accueillit et les établit dans différentes places.»
La petite ville d’Alassona est un chef-lieu turc de quelque importance, avec une garnison de milice albanaise. Ces Albanais ont surtout à faire aux Klephtes de l’Olympe; ils sont leurs ennemis naturels: les chansons nous montrent le Klephte, qui voit du sommet de la montagne les Albanais s’armer contre lui dans Alassona. Sans occuper une position forte, Alassona est commodément placée pour surveiller le pays; elle se trouve au croisement de tous les chemins qui le traversent, et sur la grande route qui descend des passages du nord. Les Turcs y ont plus de deux cents maisons et trois mosquées. C’est aussi un siége épiscopal dépendant du métropolitain de Larisse. Mais la population chrétienne a presque disparu, et l’évêque est allé s’établir à Tzaritzéna. Vingt-cinq familles grecques, tout au plus, habitent encore quelques maisons dans un quartier ruiné. Autrefois la garde d’Alassona et de tout le pays était confiée aux armatoles grecs. C’était le gouvernement turc qui soudoyait les capitaines les plus renommés de l’Olympe avec leurs bandes, et qui s’en servait souvent avec habileté contre les Turcs eux-mêmes. Le district d’Alassona comprenait tout l’Elymbos, c’est-à-dire tous les villages libres de la montagne; il était sous la protection spéciale de la sœur du Sultan, et ne payait qu’un karadj insignifiant.
Vers l’occident de la ville, coule une rivière qui débouche dans la plaine par une pente étroite, et, recevant sur sa route le torrent de Tzaritzéna, va plus loin se réunir avec le Vourgaris. On la nomme simplement rivière d’Alassona. C’est un des bras de l’ancien Europos ou Titarésios, qui arrosait la Perrhébie . Homère appelle le Titarésios un fleuve aimable, bien qu’il le fasse venir du Styx et des terribles demeures. Je ne lui trouvai, dans cette partie de son cours, rien de bien gracieux ni de bien infernal. Il circule modestement sur un lit de cailloux, entre deux escarpements de terre blanche; son eau ne me parut ni plus glacée qu’une autre, ni grasse et huileuse, comme le dit Strabon . Seulement il dépose, comme beaucoup de ruisseaux, une matière brune sur les pierres et sur les herbes; et les habitants prétendent, peut-être sans raison, qu’il exhale des vapeurs malsaines.
Un pont de pierre d’une seule arche, jeté d’une rive à l’autre, relie à la ville la colline où s’élève le grand monastère de la Panaghia, un monastère de premier rang, soumis à la seule autorité des patriarches de Constantinople. Il possède aux environs dix-sept métairies, μετόχɩα. Il est habité par une dizaine de moines. La tradition en attribue la fondation à l’empereur Andronic, probablement Andronic le Vieux: certaines parties remontent évidemment à cette époque, surtout l’église. C’est une construction carrée, surmontée d’une coupole; l’intérieur est divisé en trois nefs par de lourds massifs de maçonnerie. On y montre une peinture miraculeuse célèbre dans ces parages. Un berger de Karya, dans l’Olympe, vit une nuit, au milieu de la montagne, une place toute illuminée; n’osant approcher, il jette une pierre, et son bras aussitôt devient raide. On se rendit le lendemain à l’endroit qu’indiquait le berger, et l’on trouva une vieille image de la Panaghia, peinte sur bois; la pierre l’avait frappée et s’était incrustée au milieu de la planche. L’image fut portée, telle qu’elle était, au monastère d’Alassona et placée solennellement dans l’église; c’est alors seulement que le pauvre perclus retrouva l’usage de son bras. C’est une croyance générale dans l’Église d’Orient, que la Panaghia, parmi ses images, en a qui lui plaisent particulièrement: elles ne peuvent périr; si quelque hasard les fait disparaître, on les retrouve toujours, et souvent, après un long temps, elles se manifestent d’elles-mêmes par un prodige . Chez un peuple où la peinture est restée une partie de la religion, il ne faut pas s’étonner qu’elle ait ses légendes et ses miracles.
La colline du monastère, séparée à pic des hauteurs voisines, isolée d’un côté par la pente même où coule la rivière, de l’autre par un ravin profond, est aussi le seul emplacement qui convienne à l’ancienne Olossone. Cette cité des temps héroïques n’est guère connue que parce qu’elle remplit de son nom harmonieux la fin d’un vers d’Homère. Le poëte la place parmi les villes des Lapithes, sous le sceptre de Polypétès, descendant d’Ixion et de Pirithoüs; mais Strabon nous apprend qu’elle appartenait primitivement aux Perrhèbes. Les Pélasges furent les premiers à cultiver ce petit bassin fait d’un calcaire fertile. Ensuite ils furent chassés des plaines par les Lapithes, qui semblent avoir été l’avant-garde des tribus éoliennes. Depuis ces temps reculés et même tout à fait fabuleux, Olossone n’a plus d’histoire. Pourtant elle existe toujours, et son nom, en s’altérant un peu, se perpétue jusqu’à nous. Je l’ai retrouvé dans une inscription latine du temps de Trajan . Une citadelle de Lossonos est comptée parmi les forts que Justinien bâtit en Thessalie. Enfin, vers la fin du moyen âge, les écrivains byzantins nous avertissent que ce nom homérique se reconnaît encore de leur temps dans celui d’Élassone. On voit, en effet, sous Andronic le Jeune, Élassone citée parmi les principales forteresses des despotes de Thessalie . Les fondements d’une épaisse muraille en blocage grossier, mêlé de quelques pierres plus grandes et mieux taillées, subsistent encore aux environs du monastère. Ce sont les restes de cette forteresse byzantine construite par Justinien, sans doute sur les ruines de l’ancienne acropole.
Je rencontrai dans la ville et dans le monastère huit inscriptions, presque toutes déjà publiées, et plusieurs autres fragments antiques de moindre intérêt. Dans une église du quartier grec, qu’on appelle la Panaghia d’en bas, l’autel est supporté par un petit pilier à quatre faces; j’y lus deux actes d’affranchissement, qui datent de l’empire romain, mais d’une époque différente: on remarque déjà dans le second des lettres onciales. Ces actes sont rédigés dans la forme la plus ordinaire; ils donnent le nom des esclaves affranchis, et attestent que la ville a perçu son droit de vingt-deux deniers et demi. La ville n’est pas nommée; seulement nous voyons que son principal magistrat avait le titre de στρατηγός ou de préteur. Cette inscription est déjà connue, mais je crois pouvoir en donner une copie plus complète. Quelques colonnes de vert-antique et un débris de pavage en mosaïque, que je vis dans cette église, sont sans doute les restes de l’église épiscopale d’Élassone, bâtie jadis sur le même emplacement, avec tout le luxe de l’ornementation byzantine. Dans les murailles du monastère se trouvent encastrées des inscriptions funéraires d’époques diverses, toutes avec des noms grecs, un fragment de décret accordant le droit de cité à un Romain nommé Lucius Acutius. Un autre fragment assez curieux n’a pas été publié, c’était un décret qui accordait des remercîments à ce Lucius; mais on l’avait effacé plus tard pour inscrire à la place un acte d’affranchissement, et cet acte même avait été remplacé par un acte semblable en lettres plus modernes. La pierre conserve encore les traces des trois inscriptions qu’elle a portées successivement. Je recueillis, en déchiffrant tous ces marbres, le nom de deux mois inconnus, et peut-être particuliers à la Perrhébie, ce sont les mois ἄϕρɩος et λεσχανόρɩος.
Du reste il ne faut pas se hâter de conclure que tous ces débris proviennent d’Olossone. Les chrétiens ont apporté souvent de bien loin ces pierres qu’ils trouvaient toutes taillées, pour en orner leurs églises. J’acquis la certitude que presque toutes celles-ci avaient été prises ailleurs; et les moines me rapportèrent que les inscriptions du monastère avaient été tirées de différents villages où ils ont leurs métairies, principalement de Vouvala. Deux tombeaux, d’une construction très-simple, découverts par un éboulement sur la rive gauche du Titarésios, sont des restes qui prouvent plus certainement l’existence d’une ville antique. D’ailleurs la ruine la plus ancienne et la plus authentique, c’est encore le nom d’Élassone ou d’Alassona; sans lui on ne saurait où placer l’Oloossone d’Homère.