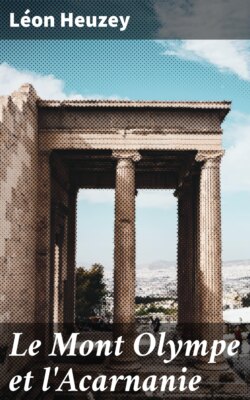Читать книгу Le Mont Olympe et l'Acarnanie - Léon Heuzey - Страница 8
3. La Tripolide. — a. Pythion.
ОглавлениеQuand on a gravi les hauteurs qui dominent Alassona, on commence à voir sur la droite les grandes pentes et les sommets du haut Olympe. Ce versant n’est pas boisé comme celui qui regarde la mer: on n’y découvre pas un seul arbre; mais l’Olympe avec ses cimes à perte de vue, avec ses flancs immenses, n’a pas besoin du luxe de la végétation pour paraître majestueux.
Le pays qui s’étend au pied de la montagne est une plaine entremêlée et comme semée de collines, cultivée par endroits et peuplée d’une dizaine de villages. Elle est fermée au nord par les revers des monts Piériens, à l’ouest par la chaîne de l’Amarbis, les monts Cambuniens de l’antiquité. Le Vourgaris, qui est le bras principal de l’ancien Titarésios, l’arrose, et les deux défilés de Pétra et du Sarandaporos viennent y déboucher de deux côtés différents. Les villages de cette plaine sont, du côté de l’Olympe, Ormanli ou Chadovo, Barakadhès, Bazarli, trois bourgades de Turcs koniarides, les deux dernières abandonnées (elles ont été brûlées en 1854 par les bandes venues de Grèce, et les habitants ont émigré à Ormanli); plus loin Dhémiradhès, village grec avec un petit monastère d’Hos Antonios; puis, derrière un rang de coteaux, Sélos, Douklista, sur l’autre rive du Vourgaris, Vouvala, Vourba, Bessaritza, Gligovo, autant de hameaux habités par des laboureurs grecs.
Cette plaine, située au fond de la Perrhébie, s’appelait autrefois la Tripolide. Nous n’avons guère à alléguer, pour le prouver, qu’une phrase de Tite-Live; mais elle est précise et ne laisse pas de doute: «Persée,
«dit-il, après avoir franchi les monts Cambuniens
«par une gorge étroite, descendit dans la Tripolide:
«on appelle ainsi le territoire de trois petites
«villes, Azorus, Doliché, Pythium.» Ces trois places, sans avoir jamais fait grand bruit dans l’histoire, avaient leur importance. Elles étaient pour les passages du nord ce que Gonnos était pour Tempé. Pour s’assurer qu’elles défendraient de ce côté les portes de la Thessalie, les Larisséens, amis de Rome, leur avaient demandé des otages. Mais Persée se hâta de les attaquer, et elles ne tinrent pas devant lui. C’était un district à part, bien distinct du reste de la Perrhébie; et l’on peut supposer avec quelque raison qu’elles formaient entre elles une petite ligue, dont le centre devait être à Pythion, au temple d’Apollon.
A Pythion, on voyait en effet un temple d’Apollon de quelque célébrité. Le nom seul nous l’apprendrait, si nous ne le savions d’ailleurs. Ce sont les Doriens, suivant O. Müller, à l’époque où ils avaient leurs cantonnements au pied de l’Olympe, qui instituèrent en ces lieux le culte de leur grande divinité. L’emplacement de la ville est manqué avec précision par les auteurs anciens. Elle commandait du côté de la Thessalie l’entrée du défilé de Pétra, qu’on appelait aussi défilé de Pythion . Nous savons encore qu’elle était située juste au-dessous du plus haut sommet de l’Olympe. C’est, à ne pas s’y tromper, la position du village moderne de Sélos. Ses maisons blanches, mêlées de quelques arbres, entourées de petits jardins et de vignobles, se voient au bord de la plaine, à l’endroit même où viennent tomber les pentes de la montagne. A quelque distance vers le nord-ouest, au milieu de collines arides, descend la route qui vient de Pétra. Enfin, en arrivant de loin, on voit au-dessus même du village, à une hauteur prodigieuse, se dresser le plus élevé des sommets de l’Olympe.
Le colonel Leake ne fit que traverser rapidement la plaine: il apprit qu’on trouvait à Sélos quelques antiquités, et il y place, sur la vague ressemblance du nom, la ville homérique d’Héloné. Par malheur, ce nom de Sélos me paraît beaucoup plus moderne: sélo, dans la langue des Bulgares, veut dire simplement village; et c’est encore une trace du séjour de ces peuples dans les petites plaines du versant occidental de l’Olympe. Héloné n’a jamais fait partie de la Tripolide. Son nom, qui fut changé plus tard en celui de Limoné, prouve assez qu’elle était placée dans un endroit marécageux: le sol de Sélos est sec, un peu élevé et pierreux. Le colonel Leake, dont le coup d’œil est presque toujours si sûr en fait de topographie, me paraît ici trop préoccupé d’une idée; c’est de placer la ville de Pythion dans le défilé même. Il suffisait qu’elle en défendît l’accès. D’ailleurs, il n’y a pas d’emplacement convenable pour une ville, sur les collines rocailleuses et tout à fait sans eau, au milieu desquelles s’engage d’abord la route de Pétra.
Sélos est un tchiflik: je ne trouve pas en français de mot correspondant; ferme, métairie, sont inexacts. On appelle ainsi en Turquie un village dont les terres, les maisons, sont devenues la propriété d’un ou de plusieurs Turcs, et dont les habitants donnent en redevance à leurs maîtres une partie de leurs récoltes. Sélos était autrefois un grand village, un village libre. Les vieillards se rappellent y avoir vu encore quatre-vingts maisons; et ce n’était qu’un reste d’une splendeur plus ancienne. Cinq églises, isolées maintenant et dispersées sur un large espace, deux ponts en pierre jetés sur un torrent qui passe dans le voisinage, prouvent la vérité de leurs récits. Ce n’est plus aujourd’hui qu’un hameau: de loin il plaît aux yeux et les trompe par sa gentillesse; mais je n’y trouvai que quinze maisons d’un aspect misérable. Les paysans exprimaient ce dépérissement par une expression énergique: «Eἶναɩ τoυρϰɩσμένo τὸ χωρίο.» La position parut encore si favorable de nos jours pour surveiller les passages de l’Olympe et surtout celui de Pétra, qu’Ali-Pacha fit bâtir à l’entrée du village une petite forteresse, ou plutôt une maison fortifiée, qui tenait en échec les Klephtes de la montagne. Depuis, les Klephtes l’ont brûlée; on en voit encore les quatre murs.
Les églises de Sélos sont pleines de fragments antiques. Dans celle de la Panaghia, je trouvai sous le porche quelques grands blocs carrés et six tronçons de colonnes doriques en marbre blanc, de la meilleure époque. Les uns ont de diamètre 0m,63, et leurs cannelures, 0m,10 1/2; les autres, 0m, 81, avec des cannelures de 0m,11. N’y a-t-il pas quelque rai son de croire que ce sont les débris du temple d’Apollon?
Deux stèles sont engagées dans les murailles voisines. Mais le fragment le plus curieux est une grande inscription de quarante-deux lignes, sur une plaque de marbre blanc. On en a fait une marche d’escalier, et l’un des bords s’est trouvé un peu effacé. Les lettres, fines, tracées avec soin, sont encore d’une bonne époque; elles peuvent remonter au temps des successeurs d’Alexandre. Cette inscription contient, comme les précédentes, des actes d’affranchissement; mais ce n’est plus la formule commune et banale dictée sans doute sous l’empire par quelque loi romaine: «Un tel... a payé à la ville les vingt-deux deniers et demi...» Nous voyons ici une cité libre, qui s’administre elle-même, qui a ses usages, ses magistrats particuliers. C’est d’abord le tamias qui rend ses comptes au peuple. Au bas de chacun des actes on a inscrit les noms de quatre citoyens, qui sont comme les témoins et les garants de l’affranchissement. Ils ont un titre que je n’ai vu nulle part, c’est celui de ξενoδóϰoɩ. Ce titre singulier veut dire:
«Ceux qui admettent les étrangers.» Voici comment je l’expliquerais. On se rappelle qu’à Athènes les affranchis étaient mis par les lois sur le même pied que les métèques ou étrangers domiciliés. Pourquoi une loi semblable n’aurait-elle pas existé dans la ville qui nous occupe? Un esclave qu’on avait affranchi était, en effet, selon les idées des anciens, un nouveau venu, un étranger qui s’établissait dans le pays: les xénodoques pouvaient donc être chargés à la fois des étrangers et des affranchis. Sur les quatre, trois sont appelés xénodoques privés; et le premier est le seul qui ait une fonction publique: il est désigné sous le nom thessalien de tagos. Les ταγoɩ̔ sont les magistrats qui gouvernent la ville, les archontes du pays : la loi voulait que l’un d’eux présidât toujours à ce que nous appellerions aujourd’hui l’enregistrement des affranchis. Ils partagent ici l’autorité avec le stratége, qui est le chef du pouvoir. Cette inscription nous fait entrer dans les détails de l’administration d’une petite ville de Perrhébie.
La découverte de ces listes publiques d’affranchis ne fit que confirmer en moi l’idée que j’étais dans le voisinage de Pythion et du temple d’Apollon. Je me rappelai que les anciens plaçaient toujours ces inscriptions auprès de leurs principaux sanctuaires, et que les abords du temple d’Apollon Pythien à Delphes étaient pleins de pareils monuments. Deux mois, dont je trouvai les noms dans ces actes, se rapportent au culte du même dieu: ce sont les mois ὰπoλώνɩoς et λεσχανóρɩoς ; car Les chanorios était un des surnoms d’Apollon présidant aux réunions et aux conversations des hommes.
De grandes pierres taillées, des tambours de colonnes doriques, qui, par leurs dimensions et par la nature du marbre, proviennent évidemment du même monument que celles de la Panaghia, se retrouvent dans l’église d’Hii-Anargyri. Je vis encore, dans les églises et dans les murs des maisons, un fragment d’autel ou de piédestal avec le nom d’Auguste, une offrande à Aphrodite, une autre à Esculape, plusieurs stèles funéraires, dont l’une terminée en coquille, avec une inscription de la meilleure époque: «Philippos, fils de Dêmarchos.» Les autres portent les noms d’Agathon, d’Ennodia Patroïa, de Nicandridès, fils d’Harmodios.
Sélos est dominé à l’est par une colline escarpée qui s’appuie contre le flanc même de l’Olympe, et que les habitants appellent Paléo-Kastro. On me montra, comme j’y montais, une caverne assez spacieuse dans laquelle sont construites plusieurs chapelles grecques. Ce sanctuaire naturel, dont la religion chrétienne a pris aujourd’hui possession, était peut-être consacré autrefois au dieu de Pythion. J’espérais trouver sur le sommet de la colline quelques ruines de l’ancienne acropole. La hauteur se termine par un petit plateau entouré partout de pierres écroulées; on voit aussi sur le sol quelques traces d’une construction intérieure, d’une sorte de donjon: toutes ces pierres sont petites et mal taillées. Il n’y a là, au premier abord, rien qui rappelle l’antiquité. Mais, comme je me suis convaincu, en parcourant la Perrhébie, que les fortifications antiques y étaient en général d’une construction assez négligée , et, le plus souvent, ne laissaient pas de traces plus apparentes, je ne doute pas qu’il y ait eu en ce lieu une forteresse servant à défendre la ville.
C’est sur la petite colline d’Hii-Apostoli, située de l’autre côté du village, au milieu des vignes, que je trouvai enfin l’emplacement même de Pythion. Il n’y reste aucun débris d’édifices ou de murailles, tout au plus quelques lignes de fondations en grandes pierres régulières, qui sortent à peine du sol. Mais au sud-est la colline est taillée en pente douce et disposée en terrasses. Tout cet espace est couvert de tuiles et de débris de fine poterie; on y trouve des. médailles grecques et romaines, et le rocher est creusé en quelques endroits pour recevoir les fondements des maisons. Sur le sommet, près des ruines de l’église des Saints-Apôtres, je trouvai à terre deux plaques de marbre, qui avaient servi de bases à des statues. Tout autour, sur le tailloir, on avait gravé à la hâte, et en très-mauvaises lettres, des actes d’affranchissement. C’est un fait curieux pour l’histoire que la profusion de ces inscriptions: elle atteste le grand mouvement d’affranchissement des esclaves, par lequel la société antique épuisée cherchait à se renouveler. Sous l’empire surtout, les affranchissements étaient devenus la grande affaire dans la vie des petites villes, au fond des provinces. Les pierres manquaient pour recueillir les actes précieux qui assuraient les droits des nouvelles familles: on les écrivait sur le socle des statues; on effaçait d’anciens décrets; nous verrons bientôt qu’on ne respectait même pas les pierres des tombeaux. L’église des Saints-Apôtres ne renferme pas d’autres antiquités. Est-ce à cette place que se trouvait le temple d’Apollon? Tout le fait supposer. Il aurait ainsi, avec ses colonnes doriques, dominé la ville qui s’élevait par étages, exposée au midi et au couchant.
Les débris provenant de Pythion ont été dispersés assez loin aux environs. J’en retrouvai à la distance d’une lieue, vers le village de Dhémirhadès, dans les murs d’une vieille église qui dépendait autrefois de Sélos. Ce sont toujours des fragments de stèles, des plaques de marbre. Une longue inscription en petits caractères, mais si bien engagée dans la maçonnerie que j’en pus lire seulement quelques lettres, me parut contenir encore des listes d’affranchis. A terre, on voit un socle de statue: c’était la statue d’une femme nommée Aristobulé ; sa famille lui avait élevé ce monument. La vieille église, consacrée à la Panaghia, est elle-même une ruine intéressante. Elle est construite d’après la plus ancienne et la meilleure tradition de l’art byzantin. Contrairement à un usage plus moderne, le mur est percé de sept hautes portes cintrées. Plus tard les Byzantins, dans leurs constructions religieuses, suppriment autant que possible les fenêtres et les portes, afin de laisser plus de place aux peintures murales, qui leur plaisent par-dessus tout; l’architecture, si l’on peut appeler ainsi un art bien humble et bien ignorant, est devenue l’esclave de la peinture. Un autre signe d’antiquité, c’est que le clocher est séparé du corps de l’église: cette disposition se retrouve dans les plus vieilles basiliques de l’Italie; je me souviens de l’avoir remarquée aussi en France, dans une de ces églises que nous appelons romanes ou byzantines.