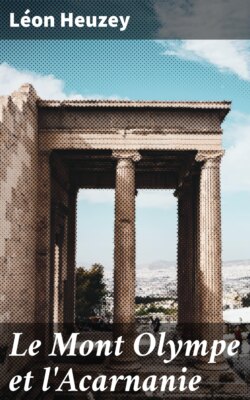Читать книгу Le Mont Olympe et l'Acarnanie - Léon Heuzey - Страница 6
1. Déréli: ruines de Gonnos.
ОглавлениеLa route de Tempé est tout entière creusée dans l’Ossa. Du côté de l’Olympe, le Pénée coule si près des rochers qu’il ne laisse pas même la place d’un sentier; c’est à peine si les platanes de cette rive trouvent un étroit rebord pour fixer leurs racines. Mais, en face du village turc de Baba, les pentes de la montagne commencent à s’écarter; on peut en cet endroit prendre le bac, qui vous met sur l’autre rive, et l’on entre dans une petite plaine triangulaire, adossée d’un côté au bas Olympe, fermée de l’autre par un de ses contreforts. Ces montagnes, surtout un grand pic qui les domine, et qui s’appelle Kokkinopétra (la Roche Rouge), sont abruptes et nues: mais le coin de plaine qu’elles encadrent dans leurs lignes sévères, et qu’elles abritent contre le vent du nord , n’en paraît que plus riant et plus fertile.
D’abord, le long du fleuve, s’étend un bois de chênes-verts, derrière lequel on aperçoit les minarets de Balamoutlu, petit village turc. Plus loin la campagne est en pleine culture: c’est le territoire de Déréli 3, grande bourgade habitée aussi par des Turcs. On ne voit plus que des terres en labour, des plantations de coton, des vignes, des oliviers; le voyageur qui arrive par le défilé de Tempé trouve déjà dans ce canton resserré le climat, les productions et comme un avant-goût de la Thessalie. Le village aussi réjouit les yeux par un air d’abondance et de douce fertilité. Il compte plus de deux cents maisons, toutes en bon état et blanchies à la chaux, presque autant de jardins entourés de murs, ce qui n’empêche pas les figuiers, les grenadiers, dont ils sont pleins, de se pencher partout au-dehors. Les mosquées et le bazar sont ombragés de beaux platanes. Des eaux vives, qui courent de divers côtés, entretiennent du gazon jusque dans les rues du village et tout aux environs: on dirait qu’il est bâti sur une pelouse.
Ces Turcs nous reçurent avec beaucoup d’hospitalité. Déréli est administré, comme tous les villages musulmans et chrétiens, par un chef ou kodja-bachi, qui perçoit et répartit les impôts . Les habitants sont tous agriculteurs; ils paraissent actifs et laborieux. C’est un plaisir de les voir à leur charrue, conservant jusque dans ces travaux la gravité qui est naturelle aux paysans turcs. Toujours propres dans leurs habits, avec des turbans blancs et des fustanelles blanches, ils labourent le pistolet à la ceinture, en vrais conquérants de la terre qu’ils cultivent. Comme les Turcs de Baba, de Balamoutlu et de toute la contree, ce sont des Koniarides; ils descendent d’une colonie venue autrefois de Konieh, à l’appel des premiers envahisseurs de la Thessalie.
La position de Déréli, sur un terrain tout à fait plat, n’invite pas à y chercher l’emplacement d’une ville antique. J’y remarquai çà et là dans les carrefours, autour des puits, de nombreux fragments de marbre, et même quelques stèles brisées, qui ne portaient malheureusement ni lettres ni figures. Tous ces débris sont apportés d’ailleurs. En effet, à deux kilomètres environ au sud-est, sur la route qui mène à Balamoutlu, on retrouve toute l’enceinte d’une ancienne ville, dont les ruines ont déjà été indiquées par Pouqueville, et vues, mais en passant, par le colonel Leake.
A l’endroit même où finissent les dernières pentes du bas Olympe, s’élèvent trois petites collines, qui forment ensemble un cirque naturel ouvert au midi. Les deux premières, qui sont coniques et de même hauteur, se dressent à six cents pas l’une de l’autre: la troisième, plus basse et plus allongée, s’arrondit un peu en arrière et les réunit. Elles sont couronnées par un mur en ruines flanqué de nombreuses tours carrées; l’ensemble est appelé par les Turcs Kaleh-Tépé (la Colline du Fort). Ce mur s’élève presque partout au-dessus du sol; il atteint même en beaucoup d’endroits jusqu’à trois et cinq mètres. Sa largeur est de deux mètres. Il se compose, selon les règles de l’architecture militaire chez les Grecs, d’une maçonnerie de remplissage avec un double revêtement. Seulement les pierres des deux revêtements sont beaucoup plus petites qu’à l’ordinaire, et surtout très-étroites: (c’est une espèce de schiste dur, qu’on a extrait des montagnes voisines et qui ne pouvait sans doute se tailler en gros blocs). Leurs joints, presque toujours verticaux, quelquefois obliques, sont ajustés avec précision, et l’on n’y voit aucune trace de ciment. Enfin ces pierres, si bien assemblées, ne sont pas disposées par lignes d’assises, et le travail est, comme on dit, irrégulier. Faut-il en conclure que la construction est négligée et qu’on a devant les yeux des fortifications faites à la hâte? Non, assurément. Les Grecs paraissent avoir aimé particulièrement cette façon irrégulière de bâtir; ils l’ont fréquemment employée dans leurs murailles et dans leurs acropoles, longtemps après qu’ils savaient faire des constructions plus symétriques. Était-ce une tradition de l’ancien art hellénique? Peut-être trouvaient-ils quelque grâce, ou bien une solidité plus grande, dans cet agencement plus compliqué.
Ce mur est donc un ouvrage grec, malgré la petite dimension des pierres, qui pourrait le faire prendre au premier abord pour un travail d’une époque plus moderne. Un fait singulier, c’est que, vers le nord-ouest de l’enceinte, dans un endroit où les collines s’abaissent un peu et rendent la place plus accessible, je trouvai une partie de muraille faite de grands blocs, avec une grosse tour carrée de même construction. Le tout est rasé à un mètre du sol. Aux deux angles saillants de la tour, les blocs ont été taillés et ravalés de manière à présenter une arête vive. Je fus surpris de trouver une large ouverture pratiquée dans le front de cette tour: la présence des arêtes vives aux retours d’angle de l’embrasure prouvait que ce n’était pas une trouée faite par le temps. C’était évidemment une porte flanquée de deux massifs saillants qui la protégeaient, et paraissant ainsi percée dans le milieu d’une tour. (Front des tours de l’enceinte, 5m,82, saillie, 3m,63; ces tours présentent aussi à l’intérieur une légère saillie de 0m,50. Grosse tour du nord-ouest: front, 7m,70, saillie, 4m,30, largeur de la porte, 2m,90.) Peut-être toute cette partie de l’enceinte, construite en grandes pierres, est-elle d’une époque plus ancienne; mais je croirais plutôt qu’on a voulu défendre par une construction plus forte un point moins bien défendu par la nature, et tout ensemble accompagner par un ouvrage plus majestueux l’une des entrées, peut-être l’entrée principale de la ville. Je n’ai pas retrouvé d’autre porte dans toute l’enceinte: il est vrai que du côté du midi le mur est tout à fait ruiné ; il n’en reste plus que les fondations, qui paraissent de place en place. C’était un mur droit: il fermait l’intervalle de six cents pas entre les deux collines, le côté le plus faible de la place. En avant, du même côté, je remarquai plusieurs lignes de terrassements, qui sont probablement les traces d’ouvrages destinés à renforcer encore cette muraille.
La ville, renfermée dans cette enceinte, était petite: elle n’a guère plus d’un kilomètre dans sa plus grande largeur. Il est facile, en face de ses ruines, de se la représenter et de la reconstruire. Les deux collines pointues formaient comme deux acropoles: sur celle de l’ouest, les fondations d’un petit édifice carré sont les restes d’un fort ou d’un petit temple; quelque autre monument devait exister en regard sur l’autre colline. Les maisons s’élevaient sur les pentes, remplissant les gradins de ce cirque naturel: on suit partout les fondations des murs qui soutenaient les terres et formaient des terrasses superposées. Je n’ai jamais vu ville disposée avec plus de symétrie, et plus réellement bâtie en amphithéâtre.
Malgré toutes mes recherches, je ne rencontrai dans l’enceinte aucun fragment d’architecture ni de sculpture, mais seulement une grande quantité de débris de tuiles et de poteries. Il paraît qu’on y a trouvé pourtant des monnaies et un petit Hercule en bronze doré, que le colonel Leake vit à Ambélakia. Un paysan me montra en dehors des murs, vers le nord de la place, deux fragments de stèles funéraires de style grec, avec le couronnement creusé en coquille: l’une des inscriptions seule était lisible, et, d’après la forme des lettres, pouvait remonter au temps des derniers rois de Macédoine; elle portait deux noms grecs:
«Nicarchos, fils de Dêmarchos». Près de là les eaux ont découvert quelques tombeaux antiques: ils n’ont rien de remarquable, et sont faits tout simplement de six plaques de pierres mal jointes et mal dégrossies, avec deux autres pour le couvercle. Enfin un Turc me proposa de me faire voir de l’autre côté des collines, sur une petite butte isolée, «un berceau
«d’enfant taillé dans le rocher». Je reconnus un sarcophage creusé en plein roc: le couvercle en forme de toit gisait brisé à quelques pas.
Le colonel Leake dit qu’on trouve aux environs de Déréli «les vestiges d’une cité hellénique, mêlés à
«d’autres débris d’un âge plus récent». Mais il n’a vu ces ruines que de loin, en gravissant les pentes de l’Ossa. Pour moi, j’y ai en vain cherché quelques traces de l’époque romaine ou byzantine: je n’y ai rien trouvé qui ne fût grec. C’est du reste une raison de plus pour adopter l’opinion du savant voyageur anglais, qui place en cet endroit Gonnos ou Gonni , ville antique de la Perrhébie, dont les rois de Macédoine firent plus tard un des remparts de leur empire. Polybe et Tite-Live s’accordent à nous représenter cette ville comme située à vingt milles de Larisse, dans une position forte, à l’entrée même des gorges de Tempé : «C’est un passage toujours fermé aux ennemis
«de la Macédoine, toujours ouvert aux Macédoniens
«pour descendre en Thessalie.» Le rôle qu’elle joue dans l’histoire s’explique à merveille par ses ruines. Petite, ramassée, enveloppée dans ses collines et dans ses murailles, ce n’est pourtant pas un simple poste, comme les autres forts de Tempé, mais une vraie place de guerre, qui peut tenir une bonne garnison. Le lendemain de Cynoscéphales, le roi Philippe y vient, à une journée du champ de bataille, rassembler tranquillement les débris de son armée . Plus tard, la vue de quelques cohortes romaines campées sur les hauteurs voisines suffit pour écarter les généraux d’Antiochus, qui s’avançaient vers Tempé . La ville n’appartenait plus alors aux Macédoniens; la politique romaine l’avait remise, sous prétexte d’autonomie, aux mains moins dangereuses des Perrhèbes. La première chose que fait Persée en rallumant la guerre, c’est de s’en ressaisir. Il y met de l’infanterie et de la cavalerie, l’entoure d’un triple fossé et d’une palissade (les lignes de terrassements dont j’ai parlé sont peut-être les restes de ces ouvrages). On voit alors Persée, au fort de la lutte, se retirer et laisser sans crainte une armée romaine et un consul romain dans la Thessalie; une garnison dans Gonnos suffit à la sécurité du roi et à la garde de la Macédoine. Le consul Licinius juge du premier coup d’œil la place inexpugnable, et ne tente même pas l’assaut . Il faudra que les Romains passent par-dessus l’Olympe pour tourner cette formidable position.
Si nous remontons à des temps plus anciens, nous voyons que Gonnos était une des principales villes du petit peuple des Perrhèbes . Quelques traditions en attribuaient même la fondation à Gouneus, qui conduisait les Perrhèbes au siège de Troie . Mais Homère, qui parle de Gouneus, ne nomme pas Gonnos. Le nom de cette ville paraît pour la première fois dans Hérodote, à propos de l’invasion de Xerxès ; il disparaît de l’histoire après la conquête romaine.
Tite-Live cite plusieurs fois à côté de Gonnos le fort de Gonnocondylon, qui était voisin, mais plus avancé dans le défilé. Le roi Philippe, qui l’occupait, l’avait appelé Olympias, et les Perrhèbes le réclamaient comme une de leurs anciennes places. Il était situé sans doute sur les escarpements du bas Olympe, qui dominent Balamoutlu: on ne m’indiqua de ce côté aucunes ruines. On trouve bien dans les environs de Déréli une éminence qui garde le nom de Paléo-Kastro; mais c’est d’un tout autre côté, dans les montagnes de Kokkinopétra. Là s’élevait aussi une forteresse; à quelle époque? il n’est pas possible de le déterminer, puisqu’il ne reste que ce. vague souvenir. Celle-ci commandait un sentier, qui se dirige vers le fond de la plaine, et gagne par une montée rapide les plateaux du bas Olympe et le village de Nézéro. C’est par ce chemin que les Grecs de la montagne descendent toutes les semaines au marché de Déréli.