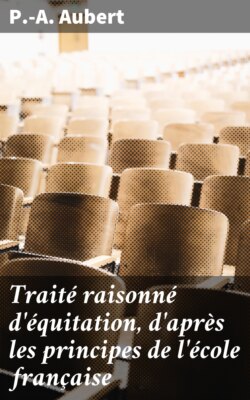Читать книгу Traité raisonné d'équitation, d'après les principes de l'école française - P.-A. Aubert - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE VIII.
Table des matières
Des Selles, rase à la française, à l’anglaise, à piquet et à la royale. — Leurs avantages et inconvéniens. (Voy. Pl. 8. )
Beaucoup de personnes sont dans une grande erreur au sujet de la selle à la française, croyant qu’on s’y tient beaucoup plus facilement qu’en selle anglaise, et c’est tout le contraire. Avec la meilleure selle à la française, il est extrêmement difficile de se maintenir dans le fond près du pommeau au grand trot d’un cheval dur; les meilleurs cavaliers sont alors obligés de chasser continuellement l’assiette en avant pour l’empêcher de s’en aller vers la croupière, et cette tendance continuelle de l’assiette à se reculer, accourcit les cuisses et les jambes, élève beaucoup les pieds au-dessus des étriers, et ne permet plus de les atteindre. Presque tous ceux qui montent à cheval par habitude, sans principes, mais qui se tiennent avec une certaine aisance sur la selle anglaise, en s’aidant par le temps pris sur les étriers, ne sauraient tenir deux tours de manège avec une selle à la française, au grand trot d’un cheval dur, et ils pourraient encore moins conserver leurs étriers; j’en ai fait souvent l’expérience au grand étonnement de ceux qui s’y sont soumis.
La selle française n’offre réellement une plus grande tenue que quand le cheval bondit surplace en se défendant, parce que les cuisses peuvent alors former une grande pression sur les quartiers qui cèdent à l’effort, chose impossible avec le quartier de la selle anglaise, qui est à la fois dur et glissant, et qui, par ces deux raisons, échappe ou neutralise la pression des cuisses et des genoux. Si celui de la selle française a ces deux défauts, il n’est plus possible de conserver sa position sans le secours des étriers, et voilà en quoi nos selles de cavalerie, dont les quartiers sont en cuir très épais et très dur, sont toujours défectueuses; car, outre leur incommodité pour le cavalier, elles le forcent à prendre son appui sur ses étriers, et le plus souvent sur la bouche de son cheval. Nul doute, cependant, que la selle française ne soit préférable pour la justesse du cavalier et pour dresser de jeunes chevaux à la connaissance des jambes: cette aide étant plus près et plus juste quand elle n’est pas séparée du corps du cheval, comme cela a lieu avec le quartier de la selle anglaise; mais pour voyager, pour chasser, la selle française ne vaut rien en ce qu’elle est plus pesante pour le cheval, et qu’elle échauffe l’assiette du cavalier.
Ce qui rend la selle anglaise la plus facile de toutes, tant que le cheval se porte en avant sans sauter, c’est qu’elle fait glisser la mauvaise assiette aussi bien que la bonne vers le pommeau ou dans le fond, et place ainsi le cavalier dans la position la plus avantageuse et la plus commode pour tenir ses étriers. C’est cette dernière difficulté, vaincue sans effort par les plus mauvais cavaliers, qui a fait adopter généralement la selle anglaise, qui a encore l’avantage d’empêcher l’assiette de s’user (s’écorcher), quoiqu’en restant des jours entiers à cheval. C’est à cela sans doute que nous devons de ne plus connaître cette maladie dangereuse, désignée anciennement par maladie des hommes de cheval, et qui provenait de l’échauffement causé par les siéges de drap et de velours.
Pour tenir en selle anglaise sans étriers, au grand trot d’un cheval bien mouvant et bien dur, il faut avoir une bonne assiette, et le mauvais cavalier ne soutiendra pas mieux cette épreuve que celle de la selle française avec des étriers.
Il ne faut cependant pas conclure de mon opinion sur la commodité de la selle anglaise, qu’on peut s’en servir pour la leçon des commençants, qui doit toujours avoir lieu sans étriers. Dans ce cas, je suis le premier à la bannir du manège. Je ne connais, pour déterminer tout de suite la bonne assiette dès la première leçon, par conséquent la bonne position en général et la fixité de la main de la bride, que la selle demi-piquet, et pour moi, je ne verrais pas d’inconvénient de faire passer l’élève de cette dernière à la selle anglaise recouverte en veaulasc. Je dis encore qu’il est possible de mener un cheval très finement en selle anglaise, pourvu que cette selle ne soit ni trop dure, ni trop plate de siége, et qu’elle porte juste sur le cheval.
Quant à la selle à piquet, tout partisan que j’en suis pour la leçon des commençants, et pour monter les sauteurs, je ne voudrais jamais m’en servir avec les chevaux qui se défendent, qui sont susceptibles de se renverser ou de s’abattre, car on pourrait se blesser étant engagé dans cette selle, et ce danger devient plus grand, quand les cuisses sont assez grosses pour en remplir toute la capacité. C’est bien pour rendre cet inconvénient moins grave que je préfère la selle demi-piquet, telle que M. d’Abzac l’avait adoptée dans les derniers temps au manège de Versailles.
Quant à la selle à la royale ( on la nommait ainsi parce qu’elle avait été inventée pour la commodité de Louis XIV, devenu vieux), elle ne diffère de la selle rase que par un troussequin très bas; on ne s’en sert plus depuis longtemps que pour les personnes très âgées et faibles.
L’emploi de la couverture de pied est très bon pour donner de l’assiette et pour monter les jeunes poulains que la croupière ferait défendre. Autrefois, les marchands ne montraient jamais les chevaux de vente qu’en couverture à la marchande. Cette ouverture de plusieurs couleurs éclatantes faisait paraître le cheval à son avantage. Il y avait beaucoup d’art à la placer de manière à faire disparaître les difformités les plus apparentes du corps, de la croupe et des épaules, et le meilleur connaisseur s’y trompait souvent.