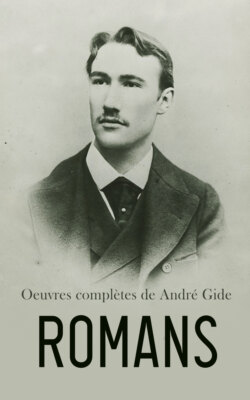Читать книгу Oeuvres complètes de André Gide: Romans - Андре Жид - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VOYAGE SUR UNE MER GLACIALE
ОглавлениеTable des matières
Un ciel d'aurore un peu tardive ; des lueurs pourpres sur la mer où des glaces bleu pâle s'irisent. Un réveil un peu frissonnant à cause de l'air très limpide, où ne jouaient plus de brises tièdes. La terre boréale où nous avions laissé la veille Ellis la pâle et nos quatre compagnons malades, encore à peine visible au loin achevait de disparaître ; une buée délicate qui tout à l'horizon liait le ciel aux dernières vagues, semblait la soulever et l'assoupir. Tous les huit assemblés sur le pont pour une matinale prière, sérieux mais non pas triste, un hymne tranquille monta du navire ; une allégresse séraphique nous remplit comme le jour où nous avions bu l'eau cristalline de la source. Donc sentant nos volontés joyeuses, pour ne pas laisser qu'elles s'éparpillent, mais bien nous saisir d'elles et le sentir, je leur dis :
« Les dures épreuves sont passées. Maintenant sont loin les berges moroses où nous pensions mourir d'ennui, plus loin encore les plages aux joies défendues ; sachons nous dire heureux de les avoir connues. On ne peut arriver ici que par elles ; vers les cités les plus altières vont les routes les plus pénibles ; nous allons vers la cité divine. Le soleil est un peu rose d'avoir été si terne hier. Dans les résistances d'abord se sont senties nos volontés ; et le désœuvrement sur les pelouses grises ne nous fut pas, lui non plus, inutile, car le paysage, en fuyant, laissait nos volontés toutes libres ; à cause de l'ennui, nos âmes indéterminées dans les campagnes ont pu se développer très sincères. Et quand nous agirons, maintenant, ce sera certes selon nos voies. »
Le soleil se levait comme nous commencions nos prières ; la mer rayonna de splendeurs reflétées ; des rayons glissaient sur les vagues, et les banquises illuminées, émues et vibrantes, frémirent.
Vers le milieu du jour quelques baleines parurent ; elles nageaient en un troupeau, plongeant devant les banquises ; on les voyait reparaître plus loin ; mais elle se tinrent distantes du navire.
Il fallait maintenant se garer des montagnes de glace ; les vagues pas encore très froides fondaient lentement leur base ; soudain on les voyait chavirer, leur cime prismatique croulait, disparaissait dans la mer secouée, remuait l'eau comme un orage, ressortait avec des cascades aux flancs, et dans la vague tumultueuse longtemps oscillait encore, incertaine de sa posture. Le fracas majestueux de leur chute bondissait sur les flots sonores. Parfois des murs de glace tombaient dans des jaillissements d'écume, et toutes ces montagnes mouvantes se transformaient incessamment.
Il en vint vers le soir une si grande qu'elle n'était plus transparente ; nous la prîmes d'abord pour une terre nouvelle couverte d'immenses glaciers. Des ruisseaux tombaient de ses cimes ; des ours blancs couraient sur ses bords. Le navire passa si près que ses grandes vergues, accrochées à quelque arête surplombante, brisèrent des glaçons fragiles.
Il en vint qui portaient en elles d'énormes pierres, arrachées du glacier natal, et promenaient ainsi sur les flots des fragments de roche inconnue.
Il en vint d'autres qui, rapprochées par une affinité subite, avaient emprisonné des baleines ; plus élevées que l'eau elles semblaient nager dans l'air. Penchés sur le pont nous regardions voguer les banquises.
Le soir tomba. Au soleil couchant les montagnes parurent d'opale. Il en arriva de nouvelles ; elles apportaient des algues laminées, fines et longues comme des chevelures ; on croyait des sirènes captives ; puis ce fut un réseau ; la lune au travers apparut, comme une méduse au filet, comme une holothurie nacrée ; puis dégagée, nageant dans l'air libre, la lune se fit azurée. Des étoiles pensives erraient, tournaient, s'enfonçaient dans la mer.
Vers le milieu de la nuit apparut un vaisseau gigantesque ; la lune l'éclairait mystérieusement ; ses agrès étaient immobiles ; aucune lueur sur le pont. Il passa près de nous ; on ne l'entendait pas voguer, et pas un bruit dans l'équipage. Nous comprîmes enfin qu'il était pris dans de la glace, entre deux banquises qui s'étaient sur lui refermées. Il passait ainsi, tranquille, et disparut.
Vers le matin, peu avant l'aube, à l'heure où la brise fraîchit, vint voguer près de nous un îlot de glace très pure ; au milieu, comme un fruit enchâssé, comme un œuf de merveilles luisait une immortelle pierrerie. Étoile du matin sur la vague, nous ne pouvions nous lasser de la voir. Elle était pure comme un rayon de la Lyre ; à l'aurore elle vibra comme un chant ; mais sitôt que vint le soleil, la glace qui l'enveloppait fondue la laissa tomber à la mer. – Ce jour-là nous avons péché la baleine.
Ici cessent les temps des souvenirs, commence mon journal sans date.
Dans l'abîme ébloui d'écume et de tempêtes, où nul homme jamais n'effaroucha les fêtes sauvages des albatros et des eiders, – plongeur qu'un câble élastique balance, Éric est descendu, brandissant au bout de son bras nu le large couteau tueur de cygnes. Un souffle humide monte d'en bas où s'agitent les vagues vertes, et le vent chasse de l'écume. Les grands oiseaux effarouchés tournoient et l'étourdissent de coups d'ailes. Nous, penchés, accrochés au roc où le câble tendu s'attache, nous regardons : Éric est au-dessus des nids ; il descend au milieu de cette tourmente ; dans les plumes couleur de neige et dans le duvet précieux, les petits eiders sommeillent ; Éric tueur d'oiseaux pose la main sur la couvée ; les petits réveillés s'agitent et pris de peur veulent fuir ; mais Éric plonge le couteau dans les plumes et rit de sentir sur ses mains le sang tiède de la couvée. Le sang ruisselle sur les plumes, et les ailes qui se débattent en éclaboussent le rocher. Le sang ruisselle sur la vague, et le duvet éparpillé s'envole, taché d'écarlate. Les grands oiseaux épouvantés veulent protéger la couvée ! Éric, que leurs griffes attaquent, d'un coup de couteau les abat. Et alors monte de la vague, emporté par le vent marin, un tourbillon d'écume affolée, entre les parois de falaise, blanc comme le duvet des cygnes, et qui monte, qui monte, qui monte, et chassé désespérément avec les plumes et les plumes, disparaît dans le ciel qu'on voit, gouffre bleu, lorsqu'on lève la tête.
Sur ces falaises schisteuses, les guillemots font leur nid. Les femelles restent perchées ; les mâles volent alentour ; ils crient d'une façon très aiguë, et les cris et le bruit des ailes assourdissent sitôt que l'on approche d'eux. Ils volent en armée si nombreuse, qu'ils font une nuit lorsqu'ils passent ; ils tournoient incessamment. Les femelles rangées les attendent, graves, immobiles et sans cris, en file sur une crête immense où le rocher surplombe un peu. Elles couvent leur œuf unique. Elles l'ont posé là vite, pas même dans un nid, mais sur le roc glissant en pente ; elles l'ont fait comme une fiente. Sur l'œuf elles se tiennent assises, rigides et sérieusement, entre leurs pattes et leur queue le maintenant pour qu'il ne roule.
Le navire s'aventura entre deux parois de falaise, dans un fiord étroit, ténébreux ; on voyait dans l'eau transparente, à des profondeurs ignorées, les roches s'enfoncer toutes droites ; de sorte que parfois il semblait que ce fût le reflet des falaises ; mais la profondeur était sombre et la falaise blanche d'oiseaux. Les mâles au-dessus de nos têtes poussaient de tels cris que nous ne pouvions nous entendre. Nous avancions très lentement ; eux ne semblaient pas nous voir. Mais sitôt qu'Éric, habile frondeur, eut lancé contre eux quelques pierres et, dans cette opaque nuée, de chaque pierre en eut tué plusieurs qui tombèrent auprès du navire, alors tous les cris redoublés affolèrent sur les roches les femmes ; quittant le rocher nuptial, l'espoir de la progéniture, toutes s'envolèrent en poussant des clameurs horriblement stridentes. Ce fut une épouvante d'armée ; nous étions honteux du vacarme, et surtout lorsque nous vîmes tous les œufs malheureux délaissés, plus maintenus contre la pierre, dégringoler de la falaise. Cela fit tout le long du roc, les coquilles s'étant brisées, d'horribles traînées blanches et jaunes. Certaines couveuses plus dévouées tentèrent en s'envolant d'emporter l'œuf entre leurs pattes, mais leur œuf bientôt échappé s'était éclos sur la mer bleue. L'eau des vagues s'était salie. Nous étions confus du désordre et nous enfuîmes en grande hâte, car de toutes parts commençait à s'élever l'odeur affreuse des couvées.
... Le soir, à l'heure des prières, Paride n'étant pas de retour, nous le cherchâmes et l'appelâmes jusqu'à la nuit, mais ne pûmes savoir ce qu'il était devenu.
Les Esquimaux vivent sous des huttes de neige ; dans la plaine, à les voir, on croirait des tombeaux ; mais l'âme avec le corps est enfermée ; un peu de fumée, de la hutte, monte vers le ciel. Les Esquimaux sont laids ; ils sont petits ; leurs amours n'ont pas de tendresses ; ils ne sont pas voluptueux et leur joie est théologique ; ils ne sont ni méchants ni bons ; leur cruauté n'est pas émue. Le dedans de leur hutte est noir ; on peut à peine y respirer. Ils ne travaillent ni ne lisent ; ils ne sommeillent pas pourtant ; une petite lampe allumée troue un peu la nuit des veillées ; comme la nuit est immobile, ils n'ont jamais su ce qu'est l'heure ; comme ils n'ont pas à se presser, leurs pensées sont lentes ; l'induction leur est inconnue, mais sur trois maigres points posés ils déduisent une métaphysique ; et la suite de leurs pensées, jusqu'au bout interrompue, descend de Dieu jusqu'à l'homme, leur vie devient cette suite ; ils mesurent l'âge qu'ils ont au point où ils sont parvenus ; il en est qui n'ont jamais pu parvenir à leur existence ; il en est qui s'en sont aperçus. Ils n'ont pas de langue commune ; ils calculent infiniment. Ah ! je pourrais encore en dire, car je les ai très bien compris. Ils sont rabougris, leur face est camuse, parce qu'ils n'y font pas attention. Leurs femmes sont sans maladies ; ils font l'amour dans les ténèbres.
Je parle des Esquimaux sensés ; il en est qui, à l'aube du jour solennel, coupant le cours des syllogismes, s'en vont sur la mer gelée et dans la neige un peu fondue chasser le grand renne et le morse. Ils pêchent aussi des baleines et reviennent avec la nuit, tout chargés de graisses nouvelles.
Chaque climat a ses détresses ; chaque terre ses maladies. Nous avions vu dans les îles tièdes la peste ; près des marais les maladies de langueur. Une maladie maintenant naissait de l'absence même des voluptés. Les salaisons, le manque d'herbes fraîches et cette résistance assidue où s'exhalait notre fierté ; la joie de vivre mal dans les terres méchantes, et cet acharnement du dehors où s'amusait l'âme ravie usait nos forces à la longue, et tandis que les âmes alors eussent voulu, sereines, s'élancer vers les suprêmes conquêtes, le scorbut dont nous commencions tous à souffrir nous retenait accablés sur le pont du navire, tremblant de la peur de mourir avant d'avoir fini nos tâches. Ô ! tâches élues ! les plus chères. Quatre jours nous restâmes ainsi, non loin de la terre attendue dont on voyait les pics de glace plonger dans la mer dégelée ; et je crois bien que se fût arrêté là notre voyage, sans l'exquise liqueur qu'Éric dans la hutte des Esquimaux avait prise.
Notre sang était devenu trop fluide ; il s'échappait de toutes parts ; il suintait des gencives, des narines, des paupières, de sous les ongles ; il semblait parfois n'être plus que comme une humeur stagnante et cesser presque de circuler ; le moindre mouvement le déversait à flots comme d'une coupe penchée ; sous la peau, aux places les plus tendres, il faisait des taches livides. Nous sentions dans la tête, ce vide, ce vertige de la nausée ; notre nuque était douloureuse ; à cause de nos dents trop faibles qui branlaient dans leurs alvéoles, le biscuit de mer sec nous était une nourriture impossible ; cuit dans l'eau il faisait une bouillie épaisse où nos dents se prenaient et restaient. Les grains de riz écorchaient nos gencives ; nous ne pouvions presque que boire. Et sur le pont couchés, sans force, tout le jour nous rêvions aux fruits mûrs, aux fraîches pulpes savoureuses, aux fruits des îles de jadis, des îles pernicieuses. Mais même alors je crois que nous eussions refusé d'y goûter. Nous nous réjouissions que Paride ne fût plus là et ne connût pas nos souffrances. Mais la liqueur hémostatique vint à bout de la maladie.
C'était le soir du dernier jour ; le soleil de toute une saison avait disparu dans les terres ; une lueur crépusculaire demeurait longtemps après lui. Le soleil était tombé sans agonie, sans cette pourpre sur les nuages ; il avait disparu lentement ; des rayons réfractés nous en venaient encore. Mais déjà les grands froids commençaient ; la mer autour de nous regelée avait emprisonnée le navire. Les glaces, d'heure en heure plus serrées, menaçaient incessamment de le briser ; ce n'était pour nous que le plus tremblant des asiles ; nous résolûmes de le quitter. Mais je veux surtout que l'on sache que ce ne fut ni par désespoir ni par prudence timorée, mais bien par une volonté de folie, car nous pouvions encore, rompant la glace, fuir l'hiver et partir vers où le soleil avait fui ; mais c'eût été vers le passé. Donc préférant les rives les plus dures, pourvu qu'elles fussent futures, c'est vers la nuit que nous marchâmes, notre jour étant accompli. Nous savions que le bonheur n'est pas fait de l'abandon de la tristesse ; nous allions, fiers et forts, au-delà des pires détresses, où trouver la plus pure joie.
Ayant attelé le grand renne au traîneau construit de morceaux du navire, nous commençâmes de le charger de bois, de haches et de câbles. Les derniers rayons s'éteignaient, nous allions monter vers le pôle. Il était un endroit sur le pont du navire, caché par les amas de cordages ; nous n'y passions jamais. Ah ! triste adieu du jour, lorsque pour quitter le navire, je parcourus le pont tout entier ! derrière les enroulements de câbles, lorsque je les défis pour les prendre, hélas ! ah ! que vis-je ? – Paride ! – Nous l'avions vainement cherché ; je pensai que trop faible pour remuer, et trop malade pour répondre, il s'était caché là comme les chiens qui cherchent un coin pour mourir. Mais était-ce encore Paride ? – Il était sans cheveux, sans barbe ; on voyait blanches sur le plancher ses dents autour de lui crachées. Sa peau s'était déchiquetée ainsi qu'une étoffe passée ; elle était violette et nacrée ; rien n'était plus pénible à voir. Ses yeux n'avaient plus de paupières, et je ne compris pas d'abord si c'était nous qu'il regardait car il ne pouvait plus sourire. Comme un fruit sortant de sa bouche, ses gencives énormes, gonflées, tuméfiées et spongieuses repoussaient, déchiraient ses lèvres ; on voyait au milieu, dressée, une dent blanche, sa dernière. Il voulut me tendre la main ; ses os trop fragiles cassèrent. Je voulus lui serrer la main ; elle se défit dans la mienne en me laissant entre les doigts du sang et de la pourriture. Je pense qu'il vit des larmes dans mes yeux, car il sembla comprendre alors que c'était lui que je pleurais, et je pense qu'il gardait encore sur son état quelque espérance que mes pleurs de pitié lui ôtèrent, car soudain il fit un cri rauque et qui devait être un sanglot, et avec la main que je n'avais pas en la lui serrant écrasée, dans un geste de désespoir, tragique et vraiment perdu, saisissant la dent et ses lèvres, ironique et comme en riant, il s'arracha tout à coup un grand lambeau de figure puis retomba déjà fini.
Ce soir, pour un grand deuil et pour l'adieu, nous avons brûlé le navire. La nuit venait majestueuse, et s'établissait lentement. Les flammes jaillirent en triomphe ; la mer en fut incendiée ; les grands mâts, les poutres brûlèrent, et quand, le vaisseau consumé, les flammes pourpres retombèrent, laissant l'irréparable passé, nous partîmes vers la mer du Pôle.
Silence de la nuit sur la neige. – De la nuit. – Solitude, et c'est toi, tranquille apaisement de la mort. Vaste plaine sans heures ; les rayons du jour se sont retirés. Toutes formes se sont gelées ; c'est le froid sur la calme plaine, et l'immobilité – et l'immobilité. Et la sérénité. Ô pur ravissement de notre âme ! rien ne s'émeut dans l'air, mais, tant les banquises sont vives, plane un rayonnement figé. Tout est du bleu pâle nocturne – dirai-je, la lune ? – La Lune. – J'ai cherché loin de tout la prière ; et c'est le paysage extasié. Ellis ! toi qui n'es pas celle que j'ai trouvée ; fraîche Ellis, est-ce ici que tu m'as attendu ? J'irais plus loin encore, mais j'attends ta parole, – et tout sera bientôt fini. – J'ai cherché sa forme perdue – et mon âme a dit sa prière. Puis la nuit a repris son silence, et toute sa sérénité.
Pourquoi donc attendre une aurore ? On ne sait plus quand elle viendra. L'heure ne vaut pas qu'on l'attende. Après un peu de sommeil dans la nuit, nous avons marché vers le Pôle.
Gypses purs ! carrières salines ! marbres blancs des sépulcres ! micas ! C'est la blancheur dans les ténèbres. Givres légers, qui seriez au soleil des sourires ; parures de cristal sur la nuit ; touffes de neiges ! avalanches figées ! – dunes de poussière de lune, – plumes d'eiders sur l'écume des flots, – pics de glace aux espérances taciturnes ! – Nous avons marché dans la neige, et sans cette hâte du temps, car les heures sont écoulées ; la lenteur grave de nos gestes en faisait la solennité. Tous les sept – Alain, Axel, Morgain, Nathanaël, Ydier, Éric et moi – nous marchions ainsi vers nos tâches.
Ils dormaient ; la hutte était tranquille ; dehors, une nuit sans étoiles sur la plaine de givre étendue ; au-dessus de la plaine, à cause de sa candeur, la nuit était un peu pâlie ; une lueur était éparse sur la terre ; je cherchais un lieu pour prier. Comme j'allais m'agenouiller et que je commençais ma prière, je vis Ellis. Elle était assise, pensive, près de moi, sur une roche ; sa robe était couleur de neige ; ses cheveux plus noirs que la nuit.
« Ellis ! c'est donc toi, sanglotai-je ; ah ! je t'avais bien reconnue. »
Mais elle était silencieuse, et je lui dis :
« Ignores-tu quelle triste histoire j'ai vécue depuis que je t'avais perdue ? quelles campagnes désolées j'ai traversées depuis que ta main plus ne me guide ? Sur une berge, un jour, je pensais t'avoir retrouvée ; mais ce n'était qu'une femme : ah ! pardonne ! je t'ai si longtemps souhaitée. Où me mèneras-tu désormais dans cette nuit proche du Pôle, Ellis ! ma sœur ?
– Viens », me dit-elle. Et m'ayant pris par la main elle me conduisit sur une roche haute d'où l'on apercevait la mer. Je regardai, et soudain la nuit se déchira, s'ouvrit, et se déploya sur les flots toute une aurore boréale. Elle se reflétait dans la mer ; c'étaient de silencieux ruissellements de phosphore, un calme écroulement de rayons ; et le silence de ces splendeurs étourdissait comme la voix de Dieu. Il semblait que les flammes pourpres et roses, incessamment agitées, fussent une palpitation de la Volonté divine. Tout se taisait ; mes yeux éblouis se fermèrent ; mais Ellis ayant mis un doigt sur ma paupière, j'ouvris les yeux et je ne vis plus qu'elle.
« Urien ! Urien, triste frère ! que ne m'as-tu toujours rêvée ! Souviens-toi de nos jeux de jadis. Pourquoi voulus-tu, dans l'ennui, recueillir ma fortuite image ? Tu savais pourtant bien que ce n'était pas l'heure et que ce n'était dès là-bas que posséder était possible. Je t'attends au-delà des temps, où les neiges sont éternelles ; ce sont des couronnes de neige, non pas de fleurs que nous aurons. Ton voyage va finir, mon frère. Ne regarde plus vers jadis. Il est encore d'autres terres, et que tu n'auras pas connues ; que tu ne connaîtras jamais. Que t'eût servi de les connaître ? Pour chacun la route est unique et chaque route mène à Dieu. Mais ce n'est pas dès cette vie que tes yeux pourront voir sa gloire. La pauvre enfant que tu croyais me reconnaître, – et comment t'es-tu pu méprendre ? – tu lui disais de cruelles paroles ; et puis tu l'as abandonnée. Elle ne vivait pas ; tu l'as faite ; il te faudra l'attendre maintenant ; car cette âme ne pourrait seule monter vers la cité de Dieu. Ah ! j'aurais souhaité que, tous deux, nous fissions la route étoilée, ensemble, seuls, vers les pures lumières. Il te faudra guider cette autre. Vous finirez votre voyage ; mais cette fin n'est pas la vraie ; rien ne finit qu'en Dieu, mon frère ; donc ne te décourage pas quand tu croiras te pencher sur la mort. Derrière un ciel en est un autre : les fins reculent jusqu'à Dieu. Mon frère bien-aimé, tiens ferme l'Espérance. »
Puis s'étant penchée sur la neige, elle écrivit en lettres embrasées ce que, m'étant agenouillé, je pus lire :
ILS N'ONT PAS ENCORE OBTENU CE QUE DIEU LEUR AVAIT PROMIS – AFIN QU'ILS NE PARVINSSENT PAS SANS NOUS À LA PERFECTION.
Je voulais encore lui parler, lui demander de me parler encore, et je tendais les mains vers elle ; mais elle, au milieu de la nuit, me montra de sa main l'aurore, et s'étant lentement relevée, comme un ange chargé de prières, reprit le chemin séraphique. À mesure qu'elle montait sa robe devenait nuptiale ; je voyais qu'elle était tenue à des épingles d'escarboucles ; elle rayonnait de tous les rayons des sept mystiques pierreries ; et bien que leur éclat fût tel qu'il eût consumé les paupières, une si céleste douceur ruisselait de ses mains tendues, que je ne sentais pas la brûlure. Elle ne regarda plus vers moi ; je la voyais toujours plus haute ; elle atteignit les portes enflammées ; derrière une nuée elle allait disparaître... Alors une lumière beaucoup plus blanche m'éblouit, et, la nuée s'étant ouverte, je vis des anges. Ellis était au milieu d'eux, mais je ne pouvais la reconnaître ; chaque ange, de ses deux bras levés, agitait ce que j'avais pris pour l'aurore, qui n'était qu'un rideau retombé devant les clartés immortelles, et chaque flamme c'était un voile où transparaissait la Lumière. De grands rayons glissaient sous les célestes franges – mais les anges ayant écarté le rideau, un tel cri jaillit dans la nue que, la main sur les yeux, je fus prosterné de terreur.
Quand je me relevai, la nuit s'était refermée ; on entendait au loin la mer. Étant retourné vers les huttes je trouvai mes compagnons encore endormis ; je me couchai près d'eux, accablé de sommeil.
Marche vers le Pôle. De l'excessive blancheur des choses naît une certaine clarté ; un rayonnement les entoure. Il souffle une tourmente de neige, et la neige chassée, soulevée, s'étale, circule, se roule, a des ondulements, des courbes d'étoffes ou de chevelures. Notre route sans cesse obstruée faisait notre marche très lente ; il fallait tailler dans la glace des couloirs et des escaliers. Je ne veux pas parler de nos travaux ; ils étaient si pénibles, si durs, que les raconter semblerait s'en plaindre. Je ne veux non plus parler ni du froid, ni de nos souffrances ; – il serait dérisoire de dire : nous avons terriblement souffert, – tant ce qu'on s'imaginerait à ces paroles serait moindre. Je n'arriverais pas, par des mots, à dire cette suprême âcreté de la souffrance ; cette souffrance, je n'arriverais pas à la dire assez âcre pour qu'en naisse comme une joie, un orgueil ; ni du froid la morsure enragée.
Vers l'extrême nord se dressait une étrange paroi de glace ; un bloc énorme et prismatique était posé là comme un mur. Une sorte de route y menait, un ravin de neige profonde, et par-dessus cette muraille, un tourbillon de neige, chassée je pense par un vent monotone, retombait dans cette vallée. Sans les cordes qui nous maintenaient les uns aux autres attachés, nous eussions enfoncé dans la neige. Nous fûmes bientôt si las de marcher dans cette tourmente, que, malgré le danger de se coucher sur la neige, nous nous sommes étendus pour dormir. Nous étions à l'abri derrière un bloc de glace ; le vent soufflait la neige par-dessus ; la paroi formait une grotte. Nous étions couchés sur les planches du traîneau et sur la peau du renne tué.
Pendant le sommeil des six autres, je sortis seul de la grotte pour voir si la neige cessait. À travers le linceul des neiges, c'est près d'un rocher de blancheur que j'ai cru voir Ellis pensive. Elle ne semblait pas me voir ; elle regardait vers le Pôle ; ses cheveux étaient dénoués ; le vent les secouait sur elle. Je n'ai pas osé lui parler parce qu'elle semblait trop triste, et je doutais que ce fût elle. Et comme je ne pouvais à la fois être triste et finir ce voyage, je m'en suis retourné dormir.
La neige passe maintenant au-dessus de nos têtes, à cause de la violence même du vent. Nous sommes au pied du grand mur. Un bizarre couloir y mène. Le mur, poli comme un miroir et transparent comme du cristal, en face du couloir s'enfonce. Une place est là, où la neige, trop légère, n'est pas tombée. Le sol est transparent aussi. C'est sur ce mur et c'est alors que, nous étant penchés avec le pressentiment des détresses, nous lûmes, écrit comme avec un diamant sur du verre, et comme la voix d'un tombeau, ces deux mots :
HIC DESPERATVS
et puis une date effacée.
Et c'est sous ces mots que nous vîmes, nous étant d'un commun geste agenouillés – que nous vîmes un cadavre couché dans la transparence de la glace. La glace, sur lui refermée, l'avait pris comme en un sépulcre, le grand froid dont elle l'enveloppait l'avait empêché de pourrir. On voyait sur ses traits, il semblait, une épouvantable fatigue. Il tenait un papier d'une main.
Nous sentions que nous étions arrivés presque à la fin de notre voyage ; pourtant nous nous sentions encore assez de forces pour gravir la muraille gelée, nous doutant bien que le but était derrière, mais ne sachant pas ce qu'il était. Et maintenant que nous avions tout fait pour l'atteindre, cela nous devenait presque inutile de le savoir. Nous restions encore à genoux, devant cette tombe inconnue, sans émotion, sans pensée, car nous en étions à ce point où l'on ne peut plus compatir sans pleurer aussi sur soi-même, où l'on détourne les yeux des tristesses parce qu'on a besoin de sa force. Le cœur n'arrive à la vaillance que par un endurcissement. Et c'est pour cela, plus encore que pour ne pas violer la sépulture, que nous n'ouvrîmes pas la glace, malgré notre désir de lire les lignes du papier que le cadavre tenait en main. Après une brève prière nous nous relevâmes et commençâmes de gravir péniblement le mur de glace.
Je ne sais pas comment naissait le vent qui faisait la tourmente, car, sitôt la muraille franchie, le vent cessa, ce fut une atmosphère presque douce. L'autre côté de la muraille dévalait en colline, pente douce de neige amollie. Puis c'était une ligne d'herbes ; puis une petite mer dégelée. Je pense que la muraille autour était parfaitement circulaire, car les pentes s'étageaient régulièrement, et comme plus aucun vent, dans ce cirque clos, ne soufflait, l'eau du lac restait apathique.
Nous pensions bien que c'était la fin ; on ne pouvait plus aller plus loin ; mais sachant que si nous descendions sur la rive, nous ne saurions plus qu'y faire, pour inventer quelque conclusion, ou quelque geste qui la motive, nous eûmes la pieuse idée de revenir chercher le cadavre inconnu pour l'enterrer sur la rive attendue. Car nous pensions que c'était aussi pour la voir qu'il était venu jusque-là, et déplorions que, si près du but, il n'ait pourtant pas pu l'atteindre.
Donc, étant revenus près de la tombe, nous ouvrîmes la glace pour prendre le cadavre, mais quand nous voulûmes lire le papier qu'il tenait, nous reconnûmes que ce papier était complètement blanc ; cette déception nous fut extrêmement pénible, car alors nos curiosités retombaient. Puis ayant transporté ce corps sur la petite rive polaire, nous eûmes, sans parler, ce sentiment qu'il valait mieux peut-être qu'il n'eût pas vu cette rive attendue et qu'une muraille l'ait séparé, vivant encore, de son but, car il eût peut-être, sinon, gravé les mêmes mots sur sa tombe.
Une aube incolore naissait ; et dans une dernière action, voulant empêcher nos pensées, nous creusâmes une fosse dans l'herbe, entre la neige et l'eau du lac.
Nous ne sentions plus de désirs de revenir revoir des contrées plus fleuries ; c'eût été le passé sans surprises ; on ne redescend pas vers la vie. Si nous avions su d'abord que c'était cela que nous étions venus voir, peut-être ne nous serions-nous pas mis en route ; aussi nous avons remercié Dieu de nous avoir caché le but, et de l'avoir à ce point reculé que les efforts faits pour l'atteindre nous donnassent déjà quelque joie, seule sûre ; et nous avons remercié Dieu de ce que les souffrances si grandes nous faisaient espérer une fin si splendide.
Nous eussions bien voulu inventer à nouveau quelque frêle et plus pieuse espérance ; ayant satisfait notre orgueil et sentant que de nous ne dépendait plus l'accomplissement des destinées, nous attendions maintenant que les choses, autour, nous devinssent un peu plus fidèles.
Et nous étant encore agenouillés, nous avons cherché sur l'eau noire le reflet du ciel que Je rêve.