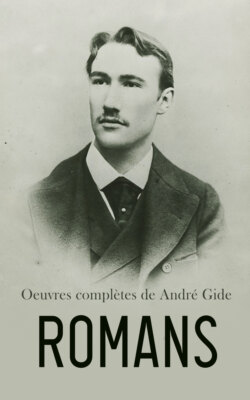Читать книгу Oeuvres complètes de André Gide: Romans - Андре Жид - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеNuit sur mer. Nous avons causé nos destinées. Nuit pure ; l'Orion vogue entre des îles. La lune éclaire des falaises. Des récifs bleus se sont montrés : le veilleur les a signalés ; le veilleur a signalé des dauphins ; ils jouaient au clair de lune ; près des récifs, ils ont plongé pour ne plus reparaître ; les roches bleues luisent faiblement sous les flots. Des méduses illuminées montent s'épanouir à l'air nocturne, lentement de la mer profonde, fleurs des mers remuées par les flots. Les étoiles rêvent. Nous, penchés à l'avant du navire, près des cordages et sur les flots, tournant le dos aux équipages, aux compagnons, à tout ce qui se fait, nous regardons les flots, les constellations, et les îles. – Nous regardons passer les îles, disent les hommes du bord, qui nous méprisent un peu, lorsqu'en se regardant ils oublient qu'eux sont les passagers et que ces choses-là demeurent – pareilles, derrière notre fuite.
Aspects changeants des massifs de falaises, et les promontoires allongés qui chavirent ! berges ! métamorphoses des berges ! nous savons maintenant que vous restez ; c'est en passant que l'on vous voit passantes, et votre aspect change par notre fuite, malgré votre fidélité. – Le veilleur de nuit signale des navires. Nous, penchés sur les flots depuis le soir jusqu'au lever du jour, nous apprenons à discerner les choses qui passent d'entre les îles éternelles.
Cette nuit, nous avons parlé du passé ; nul de nous ne savait comment il avait pu venir jusqu'au navire, mais nul ne regrettait l'amère nuit de pensées.
« De quel obscur sommeil me suis-je éveillé, dit Alain, de quelle tombe ? Je ne cessais de penser et je suis encore malade. Ô nuit orientale et calmée, enfin reposeras-tu ma tête lasse de penser Dieu ?
– J'étais tourmenté d'un désir de conquête, dit Paride ; je marchais dans ma chambre plein de vaillance, mais triste et, de rêver toujours des héroïsmes, plus fatigué que de les faire. Qu'allons-nous conquérir maintenant ? quelles seront nos prouesses ? où allons-nous ? dites ! savez-vous où va nous mener ce navire ? Aucun de nous ne le savait, mais tous nous frémissions au sentiment de nos courages.
– Que faisons-nous ici, reprit-il, et qu'est-ce donc que cette vie, si celle d'avant était notre sommeil ?
– Peut-être alors que nous vivons notre rêve, dit Nathanaël, pendant que dans la chambre nous dormons.
– Ou si nous cherchons des pays pour raconter nos belles âmes ? » dit Mélian.
Mais Tradelineau s'écria :
« Sans doute, l'habitude des vaines logiques et cette manie de croire que vous ne ferez bien que ce dont vous connaîtrez bien les causes, vous tient encore et motive cette discussion oiseuse. Qu'importe de savoir comment nous sommes venus ici, et pourquoi chercher à notre présence sur l'Orion de très mystérieux motifs ? Nous avons quitté nos livres parce qu'ils nous ennuyaient, parce qu'un souvenir inavoué de la mer et du ciel réel faisait que nous n'avions plus foi dans l'étude ; quelque chose d'autre existait ; et quand les brises balsamiques et tièdes sont venues soulever les rideaux de nos fenêtres, nous sommes descendus malgré nous vers la plaine et nous nous sommes acheminés. Nous étions las de la pensée, nous avions envie d'action ; avez-vous vu comme nos âmes se sont révélées joyeuses lorsque, prenant aux rameurs les lourds avirons, nous avons senti l'azur liquide résister ! Oh ! maintenant, laissons-nous aller ! l'Orion saura nous guider vers des plages. Nos vaillances que nous sentons appelleront d'elles-mêmes nos prouesses ; attendons sans penser à tout – attendons venir nos glorieuses destinées. »
Cette nuit, nous avons aussi parlé de la ville tumultueuse où nous nous étions embarqués, de ses foires et de la foule.
« Pourquoi, dit Agloval, penser encore à ces gens-là, dont les yeux ne voyaient que les choses et qui ne s'étonnaient même pas ? Moi j'aimais Bohordin qui sanglotait aux jeux du cirque ; on devrait tout faire comme un rite ; ces gens regardaient les jeux sans solennité.
– Qu'en pensez-vous, Urien ? » me dit Angaire.
Et je répondis :
« Il faut toujours représenter. »
Puis, comme cette discussion nous devenait à tous insupportable et que penser nous fatiguait, nous promîmes de ne plus nous parler du passé, ni de raisonner sur les choses. Le matin venait ; nous nous sommes quittés pour dormir.
Nous avions perdu de vue les côtes et nous voguions depuis trois jours en mer pleine, lorsque nous rencontrâmes ces belles îles flottantes qu'un courant mystérieux longtemps a poussées près de nous. Et cette fuite parallèle au milieu des vagues éternellement agitées nous faisait croire d'abord l'Orion immobile, échoué peut-être dans le sable : mais notre erreur n'a pas duré quand nous avons mieux vu les îles. Une barque nous descendit sur l'une d'elles ; elles étaient toutes presque pareilles et distantes également. Leur forme régulière nous les fit croire madréporiques, elles eussent été assurément très plates sans cette végétation luxuriante et magnifique qu'elles portaient ; elles étaient à l'avant légèrement escarpées, récifs de madrépores, gris comme des pierres volcaniques, où les racines se dénudaient ; à l'arrière elles flottaient comme des chevelures, racines par la mer rougies. Des arbres d'essences inconnues, des arbres bizarres pliaient sous les lourdes lianes, et des orchidées maladives mêlaient leurs fleurs à ces feuillages. C'étaient des jardins sur la mer ; des vols d'insectes les suivaient ; du pollen traînait sur les vagues. – Les impénétrables taillis nous forcèrent de marcher tout au bord des rives, et souvent, lorsque des branches se penchaient vers l'eau, de se glisser sous elles, en rampant, nous accrochant aux racines et aux lianes. – Nous avons voulu rester quelque temps à l'arrière à regarder les insectes énormes voler, mais les parfums étouffants qui montaient de toute l'île et que le vent abattait vers nous, les parfums qui déjà nous troublaient de vertige, nous eussent, je crois, fait mourir. Ils étaient si denses qu'on en voyait la poussière arômale tournoyer. – Nous avons regagné l'autre bord ; des ibis et des flamants roses qui dormaient se sont envolés. Nous nous sommes assis sur un rocher de madrépores ; le vent du large écartait de nous les parfums.
L'île devait être peu épaisse, car, au-dessous d'elle, dans la mer profonde, après l'ombre qu'elle faisait, on revoyait de la lumière. Et nous avons pensé que chacune d'elles s'était détachée, ainsi qu'un fruit mûri de sa tige ; – et quand plus rien ne les a retenues profondément au roc natal, alors, comme des actions non sincères, elles ont été au hasard des dérives, emportées par tous les courants.
Le cinquième jour, à notre regret, nous les avons perdues de vue.
Sitôt après que le soleil fut couché, nous nous sommes baignés dans une eau rose et verte ; et, comme elle reflétait le ciel, elle est bientôt devenue mordorée. Les flots tièdes et pacifiques pénétraient de leur mollesse. Les rameurs attendaient. Nous sommes remontés dans la barque comme la lune se levait ; un peu de vent soufflait ; larguant les voiles, nous poussions des bordées. Et l'on voyait tantôt les nuages encore mauves, tantôt la lune. Dans le sillage argenté qu'elle faisait sur la mer calme, les avirons creusaient des remous de lumière ; devant nous, l'Orion passait, mystérieux, dans le sillage de la lune. On la voyait derrière un mât, – puis solitaire, – puis au matin elle est retombée dans la mer.