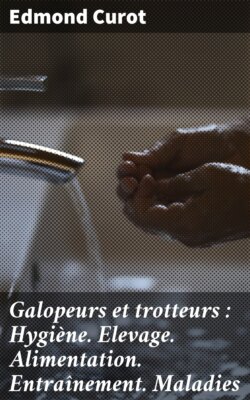Читать книгу Galopeurs et trotteurs : Hygiène. Elevage. Alimentation. Entraînement. Maladies - Edmond Curot - Страница 11
ALIMENTATION DES ÉTALONS
ОглавлениеBASES PHYSIOLOGIQUES. — BILAN NUTRITIF PENDANT LES DIVERSES PÉRIODES DE LA MONTE. — INFLUENCE DE LA NATURE DE L’ALIMENTATION SUR LA FÉCONDITÉ.
L’alimentation des étalons comporte des indications spéciales selon qu’ils proviennent de l’entraînement ou du stud. Pour les premiers, une période d’adaptation de plusieurs mois est indispensable afin de ménager les effets sur l’organisme de la transition brusque du surmenage à l’oisiveté et à l’inaction.
Certains stud-grooms pour diminuer la durée de ce régime transitoire, utilisent les purgations violentes et répétées; à cette méthode irrationnelle pouvant provoquer une irritation grave de l’appareil digestif (gastro-entérite), il convient de substituer l’emploi d’un régime rafraîchissant et d’y adjoindre modérément l’usage des laxatifs.
Dès le début de leur arrivée au haras, une «cure de désintoxication» s’impose pour permettre l’évacuation des toxines du surmenage, de la suralimentation et, trop souvent encore celles du doping. Les «intoxiqués », les «surmenés», les «brûlés, les sucés par l’avoine», seront soumis à une diététique spéciale dont les mashes, les barbotages, le vert, les tubercules, les produits mélassés constitueront la base.
Négliger l’importance de ces données hygiéniques c’est exposer les procréateurs — tout en diminuant leur taux de fécondité — à des accidents graves d’origine pléthorique, dont les congestions sont l’expression clinique.
INFLUENCE DE L’ALIMENTATION SUR LA FÉCONDITÉ
Les rapports entre la nutrition et la génération sont des plus intimes. Ainsi LEUKART a parfaitement démontré que la reproduction des organismes et les phénomènes de nutrition peuvent être représentés par des nombres exactement proportionnels: nous nous contenterons de faire remarquer que plus un animal consomme de matériaux pour sa nutrition, plus il dispose d’une masse considérable de substance propre à la reproduction; et, en effet, nos animaux domestiques ont un taux de fécondité plus élevé que leurs semblables qui vivent en liberté ; dans les années de disette, le nombre des naissances diminue considérablement.
D’autre part, cette grandeur de la dépense reproductrice ne se manifeste que tant qu’aucune autre dépense considérable ne vient lui enlever des matériaux fournis par la nutrition; ainsi un organisme qui s’accroît est, en général, impropre à se reproduire; dès que cesse la croissance, commence la reproduction, comme pour nous montrer que la seconde n’est qu’une suite de la première.
Une semblable loi règle le rapport du balancement entre la reproduction et la dépense de calorique, loi dont la contre-épreuve nous est fournie par l’étude de l’influence climatérique sur la génération. Il en est de même pour le travail musculaire, et cette dernière considération nous donne d’une manière bien inattendue l’explication de la différence de fécondité des animaux de grande et de petite taille.
L’étude du régime diététique des procréateurs présente donc une grande importance car la fécondité est liée dans une large mesure à l’alimentation, tant sous le rapport quantitatif que qualitatif.
Chez les sujets nourris abondamment, la puissance génésique est portée à son maximum car il y a toujours une relation étroite entre celle-ci et l’activité vitale. Mais, comme nous le verrons dans la suite, il faut éviter avec soin la suralimentation qui déterminerait l’obésité, cause fréquente de stérilité relative.
Il ne faut pas confondre — et nous ne saurions trop insister sur ce point — la puissance génésique avec la puissance fécondante; cette dernière n’est pas, comme la première, fonction de l’alimentation, mais bien fonction de la nature de celle-ci.
Le régime échauffant à base d’avoine produit — contrairement à l’opinion admise par les éleveurs — un abaissement du taux de la fécondité. Ce fait est mis en évidence par les statistiques de FOGLIATO: les étalons soumis au régime du vert donnèrent 70 % de fécondation, alors que ceux qui recevaient des aliments secs et excitants n’en accusaient que 50 %.
Pratiquement, l’importance de la nature de l’alimentation sur la fécondité est démontrée. Ne voit-on pas en effet, et cela est de constatation courante, les étalons rouliers qui reçoivent une nourriture rafraîchissante (mashes, vert, tubercules, etc.), avoir un taux de fécondité plus élevé que les étalons de l’Etat qui sont soumis exclusivement à la trinité classique, avoine, foin, paille?
Ce fait expérimental est tellement bien connu des éleveurs de chevaux de trait ou de demi-sang qu’ils n’hésitent pas à donner la préférence aux étalons des particuliers bien qu’en général ils ne trouvent chez eux ni le choix ni la qualité des étalons nationaux.
En résumé, comme pour la jument, l’alimentation irrationnelle des étalons est une cause d’infécondité relative. Il faudra donc dans le problème si complexe du diagnostic de la stérilité s’enquérir de la diététique suivie par les reproducteurs. Si les renseignements recueillis indiquent — et le cas est fréquent — un régime échauffant, il faudra, par une alimentation appropriée, modifier le tempérament du sire.
La suralimentation à base d’avoine — outre son effet dépressif sur la fécondité — prédispose l’étalon aux accidents d’origine pléthorique (congestions diverses) qui constituent la dominante de la mortalité au stud. Que de procréateurs qui auraient pu donner de nombreuses lignées ont eu leur carrière prématurément brisée par un accident de l’appareil digestif consécutif à une diététique irrationnelle!
Dans un de nos ouvrages nous avons fait une étude documentée de la diététique des étalons pendant les différentes périodes de la monte; nous avons indiqué de nombreux types de rations, de substitutions alimentaires qui permettent de réaliser le bilan nutritif, nous y renvoyons le lecteur.
Nous insisterons ici seulement sur l’importance primordiale de l’alimentation minérale chez les procréateurs.
L’acte de la saillie exige non seulement une forte dépense au travail mécanique, mais encore une forte excitation du système nerveux; l’apport alimentaire devra donc combler à la fois la dépense énergétique et nerveuse.
La richesse du sperme en éléments minéralisés, principalement en produits phosphorés (16,11 %) fait prévoir l’importance de l’alimentation minérale chez les procréateurs. Physiologiquement nos nombreuses observations dans les haras — tant en France qu’à l’Étranger — nous permettent d’affirmer que l’impuissance et l’infécondité relatives sont fonction de la «déminéralisation» ; on peut poser en axiome que «l’étalon le plus minéralisé sera le plus fécond».
Terminons en faisant remarquer que si une nourriture très alibile à base d’avoine peut entretenir l’organisme, elle ne saurait lui communiquer — comme certains éleveurs ont une tendance à le croire — la faculté de produire instantanément le principe fécondant, ni prévenir la dépression organique qu’occasionne le surmenage sexuel.
De même que l’aptitude au travail, l’aptitude fécondante n’est pas liée intimement aux doses massives d’avoine; elle diminue même — comme nous l’avons montré — au delà d’une certaine mesure. Seules, les substitutions alimentaires judicieuses (apport protéique et minéral) permettent d’assurer le bilan nutritif tout en évitant l’état pléthorique et l’obésité, causes d’accidents ou d’infécondité relative.
N’est-il pas paradoxal et regrettable de constater que les étalons de haute lignée — dont la valeur dépasse des centaines de mille francs, et tiennent en outre sous leur dépendance directe l’amélioration de la race pure — sont soumis trop souvent à une hygiène et à une alimentation irrationnelles.
HYGIÈNE DU TRAVAIL DES ÉTALONS
L’exercice régulier est un facteur hygiénique indispensable à l’étalon; combattre l’oisiveté est une nécessité impérieuse. Les sires aiment énormément leur promenade quotidienne et manifestent leur impatience de liberté en grattant des pieds et en donnant des ruades aux cloisons de leurs stalles jusqu’au moment de leur sortie.
Le mode de travail à utiliser présente des modalités diverses (exercice en main, monté ou à la longe); nous allons en indiquer les avantages et les inconvénients respectifs.
Le travail monté comporte une promenade de deux heures aux allures modérées sur bon terrain. Le travail à la longe détermine une dépense énergétique plus élevée mais présente des dangers pour l’intégrité de l’appareil locomoteur et peut même provoquer — s’il est intensif — des congestions chez les «pléthoriques» qui sont nombreux au haras.
Les promenades en main (au moins quatre heures) ne sont possibles qu’avec des étalons calmes et doivent être effectuées sur des routes paisibles et par des palefreniers de tout repos. Elles constituent le mode de travail le plus hygiénique en évitant la fatigue et les accidents toujours possibles à l’exercice à la longe.
Dans d’autres cas, lorsque la disposition des locaux s’y prête, les étalons sont laissés en liberté dans les paddocks.
Le travail, en dehors de l’effet salutaire sur la santé, évite l’obésité, facteur de stérilité relative.
L’hygiène du travail et l’hygiène alimentaire, tout en favorisant le taux de fécondité, prolongeront notablement la carrière génésique de l’étalon; il serait puéril — tenant compte du prix élevé des saillies des sires de haute lignée d’insister sur les avantages spéculatifs qui en résulteraient.
Le prix d’achat — jusqu’à un million — des étalons de haute origine fait prévoir l’importance des règles hygiéniques qui ont pour effet de prolonger leur durée de service; nous les résumons ainsi: éviter les effets néfastes de l’oisiveté par un exercice journalier, combattre les accidents d’origine pléthorique par l’hygiène alimentaire, éviter le surmenage génésique qui abaisse le taux de la fécondité et exige des «revues» fréquentes, réduire au minimum l’attitude du cabrer qui provoque l’usure prématurée de l’appareil locomoteur.