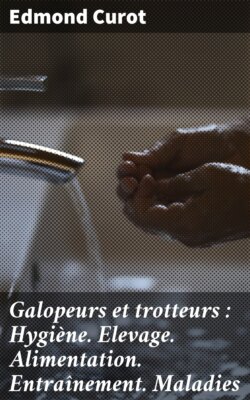Читать книгу Galopeurs et trotteurs : Hygiène. Elevage. Alimentation. Entraînement. Maladies - Edmond Curot - Страница 16
DE L’ALIMENTATION I. — ALIMENTATION DES GESTANTES
ОглавлениеBASES PHYSIOLOGIQUES. — BILAN NUTRITIF. INFLUENCE SUR LA CROISSANCE INTRA-UTÉRINE.
Avant d’aborder la diététique des gestantes, nous devons vous signaler sommairement les particularités physiologiques de la nutrition fœtale.
La vie fœtale s’entretient à l’aide des fonctions qui ont pour but d’établir entre l’organisme maternel et le fœtus des rapports analogues à ceux qui s’établiront après la naissance entre le sujet et le milieu extérieur. La présence du fœtus dans l’utérus donne lieu à des effets remarquables les uns locaux, les autres généraux. Ces derniers ont un retentissement sur toutes les grandes fonctions, en particulier sur la nutrition.
Le fœtus emprunte à la mère des matériaux nutritifs et des gaz respiratoires; ces éléments d’organisation sont répartis par une active circulation dans toutes les parties de son corps, puis fixés par une force assimilatrice d’une grande puissance dans ses différents tissus.
La nutrition s’exerce avec une grande activité dont on peut se rendre compte par le développement considérable que présente le fœtus à la fin de la gestation. Pour subvenir à un tel accroissement de poids et de volume, l’absorption d’une énorme quantité de matériaux nutritifs est devenue nécessaire et il y a lieu, pour établir l’équilibre nutritif, de rechercher où les matériaux sont puisés et quelle en est la nature.
L’analyse chimique n’est point encore parvenue à les isoler et, par conséquent, à en déterminer la composition exacte; mais à défaut de données expérimentales très certaines, l’induction scientifique est un guide assez sûr ne permettant pas de douter qu’ils consistent dans le plasma du sang et qu’ils sont identiques aux sucs nourriciers qui servent à la nutrition des tissus maternels eux-mêmes. La nutrition fœtale, en définitive, a été comparée avec juste raison, à celle d’un végétal parasite, qui ne prépare pas lui-même les matériaux de sa nutrition, mais se borne à puiser, à l’aide d’organes d’absorption spéciaux, les sucs contenus, dans l’appareil circulatoire de la mère aux dépens de laquelle il se nourrit.
Maintenant que nous connaissons le véritable mécanisme de la nutrition fœtale, examinons quels sont les besoins physiologiques à réaliser chez les gestantes.
D’après CREVAT, un poulain du poids de 50 kilogrammes à la naissance a emmaganisé dans ses tissus 8 kgr. 500 de matières albuminoïdes et 0 kgr.500 de matières grasses. Le même auteur estime qu’il réclame pendant la gestation, en tablant sur un poids moyen de 25 kilogrammes, le septième de la nourriture d’un cheval de 500 kilogrammes, ce qui représente en principes immédiats pour l’entretien journalier fœtal:
La mère devant fournir tous les éléments constitutifs du fœtus, le fera sans s’appauvrir elle-même, si elle trouve dans son alimentation, tout à la fois, les éléments nécessaires au développement fœtal et ceux indispensables à son entretien.
Dans le cas contraire, elle prendra sur sa propre substance (autophagie) pour subvenir aux besoins du nouvel être qui, véritable parasite, ne doit pas se ressentir et très souvent, en effet, ne se ressent pas des privations maternelles.
Les pertes inorganiques pendant la gestation sont considérables: — d’après les recherches de STOHMANN — le fœtus pendant la vie intra-utérine emprunte à la mère les matières minérales suivantes:
Le besoin minéral varie avec la période de gestation; faible au début, il devient impérieux vers la fin de la gestation (trois derniers mois).
Le déficit minéral pendant la période de la gestation exercera un effet dépressif sur la croissance intra-utérine et le fœtus à la naissance présentera tous les signes de la délibité congénitale et fournira un taux élevé dans la mortinatalité.
Plus l’alimentation est riche et bien appropriée, plus le développement du fœtus sera régulier et normal. Ne pas oublier qu’une alimentation rationnelle de la mère est le facteur principal du développement parfait du produit qu’elle porte et que son influence continuera ultérieurement de se faire sentir pendant tout le cours de la croissance du jeune sujet. Physiologiquement, la «croissance intra-utérine» est donc le premier stade de la précocité.
L’hygiène alimentaire pendant la période de la gestation doit répondre aux nécessités physiologiques suivantes: a) éviter l’avortement; b) assurer le développement fœtal; c) faire préparer l’établissement de la sécrétion lactée.
Le régime diététique à instituer présente de ce fait une importance capitale tant sous le rapport quantitatif que qualitatif. La quantité doit être réglée de manière que la jument soit en bon état sans être trop grasse; l’obésité, la pléthore prédisposant à l’avortement et rendant la parturition pénible; l’excès opposé, la maigreur, nuit au rendement de la sécrétion lactée.
Le volume de la ration constitue une nécessité physiologique impérieuse pendant toute la durée de la gestation; on évitera de donner des éléments encombrants (fourrages), la capacité abdominale des femelles en état de gestation, étant réduite notablement par la présence du fœtus. L’excès de volume de la ration peut provoquer, par action mécanique, l’avortement et entraver mécaniquement le développement normal du fœtus.
La nature de l’alimentation a une grande importance vers la fin de la gestation; à cette période la nourriture sans cesser d’être alibile, doit être rafraîchissante. Le coefficient d’hydratation de la ration sera suffisamment élevé (mashs, vert, tubercules, produits mélassés, etc.) pour prévenir la constipation, favoriser l’expulsion du méconium et préparer, indirectement, l’établissement de la sécrétion lactée.
Le régime du pâturage est particulièrement favorable aux juments en état de gestation; elles y trouvent une nourriture saine, facilement digestible, et profitent des bienfaits de la cure d’air et de la gymnastique fonctionnelle.
Certaines précautions sont à prendre pour les gestantes soumises au régime du vert en liberté ; les aliments couverts de gelée blanche ou de givre sont pernicieux. On sait combien le fœtus est sensible à l’action du froid; notons aussi que les aliments gelés sont plus disposés à la fermentation; que l’impression du froid sur la muqueuse gastrique peut amener des répercussions organiques graves (coliques, indigestions, tympanites, etc,) aussi funestes à la mère qu’au fœtus.
La thermalité des boissons pour les gestantes présente aussi une grande importance hygiénique. L’ingestion d’eau froide et glacée, surtout si les organes digestifs sont en état de vacuité, est une cause fréquente d’avortement.
Dans la diététique des gestantes, l’avoine ne doit pas en constituer comme trop d’éleveurs le croient, — la dominante; d’autres grains, riches en protéine et en acide phosphorique (fèves, maïs, orge, etc.) doivent lui être associés.
Physiologiquement, c’est pendant les deux derniers mois de la gestation que l’organisme fœtal élabore et constitue les deux tiers de la masse totale, qu’il s’agisse de matières albuminoïdes ou minérales; l’alimentation maternelle, à cette période, doit réaliser le bilan nutritif (rapports protéique, adipo-protéique, phosphorique, calcique, phosphocalcique, etc.).
Dans un ouvrage antérieur nous avons indiqué de nombreux types de rations où ces nécessités physiologiques impérieuses qui tiennent sous leur dépendance directe la croissance utérine — premier stade de la précocité — sont réalisées.