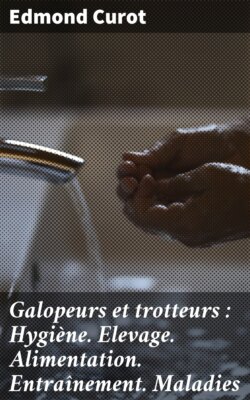Читать книгу Galopeurs et trotteurs : Hygiène. Elevage. Alimentation. Entraînement. Maladies - Edmond Curot - Страница 14
HYGIÈNE ALIMENTAIRE DES POULINIÈRES
ОглавлениеBASES PHYSIOLOGIQUES. — BILAN NUTRITIF. — INFLUENCE DE L’ALIMENTATION SUR LA LACTATION ET LA FÉCONDITÉ.
L’importance de l’alimentation au haras est primordiale. Physiologiquement, on peut dire — et nous en fournirons la preuve dans le cours de ce chapitre — que le développement fœtal (croissance, intra-utérine), et le rendement lacté, qui tiennent sous leur dépendance directe l’avenir du sujet, sont fonction — dans une large part — de l’alimentation maternelle.
L’hygiène alimentaire trop souvent méconnue des éleveurs, revêt donc au haras une importance particulière. Nous étudierons successivement le régime des poulinières vides, des gestantes, des parturientes et des nourrices dont les besoins physiologiques, et par suite le bilan nutritif, varient dans une large mesure.
La diététique au haras, comme on le voit par ce bref exposé, est bien plus complexe qu’à l’entraînement, en outre, la nature de l’alimentation — nous le verrons au chapitre stérilité — joue un rôle important, bien qu’indirect, dans la fécondité.
La transition brusque de l’entraînement — où la suralimentation et le surmenage sont de règle — au haras, où l’oisiveté est la dominante, constitue une période d’adaptation des plus critiques pour les reproductrices.
Dès le début, on observe des troubles d’ordre psychique, la jument est inquiète, triste, mange peu; pour combattre cette neurasthénie temporaire, il est d’usage de lui donner une camarade de box.
Au stud, l’hygiène alimentaire pour les juments provenant de l’entraînement, présente une importance considérable: désintoxiquer l’organisme, expulser les toxines du surmenage, de la suralimentation et trop souvent encore celles du doping, tel est le but à réaliser.
La diminution des doses massives d’avoine, les mashes, les barbotages, les tubercules, les produits mélassés, etc., constitueront la base de la diététique. Ce régime suffisamment prolongé, par son effet débilitant et rafraîchissant, calmera le nervosisme élevé des sujets.
Si l’époque le permet, la mise à l’herbe — est-il besoin de le dire — solutionne hygiéniquement et économiquement le problème diététique; dans les vues de la nature, l’herbe étant l’aliment de choix des poulinières.
Elle exerce en effet une action marquée sur le rendement et la qualité du lait; à ce double titre, par ses propriétés galactophores elle constitue le régime de choix des poulinières suitées; par son action rafraîchissante, légèrement laxative le séjour à la prairie est de même indispensable aux gestantes.
LES PRAIRIES
La mise à l’herbe constituant la base de l’alimentation des poulinières, nous allons indiquer sommairement — ces questions étant traitées longuement dans un de nos ouvrages — la composition, la valeur nutritive des différentes prairies dont la fertilité tient sous sa dépendance directe la réussite de l’élevage.
Les prairies naturelles — contrairement aux prairies artificielles — sont formées d’un grand nombre d’espèces appartenant à des familles différentes, ce qui explique leur durée pour ainsi dire illimitée, se reproduisant automatiquement par leurs graines. En outre, une grande partie de ces mêmes plantes, vivant plus aux dépens de l’atmosphère que du sol, rendent plus d’engrais à ce dernier qu’elles n’y en ont puisé,ce qui entretient perpétuellement sa fertilité ; ces plantes subissant une sorte de rotation, celles qui ne trouvent pas dans le sol les sels nécessaires à leur développement disparaissent momentanément pour faire place à des espèces qui n’ont pas les mêmes exigences.
Les prairies naturelles donnent moins de fourrage que les prairies artificielles, mais elles ne coûtent pas autant, et, une fois créées leur produit est plus régulier, ce qui permet d’asseoir l’élevage sur une base presque certaine. La fraîcheur du sol et une chaleur modérée sont les conditions indispensables à leur fertilité.
VALEUR NUTRITIVE DES PRAIRIES. — La qualité des prairies — ainsi que le prouve le tableau ci-dessous — exerce une influence marquée sur leur valeur nutritive. Les chiffres indiquant la teneur en principes immédiats, se rapportent à une consommation journalière de 40 kilogrammes d’herbes de prairie.
Les écarts accusés des principes immédiats — particulièrement dans le taux protéique consécutif à la qualité des prairies — expliquent les variations de poids vif et du rendement lacté, tant quantitatif que qualitatif observées chez les poulinières. Ils font prévoir en outre, l’importance qu’il faut attribuer à la création et à l’entretien des prairies.
La qualité de l’herbage est fonction de sa composition botanique; les graminées, les papillonacées, les chicorées doivent en constituer la dominante. La sélection sera basée sur la nature du terrain; pour les sols siliceux, légers, superficiels, utiliser la houlque laiteuse, fétuque, ray-gras vivace, dactyle pelotonné, trèfle blanc et hybride, plantain lancéolé, centaurée jaune, etc.
Le mélange pour sol calcaire sec comportera: avoine élevée, fétuque ovin, trèfle blanc, sainfoin, minette, pimprenelle, etc., le mélange pour sol argileux, superficiel réunira: fléole, dactyle, agrostide tracanté, ray-gras anglas, trèfle hybride, trèfle des prés, etc.
Les prairies naturelles assises sur des sols frais, non marécageux donnent un fourrage abondant et de bonne qualité ; elles réalisent la situation la plus favorable tant au point de vue diététique qu’hygiénique.
On peut affirmer que la réussite et la prospérité d’un haras sont intimement liées à l’abondance et à la bonne qualité de l’herbe dont les paddocks sont fournis.
La croissance du jeune animal et son développement général constituent le meilleur critérium — en dehors de l’examen botanique — de la valeur nutritive de l’herbage.
Les prairies par leurs qualités exercent une action spécifique sur l’organisme; nutritives, elles poussent au «sang» ; marécageuses, aqueuses, elles prédisposent au lymphatisme, à l’anémie.
La poulinière en liberté dans un élevage mange plus volontiers l’herbe tendre et courte que celle qui est forte et haute; un fait d’observation courante montre qu’elle refuse l’herbe qui est souillée par ses excréments; aussi peut-on qualifier de vicieuse la pratique qui consiste à faire étaler les crottins pour les utiliser comme engrais dans les herbages.
On peut dire, sans s’éloigner beaucoup de la vérité qu’il faut un hectare d’herbage pour nourrir une jument et son poulain; que chaque poulain sevré consomme dans l’année partie dans les pacages, et partie dans le box, le produit de la moitié d’un hectare.
Fig. 1
Il convient de faire, en se basant sur la qualité nutritive des herbages, une judicieuse division des paddocks; dans les plus abondants et les plus gras, on mettra, en les séparant, les juments qui nourrissent et celles qui sont pleines; elles ont autant besoin les unes que les autres d’une bonne nourriture, les premières pour provoquer un rendement lacté abondant, et les autres, pour assurer le développement normal du fœtus.
Les juments vides ainsi que les pouliches seront mises dans une prairie moins grasse; il ne faut pas que les premières prennent trop d’embonpoint, l’obésité étant un facteur de stérilité relative.
On peut poser un axiome d’élevage que la constitution minéralogique du sol régit la fertilité des terres et détermine la valeur nutritive des plantes qui vivent sur ces terrains. Le sol influe donc morphologiquement sur les animaux soit directement, soit indirectement. Si l’on admet — et elle n’est pas douteuse — la corrélation entre la composition minéralogique des terres et la nature de ses productions végétales et animales, il semble que la chaux et l’acide phosphorique soient les éléments dont l’influence est prépondérante sur le développement du squelette et de la taille.
L’habitat des plantes qui constitue la flore des herbages, joue un rôle important sous le double rapport de l’abondance et de la qualité de l’herbe. L’examen de la nature du sol constitue donc un élément indispensable dans la création des herbages. Morphologiquement, il existe une relation étroite entre la richesse de la végétation et la production animale; les terrains pauvres en phosphate produisent, par suite du déficit phosphorique et calcique, des sujets de petite taille dont l’ossature est grêle et la musculature peu développée. Dans ces terrains, l’emploi des engrais constitue un palliatif indispensable.
Pour ne pas épuiser la fertilité d’un herbage, il faut lui rendre les substances que les plantes — véritables parasites — lui ont enlevées, c’est la loi de restitution, et elle est inexorable.
Le système d’exploitation exerce une influence importante sur la fertilité et la durée des prairies. La pratique montre que le séjour exclusif et continu des poulinières dans un même herbage en compromet la fertilité ; la jument coupe l’herbe jusqu’à ras de terre en certaines places où la flore est appétissante (trèfle blanc, lotier, ray-gras etc.) et néglige complètement les autres parties où l’herbe est plus grossière; cette dernière se ressème automatiquement au détriment des bonnes espèces.
PLANTES TOXIQUES DES PRAIRIES
Indépendamment des plantes peu nutritives, il y a dans les prairies des végétaux toxiques dont l’ingestion peut provoquer des cas d’intoxication mortels; d’où la nécessité de recourir à l’examen botanique des prairies. Les plantes toxiques ont généralement des terrains de prédilection: les uns, ne croissent qu’à l’humidité, les autres, dans les lieux secs.
A. Prairies fraîches. — Les prèles, non seulement sont siliceuses, dures, peu nutritives mais possèdent un pouvoir nocif élevé.
Le colchique d’automne est dangereux dans toutes ses parties; il occasionne une gastro-entérite violente, accompagnée de coliques, de diarrhée, d’hématurie.
Les renoncules, la ficaire, le populage ne sont réellement dangereux, que si leur proportion relative est élevée.
B. Prairies sèches. — Ces prairies constituent l’habitat des vératres, de la scille maritime, des aristoloches, des euphorbes et de certaines autres plantes acres, irritantes ou toxiques, qui toutes possèdent un pouvoir nocif plus ou moins puissant.
LES MOUCHES A LA PRAIRIE
L’écueil invincible de la mise à l’herbe est représenté par la présence, dès le mois de juin, des mouches et des taons; que d’accidents indirects résultent de leurs attaques! Laisser les chevaux dehors la nuit et les rentrer le jour; les sortir à la première heure et les rentrer dès que les moustiques paraissent, sont des palliatifs mais ils ont le grave inconvénient de provoquer une trop longue stabulation des sujets.
Les mouches en disséminant des germes divers ou des larves de parasites qui souillent leurs pattes et leur trompe, contribuent: 1° à la propagation de certaines maladies infectieuses, 2° à la transformation en plaies granuleuses (plaies d’été) de plaies simples sur lesquelles elles déposent des larves d’un habronème.
Arrêter la multiplication des mouches en s’attaquant surtout aux œufs et aux larves de ces insectes, en essayant de les détruire par un traitement approprié dans les matières qui les hébergent (déjections, fumiers, mares, fosses, etc.).
Les mouches piqueuses peuvent, grâce à leur trompe rigide et piquante, percer la peau, sucer le sang. En France, elles sont principalement représentées par le stomox qui suce le sang du cheval, s’attaque surtout aux membres, et chez lequel évolue la larve d’un habromène spécial. Ce sont des mouches analogues qui inoculent aux animaux d’Afrique, les maladies à trypanosomes.
La méthode biothermique est la plus simple et la meilleure pour détruire les œufs et les larves. Elle repose sur l’action nocive de la chaleur dégagée dans la fermentation du fumier en tas (la température dépasse 80°) et sur celle des gaz toxiques produits au cours de cette fermentation.
Pour protéger les animaux contre les mouches, recourir aux procédés suivants: éloigner le plus possible les aires à fumier des locaux; renouveler fréquemment la litière; garnir les ouvertures de treillage métallique dont les mailles n’ont pas plus de 2 millimètres de largeur; peindre les carreaux en bleu; badigeonner les murs et les plafonds avec un lait de chaux teinté en bleu clair; utiliser un sol étanche et légèrement en pente pour permettre à l’urine de s’écouler; détruire les mouches qui même en dépit de ces précautions ont pu pénétrer dans les locaux par les vapeurs de crésyl produites (chauffage à feu nu).
Pour éviter aux animaux le contact des mouches, et d’une façon générale des autres insectes, les lotionner avec des lotions ou émulsions diverses: assa fœtida, de crésyl, lysol, pétrole, essence de térébenthine, feuilles de noyer; — l’émulsion d’huile de ricin est la seule préparation qui agisse efficacement; augmenter sa toxicité pour les insectes par l’addition de quelques gouttes d’huile de croton.
Cette étude montre qu’au haras, la qualité des prairies — contrôlée par l’analyse du sous-sol et par l’examen botanique des plantes — constitue le facteur primordial. Quelle que soit la haute origine des sujets, tous les efforts, les sacrifices de l’éleveur seront annihilés si le «tapis de verdure» ne possède pas les qualités nutritives exigées.
Poulains précoces, normaux, malingres, chétifs, tardifs seront l’expression fidèle de la valeur nutritive — tant quantitative que qualitative — des herbages.