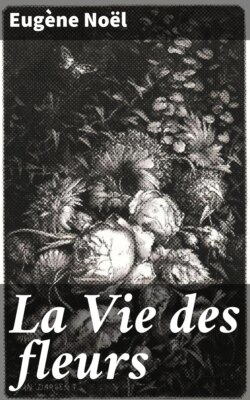Читать книгу La Vie des fleurs - Eugène Noël - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV.
Table des matières
ROSIER DU BENGALE. — LIS BLANC ET POIS-FLEUR. SEMIS DE POISSONS ET DE CAILLOUX. DISTINCTION DES TROIS RÈGNES.
Le jardin dans lequel je passai mes premières années, d’une étendue fort restreinte, était très-retiré, très-solitaire. De grands murs l’entouraient, tapissés de vignes que, par bonheur, on ne taillait presque jamais. Je passais là des journées entières à planter et à déplanter, à regarder croître mes plantes. Les premières que je remarquai, que j’aimai d’un véritable amour, furent un rosier du Bengale et un lis blanc. Souvent je m’asseyais entre mes deux préférées, et, tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre, je faisais les plus étonnants dialogues. Je les sentais si bien vivre avec moi d’une vie commune, que volontiers je les aurais appelées sœurs, comme faisait un anachorète dans son désert: Soror, arnica mea, cicada... (0 ma sœur la cigale!) On me voyait pleurer lorsqu’il arrivait quelque accident à mes fleurs. Je n’ai battu qu’une seule personne en ma vie: ce fut une petite fille (je me le reproche bien), laquelle m’arracha, au moment où il allait fleurir, un pois-fleur que j’avais semé de ma main et cultivé avec des soins que vous ne croiriez point. Je l’élevais dans un pot, et il ne me quittait en aucune circonstance. Aux repas, je le posais près de moi, et, lorsque j’apercevais quelque part un rayon de soleil, aussitôt j’y portais mon pois. Les enfants du voisinage se moquaient de moi; mais que m’importait, pourvu que mon pois vécût! J’entrais dans le ravissement, dans l’extase, dans des rêves sans fin, lorsque je venais à considérer qu’une si jolie plante était venue d’un petit grain noir, tout sec, mis dans un peu de terre.
Ce qui vous étonnera peut-être beaucoup, c’est que, dans mon enthousiasme à ce spectacle de la végétation, je crus que toute chose poussait de la même manière. Je n’avais pas fait encore la distinction des trois règnes. Je dis fait, car on ne me l’a point apprise. J’y suis arrivé moi-même; voici de quelle manière:
Un jour que l’on avait chez nous mangé de l’alose, ce poisson m’ayant paru excellent, j’en recueillis les arêtes et courus les planter dans mon jardin. Je les arrosais soir et matin; mais, hélas! rien ne poussait. Après avoir attendu longtemps avec une patience admirable, je les déterrai. Que trouvai-je? L’histoire ayant été sue, l’on se moqua de moi; je vis bien alors que certaines choses poussaient, se formaient, naissaient autrement que les plantes.
Croyez qu’aucun livre à cet âge (je n’avais pas plus de six ans) ne m’eût donné cette idée de la naissance, de la formation, de la croissance des choses. J’aurais paru sot peut-être avec d’autres enfants déjà docteurs; en réalité, j’étais plus avancé que la plupart d’entre eux: mon ignorance tâtonneuse était plus vraie que leur science. Mais vous croirez peut-être que j’invente l’article suivant: je m’avisai un jour de planter des cailloux.
Cela vous fera rire. Quoi de plus naturel? Emu de ce grand et insondable mystère de la naissance des êtres, je demandais le secret de son existence à toute créature. Je suis convaincu que les premiers chercheurs, les premiers savants ont fait des expériences qui paraîtraient à nos savants actuels aussi primitives que celle de planter des cailloux.
Je les déterrai, voyant que rien ne poussait; mais je ne les trouvai point pourris comme les arêtes. Je tins compte de cette différence, et déjà je commençais à soupçonner que les animaux ne se formaient pas de la même manière que les plantes. Je comprenais bien aussi que les cailloux n’appartenaient ni à l’une ni à l’autre catégorie; mais comment poussaient-ils? Comment poussaient les animaux? Et c’étaient des rêves, des rêves!...
Mon père me raconta, un soir, la manière admirable dont le bon Dieu s’y prit, dans son jardin, pour créer le premier homme. d’un peu de terre, en soufflant dessus. Le souffle, c’était l’âme.
Je n’en pus dormir de toute la nuit. Dès l’aurore, je cours au jardin, je prends de la terre, la pétris, lui donne, de mon mieux, la ressemblance humaine; puis. ayant placé ce chef-d’ œuvre entre mon rosier du Bengale et mon lis, comme en un lieu sacré, me voici soufflant dessus de toutes mes puissances. Quel trouble! quelle attente! Qui pourra rendre cette scène? Je soufflais; rien ne remuait. M’en prenant alors à la faiblesse de mon haleine, je cours demander un soufflet.
«Pourquoi faire? me dit-on.
— Pour donner une âme à mon homme.»
Mais ce furent des éclats de rire nouveaux...