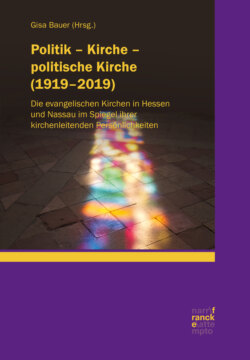Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 32
1. La voie négative chez Thomas d’Aquin
ОглавлениеPrécisons d’abord ce qu’il faut entendre par connaissance négative. Je prends comme exemple la voie négative telle que Thomas d’Aquin l’a développée dans sa doctrine de Dieu. Selon lui, l’objet propre de la connaissance humaine, contrairement à celle des anges comme êtres purement incorporels, est la connaissance d’essences (quidditates) qui existent dans une matière corporelle (in materia corporali1) et par là dans un individu qui les incorpore (in aliquo individuo). Il est de la nature de l’essence du cheval d’exister dans la matière corporelle d’un cheval, etc.2 Ces essences sont l’objet propre de notre connaissance parce que l’intellect humain ne peut connaître sans recourir aux images, c’est-à-dire aux sens et à l’imagination3. S’il pouvait directement saisir l’universel d’une essence, il n’aurait pas besoin de ce détour. Or, pour la connaissance des choses incorporelles qui échappent aux sens et à l’imagination (en particulier Dieu), cela signifie que nous ne les connaissons que par comparaison (per comparationem) à des corps sensibles4.
Comparaison, bien sûr, où l’un des termes de la comparaison reste en fin de compte inconnaissable. L’essence de Dieu, dit Thomas, dépasse toute forme ou essence que notre intellect peut atteindre5. Non seulement parce qu’il n’est pas capable de connaître des essences non incorporées dans une matière corporelle6, mais aussi, je résume, parce que l’essence divine est illimitée et donc hors d’atteinte pour un intellect humain créé et limité7. Cela ne signifie toutefois pas que nous ne pouvons pas du tout comparer. Il y a même trois formes de comparaison : ut causam, per excessum et per remotionem8. Au moyen des preuves de l’existence de Dieu nous pouvons comparer Dieu à une cause, car il est, selon ces preuves, la cause première de l’univers (ut causam) ; nous pouvons le comparer aussi à certaines propriétés positives des êtres créés, par exemple la bonté ou la sagesse, en appelant Dieu bon ou sage au plus haut point, ou éminemment bon ou sage (per excessum) ; et nous pouvons finalement comparer Dieu aux corps sensibles créés – c’est le genre de comparaison qui nous intéresse ici – per remotionem, par négation.
Un mot sur la comparaison ut causam. Elle est le fondement de tout ce que nous pouvons dire sur Dieu. Peu importe comment nous évaluons aujourd’hui la validité des cinq preuves de l’existence de Dieu que nous propose Thomas d’Aquin : c’est la démarche épistémologique qui importe ici et que nous allons retrouver à propos de la conscience. D’abord, un certain raisonnement nous oblige à admettre l’existence d’une cause première de l’univers, ce que, dit Thomas, tout le monde appelle Dieu. Ensuite il s’avère que la nature de cette cause première, dont l’existence est nécessaire selon ces preuves, échappe à nos moyens de connaissance ordinaires et que nous pouvons donc au maximum parvenir à une connaissance indirecte – per excessum ou per remotionem – de cette cause première.
Thomas introduit la connaissance per remotionem ou voie négative dans la Somme contre les Gentils de la manière suivante :
La substance divine, en effet, dépasse par son immensité toutes les formes que peut atteindre notre intelligence, et nous ne pouvons ainsi la saisir en connaissant ce qu’elle est. Nous en avons pourtant une certaine connaissance en étudiant ce qu’elle n’est pas9.
Et un peu plus bas dans le même chapitre :
Mais dans l’étude de la substance divine, ne pouvant saisir le ce-que-c’est et le prendre à titre de genre, ne pouvant non plus saisir sa distinction des autres choses par le moyen des différences positives, force est de la saisir par le moyen des différences négatives10.
Suit alors une énumération, ou plutôt une véritable déduction de propriétés attribuées à Dieu. Elles expriment toutes l’altérité divine relativement à ce que l’intellect humain peut connaître par des moyens ordinaires, c’est-à-dire en abstrayant des essences qu’il trouve unies à des corps matériels. Je parle d’une déduction, car ces propriétés sont la conséquence logique d’une première détermination, celle obtenue par la comparaison ut causam : les preuves de l’existence de Dieu prouvent que Dieu est cause première, soit une cause qui n’est plus causée par autre chose, donc que Dieu est un moteur non mû, et donc quelque chose d’absolument immobile, car – principe inamovible aussi de l’ontologie aristotélicienne – rien ne peut se mouvoir par soi-même.
Or, s’il n’y a pas de mouvement en Dieu – je m’en tiens ici au premier livre de la Somme contre les Gentils –, Dieu n’a pas de commencement ni de fin, il est donc éternel11 ; s’il est éternel, il n’y a pas de puissance en Dieu, il est donc acte pur12. S’il n’y a pas de puissance en Dieu, il n’y a pas non plus de matière en Dieu13, et il n’y a pas non plus de composition en Dieu, car en tout composé il doit y avoir de l’acte et de la puissance : Dieu est donc absolument simple14. Et cela continue : Dieu n’est pas un corps, Dieu est son essence, l’être de Dieu et son essence sont la même chose, en Dieu il n’y pas d’accident, Dieu ne rentre dans aucun genre, Dieu est parfait.
Ces attributions, dont quelques-unes semblent au premier abord positives, (par exemple : éternel, acte pur, simple ou parfait) sont toutes des déterminations négatives, car pour un intellect ne pouvant connaître que ce qui se meut, est composé, imparfait, etc. elles décrivent quelque chose qui n’est pas directement saisissable. Il faut cependant nécessairement attribuer exactement ces propriétés à ce qui est cause première : le fait de ne pas être mû, de ne pas être composé, de ne pas être imparfait, etc.
Peut-on parler d’une connaissance de l’essence divine en attribuant à Dieu des propriétés négatives de ce genre ? Thomas l’affirme, par exemple dans le passage suivant de la Somme contre les Gentils :
Nous connaissons en effet d’autant mieux une chose que nous saisissons plus complètement les différences qui la distinguent des autres : chaque chose possède un être propre qui la distingue en effet de toutes les autres15.
Et un peu plus bas dans le texte il précise :
Or de même que, dans le domaine des différences positives, une différence en entraîne une autre et aide à serrer davantage la définition de la chose en marquant ce qui la distingue d’avec un plus grand nombre, de même une différence négative en entraîne-t-elle une autre et marque-t-elle la distinction d’avec un plus grand nombre. Si nous affirmons par exemple que Dieu n’est pas un accident, nous le distinguons par là-même de tous les accidents. Si nous ajoutons ensuite qu’il n’est pas un corps, nous le distinguons encore d’un certain nombre de substances ; et ainsi, progressivement, grâce à cette sorte de négation, nous le distinguons de tout ce qui n’est pas lui. Il y aura alors connaissance propre (propria) de la substance divine quand Dieu sera connu comme distinct de tout. Mais il nʼy aura pas connaissance parfaite (perfecta), car on ignorera ce qu’il est en lui-même16.
La connaissance négative, j’en conviens, est bien une détermination de la nature divine. C’est préciser ce que nous entendons par Dieu que de le déterminer comme non-causé, non-composé, etc. Pour le transfert sur le plan de la conscience de soi, il importe cependant, je le répète, de retenir toute la démarche que je viens d’esquisser chez Thomas : il est nécessaire d’admettre l’existence d’une cause première. Une cause première est différente de tout ce que nous rencontrons à travers des images. Le fait d’attribuer des déterminations négatives à ce qui échappe aux images est épistémologiquement parlant informatif.