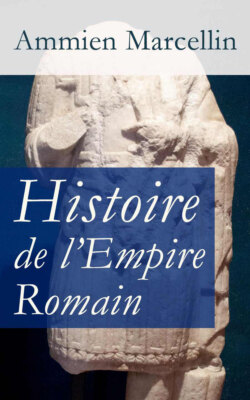Читать книгу Histoire de l'Empire Romain: Res gestae: La période romaine de 353 à 378 ap. J.-C. - Ammien Marcellin - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapitre V
ОглавлениеTable des matières
V. Du sein des malheurs de l’État on vit bientôt surgir une tourmente non moins fatale, et qui, cette fois, menaçait de tout engloutir dans un commun désastre, si la fortune, souveraine arbitre de toutes choses, n’eût elle-même étouffé le mal dans son germe. Depuis longtemps l’incurie du gouvernement laissait la Gaule ouverte aux incursions des barbares, et leur route était toujours marquée par le pillage, la dévastation et l’incendie.
Un ordre de l’empereur envoya dans ce pays Silvain, maître de l’infanterie, que l’on jugeait capable de remédier au mal. Arbétion, qui souffrait impatiemment la présence d’un mérite supérieur au sien, avait contribué de tout son pouvoir à l’éloigner par cette mission périlleuse. Un certain Dynamius, attaché à la direction des équipages de l’empereur, sollicita de Silvain quelques lettres de recommandation, dont il pût se prévaloir près des amis du général en qualité d’intime. Une fois en possession de ces lettres, que ce dernier, dans sa simple droiture, ne crut pouvoir lui refuser, le perfide les tint en réserve, dans l’intention de s’en servir plus tard pour quelque noir projet. En effet, tandis que Silvain, tout entier à ses devoirs, parcourt les Gaules, chassant devant lui les barbares, qui déjà, perdant toute confiance, ne tenaient nulle part contre ses armes, ce Dynamius, donnant carrière à son esprit d’intrigue, élaborait, avec l’art d’un fourbe consommé, la falsification la plus indigne. Des bruits, sans certitude il est vrai, ont signalé, comme fauteurs et complices de cette machination, Lampade, préfet du prétoire, Eusèbe, surnommé Mattiocopas, exintendant du domaine privé, et Édèse, ex-secrétaire des commandèments du prince ; ces deux derniers intimes amis du préfet, et, à ce titre, invités par lui à la cérémonie d’investiture de son consulat.
A l’aide d’un pinceau qu’il promena successivement sur l’écriture des lettres de Silvain, Dynamius en fit disparaître une partie, ne laissant d’intact que la signature, et y substitua une rédaction toute différente. Ce n’était rien moins qu’une circulaire adressée par Silvain à ses amis politiques et particuliers, notamment à Tuscus Albinus, où ceux-ci étaient invités en termes ambigus à seconder le signataire dans le dessein d’usurper le trône. Ce tissu de mensonges, habilement ourdi pour perdre un innocent, fut par Dynamius confié au préfet pour qu’il le fit passer sous les yeux du prince. Lampade, ainsi devenu la cheville ouvrière de cette menée ténébreuse, guette le moment d’un tête-à-tête avec Constance, et se présente dans son cabinet, certain de tenir dans ses filets l’un des plus vigilants défenseurs du trône. Lecture est faite des fausses lettres dans le conseil, qui prend des mesures pour s’assurer des personnes dénommées. Les tribuns sont arrêtés sur-le-champ, et l’ordre est envoyé dans les provinces de transférer a Milan les personnes privées.
L’absurdité palpable de l’accusation révolta Malarie, chef des gentils, qui dans une réunion de ses collègues, par lui provoquée, dit hautement qu’il était indigne de laisser circonvenir ainsi par les intrigues de factieux les hommes les plus dévoués au gouvernement de l’empereur. Il déclara Silvain tout à fait incapable de la trahison qui lui était imputée, et qui n’était que l’œuvre d’une cabale détestable. Il se faisait fort, disait-il, d’aller le trouver lui-même et de le ramener à Milan ; il proposait même sa propre famille pour otage, et, de plus, la caution de Mellobaudes, tribun de l’armature, pour garantie de son retour ; ou bien offrait comme alternative que Mellobaudes ferait le voyage, et se chargerait d’accomplir la mission. Silvain était prompt à s’effaroucher, même sans motif ; et lui députer tout autre qu’un compatriote, c’était risquer de faire un rebelle d’un homme jusque-là fidèle et dévoué.
Le conseil était bon, il n’y avait qu’à le suivre ; mais Malarie jetait ses paroles au vent. L’avis d’Arbétion prévalut ; et ce fut Apodème, l’ennemi juré de quiconque était honnête homme, qui fut dépêché à Silvain porteur d’une lettre de rappel. Apodème avait d’autres soins en tête que sa mission. Aussitôt arrivé en Gaule, il met ses instructions de côté ; et, sans voir Silvain, sans lui transmettre aucune invitation de retour ni lui communiquer la lettre, il mande l’agent du fisc ; et, déjà procédant envers le général comme envers un proscrit dont la tête serait dévolue au bourreau, le voilà qui prend contre ses clients et serviteurs les mesures les plus vexatoires, avec toute l’insolence d’un vainqueur en pays conquis.
Pendant qu’Apodème met le feu partout, et fait désirer impatiemment la présence de Silvain, Dynamius, pour assurer l’effet de sa manœuvre, adresse au tribun de la manufacture de Crémone, sous les noms de Silvain etde Malarie, des lettres analogues à celles qu’il avait fait remettre par le préfet à l’empereur. Il y était invité tout simplement, comme sachant d’avance ce dont il s’agissait, à tout disposer promptement pour l’exécution.
Le tribun lut et, relut, sans rien comprendre. Sa mémoire ne lui rappelant aucun rapport intime avec les personnes qui lui écrivaient, il prit le parti de retourner à Malarie sa mission supposée par le porteur, accompagné d’un soldat ayant charge de le prier de s’expliquer clairement, et sans réticences, avec un esprit grossier qui n’entendait pas les énigmes. Malarie, qui était fort découragé et fort triste, et qui gémissait amèrement sur son sort et sur celui de son compatriote Silvain, comprit d’abord tout le mystère. Il rassemble aussitôt tout ce qui se trouvait de Franks au palais (ils y étaient nombreux et influents), et, dans le langage le plus animé, leur fait part de sa découverte. Grande rumeur : un complot était pris sur le fait, c’était contre eux qu’il était dirigé. L’empereur, instruit de ce qui se passe, ordonne aussitôt une révision de l’affaire, et veut qu’elle ait lieu en présence de tous les membres du conseil, tant de l’ordre civil que de l’ordre militaire. Déjà les juges renonçaient à voir clair dans ce dédale, quand Florence, fils de Nigrinien, qui remplaçait alors le maître des offices, regardant de plus près l’écriture des pièces, y retrouva en dessous quelques traits des caractères primitifs ; et bientôt on acquit la certitude que les interpolations d’un faussaire avaient travesti à plaisir la pensée du général.
L’imposture parut alors au grand jour. L’empereur, s’étant fait rendre un compte détaillé de la procédure, cassa le préfet, et le fit mettre en jugement ; mais sa cabale s’évertua, et réussit à le faire acquitter. Eusèbe, exintendant du domaine, confessa sur le chevalet qu’il avait eu connaissance de cette machination. Édèse se tira d’affaire en se renfermant dans une dénégation absolue. Tout le reste des prévenus fut renvoyé absous. Quant à Dynamius, pour récompense de ses mérites, il fut nommé correcteur. On l’envoya régenter la Toscane.
Cependant Silvain, qui était à Agrippine, y recevait avis sur avis des menées d’Apodéme pour le perdre. Ne connaissant que trop le cœur pusillanime du prince, et le peu de fond qu’on pouvait faire sur ses bonnes intentions, il se voyait à la veille d’être, sans qu’on l’eût entendu ni condamné, traité en criminel. Un moment il songea, pour sortir d’une position si critique, à demander asile aux barbares ; mais il en fut dissuadé par Laniogaise, alors tribun, le même qui, n’étant encore que candidat, était resté seul, ainsi que nous l’avons dit, près de l’empereur Constant au moment de sa mort, et avait recueilli ses derniers soupirs. De la part des Franks, ses compatriotes, Silvain, disait-il, ne pouvait s’attendre qu’à être assassiné, ou vendu à ses ennemis. Une résolution extrême était donc inévitable. Silvain eut des pourparlers avec les chefs principaux, les échauffa par des promesses, et, s’affublant de lambeaux de pourpre arrachés aux étendards et aux dragons, lui-même il se proclame empereur.
Pendant que tout ceci se passait dans la Gaule, arrive à Milan, sur le soir, la nouvelle étrange de la séduction de l’armée, et de l’usurpation du rang impérial par le chef ambitieux de l’infanterie. Ce fut pour Constance un coup de foudre. Le conseil est aussitôt convoqué ; tous les grands dignitaires se rendent au palais vers la seconde veille. Mais quand il fallut ouvrir un avis, nul ne retrouva ses idées ni sa langue. Quelques mots seulement circulèrent à voix basse sur les talents d’Ursicin, ses ressources d’homme de guerre, et sur les torts graves qu’on s’était donnés si gratuitement envers lui. Ursicin est donc appelé au conseil, et introduit (marque d’honneur spéciale) par le maître des cérémonies, et on lui donne la pourpre à baiser, de l’air le plus gracieux qu’on eût encore pris avec lui. Ce fut Dioclétien qui le premier introduisit cette forme d’adoration barbare ; car nous lisons qu’avant lui on ne saluait pas les princes autrement qu’on ne fait aujourd’hui les magistrats. Dans le même homme que naguère la malveillance acharnée accusait d’absorber l’Orient à son profit, de convoiter pour ses enfants le pouvoir suprême, on ne voyait plus que le capitaine consommé, le compagnon d’armes de Constantin, le seul bras qui pût conjurer l’incendie ; éloge aussi vrai que peu sincère ; car, tout en songeant sérieusement à abattre un aussi dangereux rebelle que Silvain, on entrevoyait, en cas de non réussite, la chance de se défaire d’Ursicin, dont les rancunes, supposées implacables, causaient toujours une grande préoccupation. Aussi lorsque le général, pendant qu’on pressait les préparatifs du départ, voulut glisser quelques mots de justification, l’empereur lui ferma doucement la bouche, en disant qu’il n’était pas bon de s’expliquer quand on avait un intérêt mutuel et si grand à s’entendre. On délibéra longuement encore ; on chercha surtout comment on persuaderait à Silvain que l’empereur ignorait tout. Enfin un moyen parut propre à lui donner pleine confiance : ce fut de lui notifier, dans les termes les plus honorables, un rappel qui le maintenait en possession de son titre et de ses fonctions, en lui donnant Ursicin pour successeur dans les Gaules. Ce plan arrêté, Ursicin reçut l’ordre de partir sans délai avec dix tribuns ou officiers des gardes, qu’on lui adjoignit sur sa demande pour l’aider dans sa mission. Mon collègue Vérinianus et moi fûmes de ce nombre ; les autres étaient parents ou amis d’Ursicin. Le voyage fut de longue haleine ; chacun put à loisir méditer sur les dangers qu’il allait courir. Nous nous regardions comme mis aux prises avec des animaux féroces. Mais le mal présenta cela de bon, qu’on a du moins le bien en perspective ; et l’on se consolait avec cette pensée de Cicéron, expression de la vérité même : “Une suite non interrompue de bonheur et de succès est désirable sans doute ; mais on n’y trouve pas, et c’est l’effet même de la continuité, cette vivacité de sensation que l’âme éprouve à passer d’un état désespéré à une condition meilleure”.
Nous voyagions à grandes journées, notre chef voulant, dans son zèle, atteindre la frontière suspecte avant que la nouvelle de la défection ne fût publique en Italie. Mais, si rapide que fût notre marche, la renommée nous devança ; et à notre arrivée à Agrippine la révolte avait pris un développement qui défiait les moyens de répression dont nous pouvions disposer. Partout un concours empressé de la population au nouvel ordre de choses ; partout des réunions de troupes considérables. Dans de telles conjonctures, il n’y avait pour Ursicin qu’un seul parti à prendre, et c’est une nécessité dont il faut le plaindre : faire violence à ses sentiments et à ses désirs par un simulacre d’adhésion à ce pouvoir d’un jour, et conduire la déception avec assez d’adresse pour flatter la vanité du rebelle, et endormir sa vigilance deus une complète sécurité. Le plus difficile était le dénoûment. Quelle attention sur nous-mêmes pour ne presser ni négliger le moment d’agir ! La moindre manifestation intempestive était à tous notre arrêt de mort. Ursicin fut bien accueilli. Contraint, pour rester dans l’esprit de son rôle, de s’incliner devant un manteau de pourpre, il se vit traité par l’usurpateur avec égards, avec faveur ; il eut un libre accès près de sa personne, la place d’honneur à sa table, et bientôt une part intime à ses confidences. Silvain récriminait avec amertume contre les indignes choix qu’on avait faits constamment pour le consulat et les hautes charges, de préférence à lui et à Ursicin ; « et cela, disait-il, au mépris des longs et importants services rendus par tous deux àl’État, à la sueur de leur front. A son égard, on avait été jusqu’à mettre à la question ses amis, et à diriger contre lui-même d’ignobles procédures ; le tout sous prétexte d’une frivole accusation de lèse-majesté. Ursicin, de son côté, n’avait-il pas été violemment arraché de son poste d’Orient, et livré comme une proie à la méchanceté de ses ennemis ? » Silvain donnait carrière à son humeur en public aussi librement que dans le tête-à-tête.
Outre ces propos assez peu faits pour nous rassurer, nous entendions frémir autour de nous l’impatience de la soldatesque, qui criait famine, et brûlait déjà de franchir les Alpes Cottiennes. Dans cette position si critique, nous nous creusions tous la tète pour arriver à un résultat. A la fin, après mille autres partis pris et abandonnés tour à tour, nous tombâmes d’accord que des émissaires choisis avec grand soin, et dont un serment nous assura la discrétion, tenteraient la fidélité douteuse des Braccates et des Cornutes ; milices toujours prêtes à se vendre au plus offrant. Nos entremetteurs, bien payés et pris dans les plus obscurs, comme plus propres à une transaction de ce genre, eurent bientôt conclu le marché. Au point du jour, un gros de gens armés se montre tout à coup devant le palais ; et leur audace, comme il arrive parfois, s’exaltant de ce qu’il y avait de hasardeux dans l’entreprise, ils égorgent la garde, pénètrent dans l’intérieur, et massacrent Silvain, après t’avoir arraché demi-mort d’une chapelle consacrée au culte chrétien, où il était allé chercher refuge. Ainsi périt un officier dont on ne peut contester le mérite, victime d’une aberration où l’entraîna la plus noire des calomnies. Absent, il se vit hors d’état de briser le fatal réseau tendu autour de son innocence, et, de désespoir, se jeta dans l’usurpation pour sauver sa tête. Silvain, au surplus, s’était toujours défié du caractère versatile du prince, nonobstant les droits qu’il s’était acquis à sa reconnaissance en passant si à propos de son côté avant la bataille, de Murse, avec l’armature dont il était le chef. Il n’était pas plus rassuré, quoiqu’il ne manquât jamais de se prévaloir de ce titre, par le souvenir des faits d’armes de son père Bonite, qui, dans la guerre civile, avait chaudement embrassé, tout Frank qu’il était, le parti de Constantin contre Licinius.
Un fait assez singulier, c’est qu’avant tout symptôme de commotion dans les Gaules, un jour, le peuple réuni à Rome dans le grand Cirque, soit par allusion, soit par pressentiment, tout à coup s’était écrié : “Silvain est vaincu”. On ne peut se faire une idée de la joie de Constance quand la nouvelle de la mort de Silvain arriva d’Agrippine. Son orgueil s’enfla de ce succès, où il voulut voir un signe de prédestination. Ennemi du courage par instinct, toujours, comme Domitien, il l’attaquait par les moyens contraires. L’entreprise si bien conduite d’Ursicin n’obtint pas même un éloge de lui. Loin de là, il se plaignit, dans ses lettres, de détournements effectués au préjudice du trésor public des Gaules, auquel certes personne n’avait touché. Il alla même à ce sujet jusqu’à prescrire une enquête, et fit subir un interrogatoire à Rémige, trésorier de la caisse militaire, le même qui plus tard, sous Valentinien, termina ses jours par un nœud coulant, à la suite de l’affaire des ambassadeurs de Tripoli. De ce jour, l’emphase de l’adulation n’eut plus de bornes : « Constance touchait aux nues, commandait aux événements. » Lui-même il renchérissait sur ces extravagances, rebutant, maltraitant de paroles quiconque ne savait pas dire si bien. Tel Crésus, selon l’histoire, chassa de ses États Solon, qui n’entendait rien au langage de la flatterie ; tel Denys voulut mettre à mort Philoxène, pour avoir seul gardé le silence au milieu de l’applaudissement universel, pendant que le tyran débitait à sa cour de mauvais vers qu’il avait faits. Ce mal engendre tous les autres. Mais quel plaisir peut donc trouver le pouvoir à la louange, quand il n’est pas permis à la critique de se faire jour ?