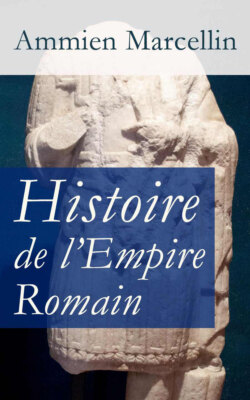Читать книгу Histoire de l'Empire Romain: Res gestae: La période romaine de 353 à 378 ap. J.-C. - Ammien Marcellin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapitre II
ОглавлениеTable des matières
II. D’autres calamités affligeaient encore l’Orient à cette époque. On commît l’habitude inquiète des Isauriens : tantôt dans un état de calme apparent, et tantôt répandant partout la désolation par leurs courses inopinées, quelques actes de déprédation tentés furtivement de loin en loin leur ayant réussi, ils s’enhardirent par l’impunité jusqu’à se lancer dans une agression sérieuse. Ces hostilités jusque-là n’avaient eu que leur turbulence pour cause. Cette fois, et avec une sorte de jactance, ils mettaient en avant le sentiment national, révolté par un outrage insigne. Des prisonniers isauriens (chose inouïe !), avaient été livrés aux bêtes dans l’amphithéâtre d’Iconium en Pisidie : « La faim, a dit Cicéron, ramène les animaux féroces où ils ont une fois trouvé pâture. » Des masses de ces barbares désertent donc leurs rocs inaccessibles, et viennent, comme l’ouragan, s’abattre sur les côtes. Cachés dans le fond des ravins ou de creux vallons, ils épiaient l’arrivée des bâtiments de commerce, attendant pour agir que la nuit fût venue. La lune, alors dans le croissant, ne leur prêtait qu’assez de lumière pour observer, sans que leur présence fut trahie. Dés qu’ils supposaient les marins endormis, ils se hissaient des pieds et des mains le long des câbles d’ancrage, escaladaient sans bruit les embarcations, et prenaient ainsi les équipages à l’improviste. Excitée par l’appât du gain, leur férocité n’accordait de quartier à personne, et, le massacre terminé, faisait, sans choisir, main basse sur tout le butin.
Ce brigandage toutefois n’eut pas un long succès. On finit par découvrir les cadavres de ceux qu’ils avaient tués et dépouillés, et dès lors nul ne voulut relâcher. dans ces parages. Les navires évitaient la côte d’Isaurie comme jadis les sinistres rochers de Sciron, et rangeaient de concert le littoral opposé de l’île de Chypre. Cette défiance se prolongeant, les Isauriens quittèrent la plage qui ne leur offrait plus d’occasion de capture, pour se jeter sur le territoire de leurs voisins de Lycaonie. Là, interceptant les routes par de fortes barricades, ils rançonnaient pour vivre tout ce qui passait, habitants ou voyageurs.
Il y eut alors un mouvement de colère parmi les troupes romaines cantonnées dans les municipes nombreux du pays, ou dans les forts de la frontière. Mais l’invasion néanmoins ne laissait pas de s’étendre ; car dans les premiers engagements qui eurent lieu, soit avec le gros des barbares, soit avec leurs partis détachés, les nôtres, partout inférieurs en nombre, ne combattirent qu’avec désavantage des ennemis nés et nourris au milieu des montagnes, gravissant toutes leurs aspérités avec la même aisance que nous marchons en plaine, et qui tantôt vous accablent de loin sous une grêle de traits, tantôt sèment l’épouvante par d’affreux hurlements. Souvent nos soldats, forcés pour les suivre d’escalader des pentes abruptes, en glissant et en s’accrochant aux ronces et aux broussailles des rochers, voyaient tout à coup, après avoir gagné quelque pic élevé, le terrain leur manquer pour se développer et manœuvrer de pied ferme. Il fallait alors redescendre, au hasard d’être atteints par les quartiers de roches que l’ennemi, présent sur tous les points, faisait rouler sur leurs têtes ; ou, s’il y avait nécessité de faire halte et de combattre, se résigner à périr sur place, écrasés par la chute de ces blocs monstrueux.
Finalement, on eut recours à une tactique mieux entendue : c’était d’éviter d’en venir aux mains tant que l’ennemi offrirait le combat sur les hauteurs, mais de tomber dessus, comme sur un vil troupeau, dès qu’il se montrerait en rase campagne. Des partis d’Isauriens s’y risquèrent souvent, et furent chaque fois taillés en pièces avant qu’un seul homme eût pu se mouvoir, ou brandir l’un des deux ou trois javelots dont ce peuple marche ordinairement armé.
Ces brigands commencèrent alors à regarder comme dangereuse l’occupation de la Lycaonie ; car c’est généralement un pays de plaines, et plus d’une expérience leur avait démontré qu’ils ne pouvaient tenir contre nous en bataille rangée. Ils prennent donc des routes détournées, et pénètrent en Pamphilie, contrée intacte depuis longtemps, mais que la crainte de l’invasion et de ses désastres avait fait couvrir de postes militaires très rapprochés, et de fortes garnisons. Comptant sur la vigueur de leurs corps et l’agilité de leurs membres, ils s’étaient flattés de prévenir, par une marche forcée, la nouvelle de leur irruption ; mais les sinuosités du chemin qu’ils s’étaient tracé, et l’élévation des crêtes à franchir, leur prirent plus de temps qu’ils n’avaient pensé. Et lorsque, surmontant ces premiers obstacles, ils arrivèrent aux escarpements da fleuve Mélas, dont le lit, profondément encaissé, forme une sorte de circonvallation autour de la contrée, la peur s’empara d’eux, d’autant plus qu’il était nuit close ; et il fallut faire halte jusqu’au jour. Ils avaient compté passer le fleuve sans coup férir, puis tout surprendre et ravager à l’autre bord. Mais il leur restait à subir de rudes épreuves, et en pure perte. Au lever du jour, ils voient devant eux des rives ardues, un canal étroit mais profond, qu’il faut renoncer à franchir à la nage. Tandis qu’ils cherchent à se procurer des barques de pêcheurs, ou fabriquent à la hàte des radeaux en joignant ensemble des troncs d’arbres, les légions, qui hivernaient dans les environs de Sida, se portent en un clin d’œil sur la rive opposée, y plantent résolument leurs aigles, et, improvisant un rempart de leurs boucliers habilement joints, n’eurent plus qu’à tailler en pièces tout ce qui se hasarda sur les radeaux, ou tenta le passage à l’aide des troncs d’arbres creusés. Les Isauriens, après s’être épuisés en efforts inutiles, cédèrent à la crainte autant qu’à la force ; et, marchant à l’aventure, arrivèrent à Laranda, où ils passèrent quelque temps à se ravitailler et à se refaire. Revenus enfin de leur effroi, ils allaient tomber sur les riches bourgades des environs, quand l’approche fortuite d’un détachement de cavalerie, dont ils n’osèrent soutenir le choc dans une plaine, les contraignit de faire retraite. Tout en se repliant néanmoins, ils ne laissèrent pas de convoquer l’arrière-ban de leur jeunesse en état de porter les armes.
La faim, dont ils éprouvaient de nouveau les extrémités, les amène ensuite devant une ville nommée Paléa, voisine de la mer, et ceinte de fortes murailles : c’est encore aujourd’hui le magasin central des subsistances du corps d’occupation de l’Isaurie. Ils furent arrêtés devant cette forteresse trois jours et autant de nuits. Mais comme la place est sur un plateau qu’on ne peut escalader qu’à découvert, et que ni les travaux de mine ni aucun autre moyen de guerre n’était pour eux praticable, ils levèrent le siège, la douleur dans l’âme, mais poussés par la nécessité à tenter ailleurs quelque grand coup. Cet échec avait redoublé leur rage, aiguillonnée déjà par le désespoir et la faim. Bientôt toute cette masse, grossie des nouvelles recrues, s’élance avec une impétuosité irrésistible pour saccager la ville métropole de Séleucie. Le comte Castrice occupait alors cette place avec trois légions de vétérans aguerris. Au signal de leurs chefs, avertis à propos de l’approche des Isauriens, les troupes, aussitôt sur pied, font en avant un mouvement rapide, et, passant à la course le pont du fleuve Calicadne, dont les profondes eaux baignent le pied des tours qui protègent la ville, vont se ranger en bataille sur l’autre bord. Défenses furent faites néanmoins d’escarmoucher et de sortir des rangs ; car tout était à redouter de l’aveugle furie de ces bandes, supérieures en nombre, et toujours prêtes à se jeter, au mépris de la vie, jusque sur la pointe de nos armes. Toutefois le son lointain des clairons et l’aspect d’une force régulière refroidirent un peu l’ardeur des barbares. Ils font halte, puis s’ébranlent de nouveau, mais cette fois d’un pas mesuré, et brandissant de loin leurs glaives d’un air de menace. Les nôtres, pleins de résolution, voulaient marcher à l’ennemi enseignes déployées, et frappaient de leurs piques sur leurs boucliers ; moyen d’excitation toujours efficacement employé chez les soldats, et qui déjà produisait l’effet opposé chez leurs adversaires. Mais les chefs arrêtèrent cet élan : ils avaient réfléchi sur l’inconséquence de s’engager à découvert, quand on avait derrière soi l’abri de fortes murailles. On fait donc rentrer les troupes, qui sont distribuées sur les terrasses et postées aux créneaux avec provision de toute espèce de projectiles, afin d’accabler, sous une grêle de pierres et de traits, tout ce qui se montrerait à portée. Les assiégés, cependant, avaient un grave sujet d’inquiétude. L’abondance régnait chez les Isauriens, qui avaient pu s’emparer des bateaux de l’approvisionnement des grains ; tandis qu’au dedans des murs, les ressources ordinaires s’épuisant par la consommation de chaque jour, on se voyait menacé prochainement de toutes les horreurs de la famine.
Le bruit de ces événements se répandit, et dépêches sur dépêches en portèrent les détails à la connaissance de Gallus. Le prince s’en émut ; et comme le général de la cavalerie était occupé au loin, il enjoignit à Nébride, comte d’Orient, de rassembler des forces de tous côtés, pour dégager à tout prix une possession si importante et par la grandeur de la ville et par les avantages de sa situation. A cette nouvelle, les Isauriens décampent ; puis, sans rien tenter de plus qui soit digne de remarque, ils se dispersent, suivant leur tactique ordinaire, et regagnent leurs monts inaccessibles.