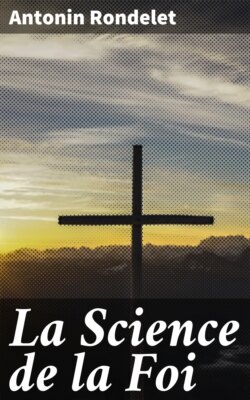Читать книгу La Science de la Foi - Antonin Rondelet - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Les anciens physiciens disaient, avec plus d’esprit que d’exactitude, que la nature a horreur du vide. Dans un autre sens et avec plus de raison, on peut le dire de nos esprits.
A mesure que l’homme tourne en arguments, son besoin de révolte qu’il appelle de l’indépendance et son attrait pour la licence à laquelle il donne le nom de liberté, à mesure qu’il sent périr en lui ces notions révérées d’une religion faite pour suffire en même temps aux aspirations de la foi et aux jugements de la raison, il lui faut quelque chose à admettre dans les régions de son intelligence, sinon à pratiquer dans la sphère de sa conduite. Il trouve tout au fond de lui-même, une certaine pudeur qui l’empêche de s’avouer et d’avouer aux autres qu’en effet il ne croit plus à rien.
Il se met donc en tête de découvrir de nouvelles affirmations et de nouveaux dogmes. A défaut de l’antiquité dont il ne peut les revêtir, de l’autorité qu’il ne saurait leur prêter, il met tout au moins une telle affectation à les respecter, une telle violence à les défendre, un tel acharnement à les protéger, que, suivant la vive et ferme remarque de M. Caro, ceux qui parlent «des ombrages et du
«despotisme de l’orthodoxie, ne trouveraient pas
«d’orthodoxie plus despotique et plus ombrageuse
«que celle-là .»
De là un phénomène singulier.
Jadis, et notamment au dix-huitième siècle les philosophes faisaient particulièrement profession de combattre et d’anéantir toute espèce de religion. Il semblait qu’ils en voulussent supprimer jusqu’au langage et jusqu’à la pensée. Écrasons l’infâme! Aujourd’hui, par une prétention toute contraire, les faiseurs de systèmes nouveaux les rajusteurs de théories antiques, ne visent à rien moins qu’à ériger leurs doctrines elles-mêmes en religions. Tandis qu’ils nient tout ce que nous croyons et s’efforcent de détruire tout ce que nous voulons conserver, ils vont, pour mieux nous faire illusion, jusqu’à user dans le sens nouveau qui leur est propre, des vieux mots dont la langue orthodoxe et spiritualiste paraissait avoir à tout jamais consacré l’immuable signification. «Il règne dans
«notre pays philosophique une singulière maladie,
«que j’appellerai l’idolâtrie des mots. Par une
«sorte de superstition, les plus hardis novateurs
«d’idées tiennent à conserver dans la langue à
«leur usage, ces termes dont ils viennent détruire
«la signification et l’utilité. Dieu, l’immortalité,
«voilà des noms consacrés, qui de tout temps
«avaient une valeur déterminée, un sens très-net
«et très-arrêté. L’originalité des doctrines nou-
«velles consiste à donner une explication des
«choses entièrement contraire à celle que ces
«termes supposent et résument. On pourrait donc
«croire qu’abandonnant l’idée, ils abandonnent
«le mot, devenu comme ces noms inutiles et va-
«gues des villes dont les ruines mêmes ont péri.
«— Il n’en est rien. On prétend sauver le mot des
«ruines de l’idée. On l’adopte, on l’habille à la nou-
«velle mode, on lui fait un sort dans le monde, on
«lui prodigue les soins les plus touchants, on l’en-
«toure d’hommages. Telle est, on le sait, la singu-
«lière fortune de quelques-uns de ces termes que
«l’on s’attendait à voir bannis des nouvelles phi-
«losophies, et qu’on y retrouve installés à la place
«d’honneur. Faut-il donc croire qu’il y ait une
«beauté absolue dans les mots qui les rende éter-
«nellement nécessaires, comme ces merveilles de
«l’art païen que le Christianisme naissant consa-
«crait au nouveau culte ?»
Plus d’une âme véhémente hésitera à se ranger ici à l’hypothèse indulgente si brillamment exprimée par M. Caro. Plus d’une âme sincère et logique se sentira entraînée à protester avec le P. Gratry. «Cette prétention, par exemple, d’établir
«l’athéisme en maintenant le nom de Dieu..., cet
«effort pour supprimer le sens de ce mot néces-
«saire en conservant ce mot..., pour conserver le
«vieux mot en supprimant la chose..., n’est-ce pas
«l’athéisme, plus un mensonge ?»
Au premier rang des croyances frappées dans leur essence et maintenues dans leur dénomination, se trouvent en effet l’idée de Dieu et sa personnalité divine, la spiritualité et l’immortalité de l’âme humaine. De là les grandes divisions du volume de M. Caro: la discussion de l’idée de Dieu, telle que nous l’ont faite Hégel et son école, en particulier M. Renan et M. Vacherot: la matérialité de l’âme telle que la prêche M. Taine: son immortalité telle que la conçoit M. Reynaud.
Ces trois divisions générales sont distribuées en huit chapitres, dont le dernier, intitulé : Le spiritualisme et ses adversaires, résume et clôt la discussion par quelques conclusions dogmatiques véritablement fortes et véritablement décisives.