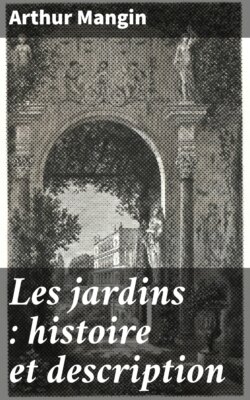Читать книгу Les jardins : histoire et description - Arthur Mangin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE III
LES JARDINS MERVEILLEUX (SUITE)–L’ÉDEN –LA TERRE PENDANT L’AGE D’OR–L’ILE DE CALYPSO– LE JARDIN DES HESPÉRIDES –LE PARADIS DE QUETZALCOATL
ОглавлениеTable des matières
LE christianisme a dégagé de toute volupté charnelle le bonheur des élus dans la Jérusalem céleste, et orsque la Bible parle de celui dont jouissaient avant leur désobéissance le premier homme et la première femme, elle ne le fait consister en rien de semblable aux voluptés insensées, aux orgies perpétuelles, au luxe extravagant du paradis musulman. Adam et Ève sont de chair et d’os comme nous; ils sont beaux; ils s’aiment d’un amour chaste et tendre, que ne troublent ni les soucis de la vie matérielle, ni les perplexités de l’âme; ils sont innocents plutôt que vertueux, puisqu’ils ignorent le mal, puisque rien autour d’eux ne peut le leur révéler, puisqu’une paix profonde règne parmi les créatures de Dieu. Ils ne sont point vêtus d’étoffes somptueuses, ils n’habitent point des palais de pierreries; ils ont pour voile leur chasteté inaltérée, pour palais la voûte azurée du ciel, pour abris des toits de feuillage. Leur demeure est un jardin, l’Éden, et c’est à le contempler, à le parcourir, à le cultiver, qu’en dehors des épanchements de leur gratitude envers le Créateur et de leur mutuelle tendresse, ils trouvent les joies les plus vives.
«God almighty first planted a garden, dit Bacon, and indeed it is the purest of human pleasures: Dieu tout-puissant a le premier planté un jardin; et, en vérité, c’est le plus pur des plaisirs humains.»
Un poëte du siècle dernier, un émule de Delille, s’exprime ainsi dans son poëme sur la Nature champêtre:
Lorsque Dieu, seul encore avec l’éternité,
Fit éclore du temps l’espace limité;
Lorsqu’il dit au néant: Existe, sois le monde,
11voyait déjà l’homme, et sa bonté féconde
Au roi qu’à l’univers destinait son amour
De l’Éden fortuné prépara le séjour.
De toutes les beautés ô céleste assemblage,
Éden, serait-ce à moi de peindre ton image?
Milton seul, empruntant d’immortelles couleurs,
Sut te peindre en des vers aussi purs que tes fleurs.
C’est donc à Milton et au plus célèbre, sinon au plus heureux de ses traducteurs, que j’emprunte la description du Paradis terrestre.
«... Satan poursuit sa route et approche de la limite d’Éden. Le délicieux paradis, maintenant plus près, couronne de son vert enclos, comme d’un boulevard champêtre, le sommet aplati d’une solitude escarpée; les flancs chevelus de ce désert, hérissé de buissons épais, capricieux et sauvages, défendent tout abord. Sur sa cime croissaient, à une insurmontable hauteur, les plus hautes futaies de cèdres, de pins, de sapins, de palmiers: scène sylvaine; et comme leurs rangs superposaient ombrages sur ombrages, ils formaient un amphithéâtre de forêts de l’aspect le plus majestueux. Cependant, plus haut encore que leurs cimes montait la muraille verdoyante du paradis... Et plus haut que cette muraille, qui s’étendait circulairement au-dessous de lui (de Satan, je suppose), apparaissait un cercle des arbres les meilleurs et chargé des plus beaux fruits. Les fleurs et les fruits dorés formaient un riche émail de couleurs mêlées; le soleil y imprimait ses rayons avec plus de plaisir que dans un beau nuage du soir, ou dans l’arc humide, lorsque Dieu vient d’arroser la terre.
L’ÉDEN.
«Ainsi charmant était ce paysage. A mesure que Satan s’en approche, il passe d’un air pur dans un air plus pur qui inspire au cœur des délices et des joies printanières, capables de chasser toute tristesse, hors celle du désespoir. De douces brises, secouant leurs ailes odoriférantes, dispensaient des parfums naturels, et révélaient les lieux auxquels elles dérobèrent ces dépouilles embaumées...
«Satan s’envola, et sur l’arbre de vie (l’arbre du milieu et le plus haut du paradis) il se posa semblable à un cormoran... Au-dessous de lui, avec une nouvelle surprise, dans un étroit espace, il voit renfermée pour les délices des sens de l’homme toute la richesse de la nature; ou plutôt il voit un ciel sur la terre, car ce bienheureux paradis était le jardin de Dieu, par lui-même planté à l’orient d’Éden... Sur ce sol agréable Dieu traça son plus charmant jardin; il fit sortir de la terre féconde les arbres de la plus noble espèce pour la vue, l’odorat et le goût. Au milieu d’eux était l’arbre de vie, haut, élevé, épanouissant son fruit d’ambroisie et d’or végétal. Tout près de la vie, notre mort, l’arbre de la science croissait...
«Au midi, à travers Éden passait un large fleuve: il ne changeait pas de cours, mais sous la montagne raboteuse il se perdait engouffré; Dieu avait jeté cette montagne comme le sol de son jardin élevé sur le rapide courant. L’onde, à travers les veines de la terre poreuse qui l’attirait par une douce soif, jaillissait, fraîche fontaine, et arrosait le jardin d’une multitude de ruisseaux. De là ces ruisseaux réunis tombaient d’une clairière escarpée et rencontraient au-dessous le fleuve, qui ressortait de son obscur passage; alors, divisé en quatre branches principales, il prenait des routes diverses, errant par des pays et des royaumes fameux, dont il est inutile ici de parler.
«Disons plutôt, si l’art le peut dire, comment, de cette fontaine de saphir, les ruisseaux tortueux roulent sur des perles orientales et des sables d’or; comment, en sinueuses erreurs sous les ombrages abaissés, ils épandent le nectar, visitent chaque plante et nourrissent des fleurs dignes du paradis. Un art raffiné n’a point arrangé ces fleurs en couches ou en bouquets curieux; mais la nature libérale les a versées avec profusion sur la colline, dans le vallon, là où le soleil du matin échauffe d’abord la campagne ouverte, et là où le feuillage impénétrable rembrunit à midi les bosquets.
«Tel était ce lieu; asile heureux et champêtre, d’un aspect varié; bosquets dont les arbres riches pleurent des larmes de baumes et de gommes parfumées; bocages dont le fruit, d’une écorce d’or poli, se suspend aimable et d’un goût délicieux. Fables vraies de l’Hespérie, si elles sont vraies, c’est seulement ici. Entre ces bosquets sont interposés des clairières, des pelouses rases, des troupeaux paissant l’herbe tendre, ou bien des monticules plantés de palmiers s’élèvent; le giron fleuri de quelque vallon déploie ses trésors: fleurs de toutes couleurs, et la rose sans épines.
«D’un autre côté sont des antres et des grottes ombragées qui servent de fraîches retraites; la vigne, les enveloppant de son manteau, étale ses grappes de pourpre, et rampe élégamment opulente. En même temps les eaux sonores tombent de la déclivité des collines; elles se dispersent, ou, dans un lac qui étend son miroir de cristal à un rivage dentelé et couronné de myrtes, elles unissent leurs cours. Les oiseaux s’appliquent à leur chœur; des brises, de printanières brises, soufflant les parfums des champs et des bocages, accordent à l’unisson les feuilles tremblantes, tandis que l’universel Pan, dansant avec les Grâces et les Heures, conduit un printemps éternel.»
Il faut convenir que Pan, les Grâces et les Heures arrivent assez inopinément dans le Paradis terrestre. Ceci nous met en plein paganisme, et nous fournit l’occasion de remarquer que la mythologie grecque a aussi son Éden. Sous le règne du vieux Saturne, à cette époque heureuse que les poëtes ont nommée l’Age d’or, temps de paix, d’innocence et de félicité sans mélange, les hommes, ignorant les arts de la civilisation, en ignoraient aussi les vices et les fléaux; tout souriait autour d’eux, et la terre n’était qu’un immense et délicieux jardin, où régnait un éternel printemps. Ovide a peint en quelques traits de son pinceau magistral cet âge fortuné où d’eux-mêmes, sans lois, sans, tribunaux, sans armées, les hommes vivaient fraternellement; la misère et la richesse, la crainte et l’ambition leur étaient inconnues.
Mollia securæ peragebant otia gentes;
Ipsa quo que immunis, rastroque intacta, nec ullis
Saucia vomeribus, per se dabat omnia tellus;
Contentique cibis nullo cogente creatis,
Arbuteos fœtus, montanaque fraga legebant,
Gornaque, et in duris hærentia mora rubetis,
Et quæ deciderant patula Jovis arbore glandes.
Ver erat seternum, placidique tepentibus auris
Mulcebant Zephyri natos sine semine flores;
Mox etiam fruges tellus inarata ferebat,
Nec renovatus ager gravidis canebat aristis.
Flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant,
Flavaque de viridi stillabant ilice mella.
Avant de quitter le domaine de la fiction, jetons encore un coup d’œil sur quelques-uns des jardins que les poëtes ont donnés pour demeures aux divinités terricoles. Les îles de Chypre et de Cythère, où la blonde Aphrodite aimait à se retirer avec son fils Éros, en compagnie des Grâces, des Ris et des Jeux, étaient de délicieux jardins, où fleurissaient les myrtes, les rosiers et mille autres plantes parfumées. L’île de Calypso, dont les délices ne purent faire oublier au sage Ulysse son aride rocher d’Ithaque, non plus que la beauté de la Nymphe ne put effacer de son cœur le souvenir de la fidèle Pénélope, cette île était encore une sorte de paradis, un jardin d’où un homme moins vertueux que le fils de Laërte ne se fût pas arraché sans d’amers regrets.
«Mercure touche à l’île éloignée, dit Homère, et, s’élevant du noir domaine des mers sur la rive, marche vers la grotte spacieuse qu’habitait la belle Nymphe. Elle était dans sa demeure. La flamme éclatante de grands brasiers y consumait le cèdre et le thym odorants, et ces parfums se répandaient dans l’île. Tandis que, formant un tissu merveilleux, la déesse faisait voler de ses mains une navette d’or, la grotte retentissait des sons harmonieux de sa voix. Cette demeure était environnée d’une antique forêt toujours verte, où croissaient l’aune, le peuplier, le cyprès qui embaume l’air. Là, au plus haut de leurs branches, avaient bâti leurs nids les rois du peuple ailé, l’épervier impétueux, l’oiseau qui fend les ombres de la nuit, et la corneille marine qui, poussant jusqu’au ciel sa voix bruyante, se plaît à parcourir l’empire d’Amphitrite. Une vigne fertile étendait ses pampres beaux et flexibles sur tout le contour de la vaste grotte, et brillait de longues grappes de raisin. Quatre fontaines voisines roulaient une onde argentée, et, se séparant et formant divers labyrinthes sans se confondre, allaient au loin la répandre de toutes parts. Et l’œil, tout alentour, se perdait dans de vastes prairies où l’on reposait mollement sur un doux gazon émaillé par la violette et les fleurs les plus aromatiques. Telle était la beauté de ces lieux, qu’un dieu même ne pouvait s’y rendre sans arrêter ses pas, saisi d’un charme ravissant.»
On se rappelle qu’un des douze travaux d’Hercule fut d’enlever les pommes d’or du jardin des Hespérides; ce qui signifierait, d’après certains auteurs, que le héros grec aurait le premier acclimaté les orangers en Grèce. Selon la Fable, ces fameuses pommes d’or avaient été données par Junon à Jupiter, le jour de son mariage avec le père des dieux et des hommes. Les Hespérides, à qui celui-ci les avait confiées, les faisaient garder par un dragon terrible, qui ne dormait jamais. Après qu’Hercule eut vaincu ou endormi ce dragon et dérobé les pommes d’or, Minerve les lui reprit pour les restituer à ses protégées, les Hespérides. Le géographe Hylax, qui vivait six cents ans avant l’ère chrétienne, a décrit avec détails le jardin des Hespérides, et en a même donné les dimensions exactes. Il le place en Afrique, au pied du mont Atlas, ou dans la Cyrénaïque. On y voyait, outre les arbres à pommes d’or ou les orangers, des amandiers, des oliviers, des grenadiers et une foule d’autres arbres et arbrisseaux. Ce jardin était-il une création de pure fantaisie, ou une allégorie sous laquelle les poëtes anciens ont voulu cacher quelque enseignement; ou enfin, y aurait-il eu réellement autrefois, en Afrique, un vaste jardin spécialement affecté à la culture des orangers, et appartenant à quelque prince ou princesse qui le faisait garder avec un soin jaloux? Cette dernière hypothèse n’est pas la moins vraisemblable des trois, et l’histoire des plantes utiles offre plus d’un exemple de ces prohibitions sévères, qui ont toujours fini par être violées par quelque audacieux aventurier.
PARADIS DE QUETZALCOATL.
Je ne puis clore ce chapitre sans produire un dernier et frappant témoignage de l’unanimité du genre humain à proclamer l’horticulture le premier, le plus divin des arts, et le jardin le séjour le plus digne de l’homme en qui le génie s’unit à la vertu. Ce témoignage nous vient de l’autre côté de l’Océan, du cœur même du nouveau monde. L’Osiris, le prophète civilisateur des anciens Mexicains, était, dit le savant Torquemada, un jardinier favorisé des dieux. Les Indiens le vénéraient comme un dieu sous le nom de Quetzalcoatl. Il avait fixé sa résidence sur la montagne de Tzatzitepec, non loin de l’antique Tula, et, mettant à profit la diversité des climats et la bonté naturelle du sol, il s’y était créé un vrai paradis terrestre. Les épis de maïs y étaient si magnifiques, qu’une seule tête de ce blé des Indes faisait la charge d’un homme, et qu’on eût pu se rassasier avec un de ses grains dorés. Les cotonniers y donnaient naturellement une toison de pourpre éclatante. Je fais grâce au lecteur de la savante nomenclature des végétaux merveilleux réunis dans cet Éden: nos oreilles ne s’habituent pas aisément aux consonnances bizarres des mots mexicains. Qu’il nous suffise de savoir, par la dénomination des oiseaux chanteurs de ce délicieux jardin, ce qu’étaient ces rossignols et ces fauvettes: le xiutolotl, le tlanquechol, le zuguan y faisaient retentir incessamment les échos de leurs ritournelles champêtres. L’un des plus beaux arbres du Tzatzitepec était le cacaoyer. Son tronc était gigantesque; il portait des fruits énormes, dont l’écorce, aux teintes mélangées d’or et de pourpre, était le digne ornement de ce splendide végétal. Or il arriva que Quetzalcoatl ne put jouir de ces délices sans désirer l’immortalité. Un malin nécroman, envieux de son bonheur, parvint à lui persuader qu’au moyen d’un certain breuvage le privilége qu’il demandait aux dieux lui serait accordé. Mais, ô douleur! la coupe fatale fut vidée, et la raison du prophète s’égara; dans sa démence il changea en plantes inutiles ou vénéneuses ces beaux arbres qu’il avait fait croître avec tant de soin; le cacaoyer lui-même fut changé en mitzquitl (sans doute quelque plante aux propriétés funestes). Le demi-dieu s’enfuit de Tula, et ne revit jamais son paradis. Par une grâce suprême, les dieux voulurent lui épargner le tourment des regrets. En perdant son bonheur, il en perdit aussi le souvenir.