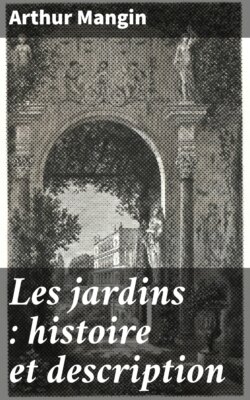Читать книгу Les jardins : histoire et description - Arthur Mangin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITREI
INTRODUCTION–ÉLOGE DES JARDINS
ОглавлениеTable des matières
SI j’avais à définir les jardins, je dirais qu’ils sont le chef-d’œuvre du génie de l’homme, inspiré par le chef-d’œuvre de la nature. En effet, soit que l’on considère les jardins naturels ou les jardins artificiels, on voit que ce qui constitue les uns et les autres n’est rien de moins que l’harmonieux assemblage des objets les mieux faits pour charmer nos sens et plaire à notre esprit.
J’appelle jardins naturels ces paysages, ces sites pittoresques, qui revêtent, selon les contrées et les climats, les caractères les plus variés: ici riants et coquets; là sauvages et grandioses; partout formés des mêmes éléments: l’azur du ciel, les feux du soleil, les contours argentés ou dorés des nuages, les collines ondoyantes ou les montagnes abruptes, les eaux, les prés fleuris, les arbres couverts de feuilles, les oiseaux au brillant plumage, au gazouillement joyeux. Or chacune de ces choses, prise isolément, nous ravit de plaisir et d’admiration. Qu’est-ce donc lorsqu’elles sont réunies dans un tableau qu’on dirait composé par un artiste sans rival, et qui nous montre à la fois toutes les merveilles de la création!
Ai-je besoin maintenant de démontrer qu’en perfectionnant, en embellissant encore ce que la nature elle-même avait fait de plus beau, l’art a réalisé à son tour la plus heureuse de ses conceptions? Il me suffira d’invoquer ici le consentement universel, juge irrécusable en pareille matière. Et j’entends par consentement universel, non l’opinion, toujours suspecte, du plus grand nombre, mais un sentiment unamime, d’autant plus affirmatif qu’il est plus réfléchi et plus éclairé.
Interrogeons les habitants des campagnes. Il n’est pas un paysan qui ne tienne au petit carré de terre où il cultive quelques pieds de fleurs et quelques arbres fruitiers, presque autant qu’au champ qui le fait vivre. La villa du bourgeois aisé n’aurait point de raison d’être si elle n’était entourée d’un jardin. On en peut dire autant du château, depuis que les châteaux ont cessé d’être des forteresses pour devenir des habitations de plaisance. Le château, comme toute maison de campagne, emprunte sa plus grande valeur au jardin ou au parc qui l’environne. C’est dans cette partie de son domaine que l’homme de goût se complaît; c’est à l’embellir qu’il met tous ses soins et qu’il n’épargne point la dépense; c’est là qu’il se sent libre et heureux et qu’il savoure dans leur plénitude les priviléges de l’aisance ou de la richesse. Et si j’osais emprunter le langage des mathématiciens pour exprimer ma pensée, je dirais que, dans une résidence champêtre bien entendue, la magnificence des jardins doit être au moins en proportion géométrique avec celle des édifices; ce qui signifie qu’un grand château avec un jardin de peu d’étendue ou médiocrement planté serait une anomalie, tandis qu’on ne sera jamais choqué de rencontrer une habitation modeste au milieu d’un vaste enclos plein de verdure et de fleurs. En d’autres termes encore, le jardin est le principal, la maison est l’accessoire, ou, si l’on veut, le pis-aller. On y rentre le soir le plus tard possible, et le matin, on n’a rien de plus pressé que d’en sortir. Le sommeil, les repas, des occupations indispensables, le mauvais temps,–ce qui se traduit par ce mot fatal, la nécessité, a seul le pouvoir de vous rappeler dans les appartements; encore faites-vous en sorte de ne point perdre de vue le jardin; et dès que vous le pouvez, vous vous échappez pour y retourner. Le jardin est le vrai temple de l’hospitalité. Quel salon peut lui être comparé? Quelles tentures, quel ameublement valent ces corbeilles de fleurs, ces rideaux de verdure, ces tapis de gazon? Un visiteur nouveau survient-il, votre premier plaisir comme votre premier devoir est de lui faire les honneurs du jardin, de le promener dans les allées, dans les serres, autour de la pièce d’eau, de lui faire admirer, des points culminants, les campagnes environnantes. Et si ce visiteur est un convive, vous vous gardez bien de le retenir à l’intérieur après le déjeuner ou le dîner. Le café ne se prend pas ailleurs qu’au jardin, tout au moins sur la terrasse ou sous la vérandah.
O fortunatos nimium, sua si bona norint...
Heureux s’ils savent apprécier les bienfaits de la fortune, heureux ceux qui possèdent un jardin, fût-il des plus modestes, lorsque ce jardin a pour cadre la campagne même le jardin de la naturel! Ceux-là sont un objet d’envie pour le citadin. Heureux: ce dernier–heureux relativement–si le Ciel lui permet d’habiter une de ces villes que n’étrangle pas une étroite ceinture de murailles, et dans lesquelles la population accumulée n’oblige pas d’honnêtes gens à s’empiler les uns au-dessus des autres afin d’économiser le terrain. Là encore chaque famille a pour elle sa maison, et avec la maison un jardin proportionné à ses ressources. Mais ce qui est de règle et, pour ainsi dire, de droit commun dans ces charmantes cités, devient l’exception dans les grandes fourmilières où la politique, l’industrie, le commerce attirent et retiennent captive lu foule besogneuse des gens en place, des solliciteurs, des spéculateurs, des négociants, des fabricants, des ouvriers et des mendiants. Ici les jardins privés disparaissent rapidement pour faire place à des rues, à des boulevards, à des constructions énormes et uniformes.
«Telle est, dit Loudon dans l’introduction de son Traité sur la formation et l’amélioration des résidences champêtres, telle est la supériorité des occupations et des plaisirs de la campagne, que le commerce, l’industrie, les grandes agglomérations d’hommes et les cités populeuses peuvent être justement déclarées contre nature.» Cependant la nature ne perd point ses droits, ni les jardins leur irrésistible prestige. Savez-vous, en effet, quelle est la pensée qui anime et soutient tous ces gens rivés à la chaîne d’un travail ingrat et dévorant? Eh! oui, vous le savez, lecteur; car cette pensée est la vôtre, si pour votre malheur vos intérêts vous forcent à vivre à Paris ou à Lyon, à Londres ou à Manchester, à New-York ou à Boston. Cette pensée, c’est de gagner quelques mille francs de rente et de se retirer en province, à la campagne. quelque part où il y ait du soleil, de l’air et de la verdure, et d’y «planter ses choux,» c’est-à-dire d’y cultiver un jardin. Du plus riche au plus pauvre, du plus humble au plus élevé en dignité, chacun en est plus ou moins tourmenté. «Il est évident, dit encore Loudon, que de tels sentiments sont innés dans l’esprit humain. Tous les hommes, même ceux qui sont nés dans les villes, ont les mêmes idées, qui, si elles ne sont pas oblitérées par la misère ou la maladie, les poursuivent durant tout le voyage de la vie.» On sait l’histoire de l’empereur Dioclétien qui, descendu du trône le plus puissant qui fut jamais et réfugié dans une humble retraite, repoussait avec effroi ceux qui venaient le supplier de reprendre la pourpre. «Ah! s’écriait-il, si vous voyiez les belles laitues que je cultive dans mon jardin, vous ne me parleriez plus du pouvoir suprême!»
Ce n’est pas tout: si fières que soient les grandes villes de leurs édifices publics, de leurs églises, de leurs palais, de leurs théâtres, leurs plus beaux joyaux, ceux dont elles font le plus de cas et qui excitent le plus l’admiration des étrangers, ce sont les grands jardins dont elles ont été dotées par la munificence des princes ou par la sollicitude intelligente de leurs édiles.
L’immense majorité des Parisiens connaît à peine les monuments et les musées de Paris, et s’en soucie fort peu. Il n’en est pas un qui n’affectionne son jardin:–chacun appelle ainsi celui qui est le plus près de sa demeure.–Hiver comme été, dès qu’un rayon de soleil illumine la grand’ville, les jardins des Tuileries, du Luxembourg, des Plantes, le bois de Boulogne, le parc de Monceaux et les squares nouvellement créés dans plusieurs quartiers se remplissent d’une foule joyeuse. La même chose se passe à Londres, et certainement à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Madrid; car toutes ces grandes capitales ont des jardins publics, objets de leur prédilection. Quand parut, vers la fin de1865, le décret qui autorisait l’administration municipale à livrer aux terrassiers et aux maçons une partie considérable des jardins du Luxembourg, ce ne furent pas seulement les habitants des rues environnantes, ce fut la population de Paris tout entière qui se sentit atteinte et qui protesta contre cette décision. La question du Luxembourg a occupé pendant plusieurs mois l’opinion publique et les grands pouvoirs de l’État, à l’égal des plus graves questions de politique intérieure ou extérieure. Je dirai plus loin comment elle a été résolue.
Otez à Paris ses monuments de pierre; supposez que les églises, les musées, les académies, les théâtres soient des bâtiments peu ou point différents, à l’extérieur, des maisons qui bordent les rues et les boulevards, et que le chef de l’État, au lieu d’avoir pour demeure un palais immense, se contente d’un hôtel confortable: Paris sera encore une des plus belles villes du monde; les sciences, les lettres, les arts, l’industrie, le commerce, continueront d’y fleurir, et la gaieté française, d’y régner comme auparavant. Mais supposez que quelque mauvais génie changeant un beau jour en démence la sagesse du gouvernement, lui inspire l’idée de remplacer partout les jardins par des rues ou des places pavées ou macadamisées, avec des trottoirs de bitume, des colonnes à gaz et des maisons à cinq étages. Plus de Tuileries ni de Champs-Élysées, ni de Luxembourg, ni de Jardin des Plantes, ni de squares; plus d’arbres, plus de fleurs, plus de verdure! Évidemment le séjour de Paris deviendrait impassible. Ea peu d’années, l’ennui, le spleen, la démoralisation, la désertion, peut-être des maladies inconnues jusque-là transformeraient en un désert cette reine des cités. Le monarque lui-même, fut-il un Louis XI, qui aurait accompli cette abomination, ne voudrait pas rester quinze jours aux Tuileries. La cour, les ministères, les chambres émigreraiemt en masse à Versailles, qui redeviendrait, comme au siècle dernier, la capitale effective de l’empire! Là, du moins, on retrouverait ces jardins auxquels la ville de Louis XIV doit de subsister encore à l’état de chef-lieu de départememt, et qui, plus que son splendide musée, y attirent les Parisiens et les étrangers. Je dis Versailles comme je dirais Saint-Germain, ou Saint-Cloud, ou Fontainebleau; mais à coup sûr, c’en serait fait de Paris.
Delille, qui a si bien chanté les jardins, s’est rendu coupable d’une sorte d’hérésie en les définissant «le luxe de l’agriculture.» Quoi! rien de plus? Mais les jardins sont le luxe par excellence, le luxe universel, le luxe du pauvre et celui du riche, des simples citoyens et des potentats, des individus et des nations; et ils sont encore bien plus le luxe des villes que celui des campagnes, et des peuples civilisés que des peuples primitifs. Le nombre, l’étendue, l’arrangement, la culture des jardins privés et des jardins publics donnent la mesure exacte du degré de prospérité d’un État, de la sagesse de ses institutions, de l’aisance et de la moralité des citoyens, de leur goût, de leurs lumières et du degré de faveur qu’ils accordent aux sciences, ou* lettres et aux arts. J’aurai l’occasion de revenir sur ces considérations, et de montrer partout l’art des jardins progressant et se propageant avec la civilisation, avec la liberté, avec la richesse, avec la paix au dehors et la concorde au dedans, en un mot, avec tout ce qui fait vraiment la gloire et le bonheur des nations.
Parmi les châteaux dont je disais plus haut qu’ils ne sauraient exister sans jardins, il faut comprendre les châteaux en Espagne, ces demeures imaginaires que la fée du logis, d’un coup de sa baguette, fait surgir à nos yeux quand nous rêvons tout éveillés, et qui sont les seuls où rien ne manque de ce qui peut flatter nos goûts et satisfaire nos moindres caprices. J’affirme hardiment que tout château en Espagne a son jardin, petit ou grand selon l’ambition de l’architecte.
J’en appelle à vous tous qui me lisez. A moins que, dès votre enfance, la Fortune n’ait épanché sur vous les trésors de sa corne d’abondance, et jonché de fleurs devant vos pas les chemins de la vie, vous avez fait plus d’une fois des châteaux en Espagne; vous avez rêvé pour votre jeunesse, votre âge mûr ou votre vieillesse, un palais, une maison, une chaumière où vous vivriez à votre guise, oisif ou livré au travail, dans le silence de l’isolement ou parmi les doux bourdonnements d’êtres chéris, ou encore au milieu des fêtes et des plaisirs bruyants. Eh bien! n’est-il pas vrai que cette demeure vous est toujours apparue avec un joli jardin, sinon même avec un grand parc, dont les allées, les bosquets et les plates-bandes vous étaient aussi familiers que si vous les eussiez parcourus cent fois?.......
On a vu par le monde certains philanthropes qu’on a nommés utopistes, parce qu’ils passaient leur vie à bâtir des châteaux en Espagne, non pour eux, mais pour l’humanité (utopie et château en Espagne sont des expressions équivalentes). Ces honnêtes gens ont construit sur le papier des cités idéales, où les hommes, unis sous la sainte loi de la fraternité, doivent goûter un bonheur parfait. De vastes jardins bien ombragés et bien fleuris occupent la place d’honneur sur les plans de ces communes-modèles, de ces phalanstères, dont les hôtes fortunés les cultiveront en chantant des hymnes à la Nature. C’est là que les cénobites de l’avenir se reposeront de leurs travaux, et que, couronnés de fleurs, ils célébreront les fêtes de la famille et de la patrie nouvelle. J’affirmerais volontiers que la perspective de posséder un jardin, même en participation avec quelques centaines d’associés, a gagné aux écoles socialistes de nombreux. adeptes parmi les malheureux plébéiens des grandes villes, condamnés à vivre dans des logements sans air, sans lumière, sans soleil, et à entretenir furtivement sur le rebord de leur lucarne un rosier et une giroflée. Si les bonnes gens des petites villes et les paysans ont été moins empressés de se ranger sous la bannière des réformateurs, c’est qu’ayant à eux des jardins qu’ils arrangeant à leur guise, et au delà de ces jardins la campagne, ils se souciaient médiocrement d’échanger de tels avantages contre les bienfaits de la communauté égalitaire en de la phalange harmonienne.
Le prestige des jardins est tel, qu’il se fait sentir jusque dans les choses les plus ordinaires de la vie. Combien d’établissements publics ou privés qui, soit dit e. passant, ne sont pas sans analogie avec les communautés et les phalanstères: hospices, couvents, maisons de santé, de retraite ou d’éducation, casinos, pensions bourgeoises, hôtelleries, asiles ouverts à la douleur, à la piété, à la vieilesse, écoles pour l’enfance, lieux de repos pour les voyageurs ou de plaisir pour les oisifs et les viveurs de tout étage,–et dont le principal mérite est de posséder un jardin!
Mais quoi! lorsque l’heure des adieux suprêmes a sonné, un dernier asile nous attend, et cet asile est encore un jardin: triste jardin, il est vrai, avec sa bigarrure de pierres blanches et de croix noires ombragées par les longs rameaux du saule pleureur et par la cime rigide des cyprès. D’autres arbres au part plus dégagé, au feuillage moins sombre, et les fleurs que des mains pieuses cultivent alentour des tombeaux, viennent cependant tempérer la mélancolie de cette austère décoration. Le soleil, d’ailleurs, y projette ses rayons; les oiseaux y chantent au printemps; les papillons y voltigent; les roses, les œillets et les violettes y mêlent leurs effluves embaumées à la senteur résineuse des arbres verts. Et lorsque ceux qui sont demeurés viennent apporter à ceux qui sont partis le tribut de leurs souvenirs et de leurs larmes, cet épanouissement de la vie sur la terre des morts les raffermit et les console. Ils se persuadent que quelque chose des êtres aimés qui dorment là a passé dans la séve des arbres et dans le parfum des fleurs; et le murmure du vent, le chant de l’oiseau, le frémissement de l’insecte, leur semblent autant de voix qui disent: La Mort n’est qu’un vain fantôme; la Vie est éternelle!