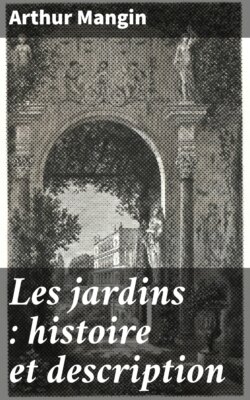Читать книгу Les jardins : histoire et description - Arthur Mangin - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLIVRE II
LES JARDINS DU MOYEN AGE ET DE LA RENAISSANCE
Table des matières
CHAPITREI
LE MOYEN AGE–MONASTÈRES ET CHATEAUX
Table des matières
LAISSONS passer le flot tumultueux des soulèvements et des invasions qui anéantirent l’empire d’Occident. Après ce prodigieux cataclysme, l’Europe n’est plus reconnaissable. Un monde a péri, un autre lui succède. Une civilisation toute différente de celle qui vient de disparaître se constitue péniblement à travers des agitations violentes qui arrêteront longtemps l’essor de l’esprit humain. Dans cette nouvelle évolution progressive, les peuples chrétiens d’Occident traversent les mêmes phases par lesquelles nous avons vu passer ceux de la Grèce et de Rome; avec cette différence, cependant, que leur point de départ est plus avancé, puisqu’il leur est donné de recueillir au moins les lambeaux de l’héritage laissé par les sociétés païennes. Au lieu d’un empire universel composé d’éléments hétérogènes, sans autre lien que la commune servitude, l’Europe offre aintenant un grand nombre d’États reliés entre eux par une même croyance, fondés à peu près sur les mêmes principes hiérarchiques, mais divisés d’intérêts, et n’ayant guère d’autre souci que de s’entre-dévorer. L’organisation féodale, qui crée dans chacun de ces États une foule de pouvoirs rivaux, augmente encore la confusion et l’anarchie, et fait de l’Europe entière un immense champ de bataille.
En ce beau temps de la chevalerie, qu’on a peut-être flatté en le comparant à l’âge héroïque de l’antiquité grecque, le maniement des armes est le seul art en honneur parmi les hommes de noble naissance. La science et la littérature ne sont cultivées que par les clercs séculiers et réguliers, et se réduisent aux études théologiques. Les arts et les métiers sont abandonnés aux bourgeois et aux manants; l’agriculture, aux serfs. L’architecture est exclusivement religieuse et militaire. L’aspect des édifices publics et privés accuse l’inégalité des conditions et le défaut complet de sécurité. Les maisons sont chétives et pressées les unes contre les autres, dans de petites villes aux rues étroites et tortueuses, défendues par des remparts élevés, par des fossés profonds, par des portes massives. Le paysan, attaché à la glèbe,–c’est l’expression consacrée,– n’a pour habitation qu’une misérable cabane, qui ne lui appartient pas plus que le champ qu’il cultive et les produits qu’il récolte. Au dehors et souvent au dedans des villes, les demeures des grands sont des forteresses flanquées de tours au toit aigu, dentelées de créneaux et de mâchicoulis, percées de meurtrières. En maint endroit vous les voyez se dresser isolées, menaçantes et sombres au flanc d’une colline, ou bien au sommet d’un roc escarpé ou d’un haut promontoire.
Les couvents mêmes ne sont pas tellement protégés par le respect qu’inspire le caractère sacré de leurs habitants, que ceux-ci ne jugent prudent de se tenir en garde contre les déprédations des gens de guerre. Le soin de leur sûreté, tout autant que la sévérité des règles monastiques, guide les cénobites dans le choix du lieu, et préside à la construction des épaisses murailles derrière lesquelles ils s’abritent. Les bâtiments sont en général peu élevés, et enserrent des espaces libres, des cours ou préaux d’assez randes dimensions; ils sont solidement bâtis, et ont peu d’ouvertures sur leurs faces extérieures. Le tout, y compris des terrains cultivés, des champs même, est enveloppé d’une ceinture de maçonnerie précédée d’un retranchement, et ressemble assez bien à une citadelle. On y trouverait au besoin, dans quelque salle souterraine, un assortiment convenable de frondes, d’arbalètes et d’épieux,–et plus tard, d’arquebuses,–pour repousser les routiers et les malandrins qui parcourent le pays, pillant ou rançonnant tout ce qui n’est pas de taille à leur résister.
JARDIN DANS UN COUVENT.
Ainsi le veut le malheur de ces temps, où les relations sociales n’existent pour ainsi dire pas. La paix même du cloître ne peut être qu’une paix armée; nul n’a le droit de compter sur le lendemain, parce que le faible est partout à la merci du fort, et le fort exposé à succomber à son tour sous les coups d’un plus fort; enfin les ravages de la peste et de la famine s’ajoutent fréquemment à ceux de la guerre et du brigandage.
Tant de fléaux accablant à la fois les populations expliquent les funèbres pressentiments, les prédictions sinistres qui avaient cours dans toute l’Europe chrétienne, l’attente prochaine de la fin du monde, les orgies des uns, le renoncement ascétique des autres: ceux-là voulant se hâter de jouir; ceux-ci se préparant, par le jeûne, la prière et les mortifications, à comparaître aux assises solennelles du dernier jugement.
On conçoit qu’au sein d’une société en proie à de tels maux, tourmentée par de si poignantes préoccupations, les entreprises utiles et, à plus forte raison, les arts de luxe fussent grandement négligés. Là où règne la misère, c’est posséder le luxe que de ne point manquer du nécessaire. Un champ fertile, un clos planté d’arbres fruitiers en bon rapport et d’herbes potagères, étaient des oasis clair-semées au milieu des landes stériles, des forêts sauvages et des marais insalubres qui couvraient la presque totalité des contrées aujourd’hui les plus florissantes; on ne connaissait guère, à cette époque, d’autres jardins. Les plus vastes et les mieux entretenus étaient ceux des monastères.
«Dans les abbayes où les traditions antiques s’étaient conservées, dit M. Charles Blanc, de vastes enclos étaient consacrés à la culture des légumes, des fleurs, des arbres fruitiers et des plantes rares. Les bénédictins, les prémontrés, les ordres même les plus austères, tels que les chartreux, avaient des plates-bandes, des promenades, des réservoirs, et il va sans dire que la composition de leurs jardins était simple et régulière comme leur vie. Les murs qui les défendaient contre les bruits du monde se couvraient à l’intérieur d’espaliers bien tenus. Quelquefois des vignes étaient suspendues aux treillages d’une allée couverte, et l’on entretenait du poisson dans des viviers semblables à ceux qu’on a retrouvés plus tard dans les ruines de Pompeï. Tracés en longs parallélogrammes, ces bassins s’arrondissaient ou s’échancraient pour se prêter à la forme demi-circulaire des exèdres où les religieux venaient s’asseoir. Les moines de l’Orient,–nous l’avons vérifié sur le mont Hymette,–arrêtaient l’eau des montagnes pour répandre la fraîcheur dans leurs plantations.» L’horticulture, dans les couvents du moyen âge, visait surtout à l’utile. Un monastère était im microcosme. Les religieux étaient obligés d’y réunir toutes les choses nécessaires à la vie de chaque jour, afin de réduire le plus possible leurs relations avec le dehors. Des terrains particuliers étaient ordinairement affectés aux différentes cultures; le champ, le verger, le jardin proprement dit, la promenade plantée de grands arbres, avaient leurs places marquées dans les dépendances du couvent.
Les herbes potagères, les fleurs que les reclus ou les recluses entretenaient pour leur amusement ou pour l’ornement de leur église, les plantes médicinales enfin, composaient le jardin proprement dit. La vigne avait droit de cité partout, sans préjudice du clos qui pouvait lui être spécialement consacré. On doit citer comme une des abbayes les plus anciennes, et comme une des plus remarquables pour la bonne ordonnance des bâtiments et des cultures, celle de Saint-Gall, en Suisse, qui était déjà florissante au temps de Charlemagne. N’oublions pas non plus de signaler la place importante que les plantes médicinales occupaient dans les jardins monastiques, ainsi que dans ceux des princes et des riches particuliers. La médecine ne fut, jusqu’au seizième siècle, qu’un art empirique, consistant surtout dans l’emploi des simples, et dont les moines d’une part, les alchimistes et les sorciers d’autre part, étaient les seuls adeptes. L’abbaye du Mont-Cassin, où les bénédictins créèrent la première école de médecine et de pharmacologie, posséda aussi, selon toute probabilité, le premier jardin botanique.
En dehors des couvents, dont le plus grand nombre étaient bâtis en pleine campagne, et autour desquels de pauvres familles venaient se grouper pour offrir aux communautés le travail de leurs bras en échange d’une protection efficace, c’est dans les villes capitales ou à peu de distance de ces villes qu’il faut, au moyen âge, chercher des jardins disposés à la fois dans une vue d’agrément et d’utilité. C’est là seulement qu’on pouvait trouver de la sécurité; c’est là que les rois et les seigneurs plus amoureux du repos et des plaisirs que de la guerre et des expéditions hasardeuses aimaient à fixer leur résidence. Au delà du cercle restreint où s’étendait l’action de la police urbaine et des forces militaires attachées à la personne du prince, chacun n’avait à attendre de protection que de lui-même et de ses gens. Les personnages les plus considérables, lorsqu’ils habitaient leur manoir, devaient s’y faire garder comme dans une prison, et n’en sortir que bien armés et bien accompagnés. Planter un jardin hors de l’enceinte fortifiée, était impossible: derrière les tourelles et les murs du château, l’air et le soleil pénétraient à peine; mais des fleurs et des arbres venaient s’épanouir sur les remparts, dont le sommet était disposé en terrasse. Ces petits jardins muraux, qui couronnaient quelques demeures féodales, qui en égayaient la sombre monotonie et faisaient la joie de la châtelaine et de ses enfants, n’avaient, hélas! qu’une existence bien précaire. Aux jours d’alarmes, ils étaient les premiers atteints par les projectiles de l’ennemi, ou sacrifiés par les défenseurs de la place.
Les anciens rois de France avaient pourtant des maisons de plaisance aux environs de Paris; mais les vieilles chroniques ne donnent que des renseignements incomplets, et souvent assez obscurs, sur la situation géographique de ces châteaux et sur la disposition des bâtiments et de leurs dépendances. Le premier point est pour nous d’un médiocre intérêt, et le lecteur se soucierait peu, sans doute, de s’engager dans l’examen de questions telles que celle de savoir, par exemple, si la Rotolajensis villa que possédaient les rois de la première race était au Roule ou à Rueil, et quel était le Novigentum (Nogent) où Chilpéric allait passer en été ses moments de loisir. Quand même nous parviendrions à résoudre ces graves problèmes longuement et doctement discutés par Sauval, nous ne saurions sans doute de ce qui vraiment nous intéresse, c’est-à-dire de la composition des jardins royaux du moyen âge, rien de plus que ce que nous en apprennent le fameux capitulaire de Villis, et mieux encore les descriptions qui nous sont parvenues des jardins, courtilles et coultures de la bonne ville de Paris, dont il sera parlé tout à l’heure.
Sauval nous dit seulement que la plupart des villas des princes carlovingiens touchaient à des forêts; ce qui fait supposer que ces princes ne s’y rendaient que pour se livrer au plaisir de la chasse. Plus tard même, Louis IX se retirait volontiers au château de Vincennes, qui n’était cependant pas un séjour bien gai, et qui n’avait point de jardin. Mais le pieux monarque n’avait que quelques pas à faire pour se trouver dans la forêt, qui lui tenait lieu de parc. C’est là qu’il se promenait avec ses familiers, ou qu’il s’asseyait sous un chêne, pour écouter les gens de toute classe qui avaient quelque supplique à lui adresser ou quelque affaire litigieuse à lui soumettre. Notons en passant que saint Louis tenait ces sortes de lits de justice en roi patriarche, «vêtu d’une cotte de camelot, d’un surcot de tiretaine sans manches et d’un manteau de sandal noir,» et non en costume d’apparat: manteau fleurdelisé, couronne en tète et sceptre en main, ainsi qu’on se plaît à le représenter.
Saint Louis affectionnait encore deux autres maisons de plaisance situées à Passy et à Étampes, et bâties l’une et l’autre par Robert, fils de Hugues Capet, à qui l’on attribue également la fondation du château de Saint-Germain-en-Laye. Mais il est impossible de dire si ces résidences étaient ou non accompagnées de jardins: ce qui, du reste, importe peu; car ces jardins, s’ils existaient, ne pouvaient l’emporter en richesse et en élégance sur ceux qu’on voyait à Paris, et que les vieux chroniqueurs s’accordent à vanter comme les plus beaux qu’il y eût au monde.