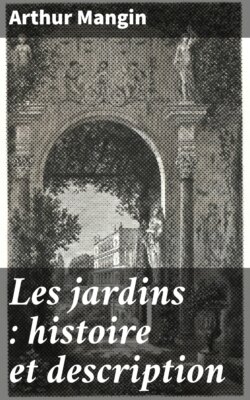Читать книгу Les jardins : histoire et description - Arthur Mangin - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VI
LES JARDINS DE L’ANCIENNE AMÉRIQUE –LES JARDINS MEXICAINS–LES CHINAMPAS OU JARDINS FLOTTANTS LES JARDINS D’OR DE JAUJA–LES JARDINS DES INCAS
ОглавлениеTable des matières
LORSQUE Christophe Colomb aborda les rives enchantées du nouveau monde, il fut tellement ravi à l’aspect de la fertilité que cette nature exubérante étalait sous ses yeux, qu’il fit de ces régions ignorées avant lui une vraie terre de promission, où devaient se réaliser les rêves les plus poétiques.
Dès son premier voyage et à la vue d’une des Antilles, il imposa à un groupe charmant, où les merveilles de la nature remplaçaient le travail de l’homme, le doux nom de Jardin de la Reine. En donnant cettette dénomination à ces terres à demi noyé, mais parées d’une éternelle verdure, il pensait sans doute à sa protectrice Isabelle la Catholique, et à l’amour inné de cette reine pour les fleurs. Plus tard il chercha sur le continent, en remontant le cours majestueux de l’Orénoque, le plus beau des jardins. Il nous le dit lui-même: en admirant ces rives qui fleurissent éternellement sous le regard divin, il lui semblait que l’Éden allait lui apparaître et s’ouvrir devant lui. Il était bien excusable, après tout, ce rêveur sublime, d’imaginer ainsi l’existence du Paradis terrestre. Il n’était guère, en son temps, de carte enluminée sur vélin jointe aux traités de cosmographie, qui ne présentât aux regards émerveillés des curieux le jardin de délices, avec sa fontaine marmoréenne d’où sortent les quatre fleuves. Il s’en tint à la légende; il n’alla pas jusqu’à l’enceinte sacrée où le glaive de l’ange devait peut-être s’abaisser devant lui; mais, on le sent en lisant ses écrits, ce grand souvenir ne le quitta plus; la terre nouvelle dont il avait doté l’Espagne était à ses yeux une espèce de jardin divin, où sa pensée errait sans cesse.
Les peuples innocents que visita pour la première fois Colomb dans Haïti, et qui se divisaient en deux races bien distinctes, avaient des jardins. Ceux de Guacanagari ne pouvaient se comparer certainement à ceux du terrible Caonabo, le chef indompté des Caraïbes; mais ces vergers fleuris des Ignéris étaient bien plutôt des espaces limités de terrain, consacrés à des cultures utiles, que des lieux d’agrément proprement dits. On y faisait croître le juca ou manioc, la camote nourrissante, diverses espèces de patates douces, des ignames; le tout entremêlé de palmiers et de pruniers monbins: ce n’étaient point des jardins dans la véritable acception du mot. Les anciennes relations américaines nous font bien voir Anacaona, la belle reine des Ignéris, la Fleur d’or, comme on l’appelait en traduisant son nom dans la langue sonore des vainqueurs, s’avançant majestueusement dans ces campagnes fertiles, suivie d’une cour nombreuse, et se livrant à des danses dramatiques devant les étrangers; on ne décrit ni son palais ni ses jardins.
Il n’en fut pas de même en pénétrant dans le Yucatan, siége d’une civilisation évanouie depuis des siècles. Le rude conquistador qui traite habituellement le vainqueur de Mocteuczoma d’une façon si familière, qu’il l’appelle presque toujours «notre Cortez,» Bernai Diaz constate lui-même cette culture antique d’un peuple qui a laissé partout des vestiges de sa magnificence. Sans aucun doute, les palais d’Izamal, de Chichen-Itza, d’Uxmal, de Labna, de Copan et de Palenqué étaient accompagnés de jardins. Des arbres séculaires, que l’on rencontre encore fréquemment parmi ces ruines imposantes, sont là pour, l’attester; ils parent même d’un ombrage qui n’a rien perdu de son ampleur ni de sa beauté les ouvrages des hommes, qu’on voit chaque jour s’écrouler et dont les derniers vestiges auront bientôt dis paru.
JARDINS DE NETZAHUATLCOYOTZIN.
On voit aujourd’hui que ces peuples, dont on commence à exhumer les lointaines origines, furent, en fait d’art et de culture intellectuelle, les maîtres primitifs de ces Aztèques dont Cortez admirait avec une si naïve sincérité la civilisation, parfois supérieure à celle de l’Espagne. Or les jardins, parés d’une foule de merveilles architectoniques, étaient répandus sur toute l’étendue du fertile plateau de l’Anahuac. Le souverain qui régnait à Tetzcuco vers le milieu du quinzième siècle, et que l’on a presque toujours surnommé le Salomon du nouveau monde, Netzahuatlcoyotzin avait dans son royaume des jardins d’une incomparable beauté, qui servirent de modèle un demi-siècle plus tard à ceux dont Mocteuczoma orna sa capitale.
Un historien descendant direct des rois de Tetzcuco, Fernando de Alba Ixtlilxoxitl (la Fleur noire) a pris soin de nous décrire ces lieux enchantés. Les vastes jardins de l’Athènes américaine étaient plantés au midi et à l’est de l’immense palais où Netzahuatlcoyotzin tenait sa cour et réunissait dans un endroit spécial les savants de l’empire, qui formaient comme une sorte d’université. Ce vaste jardin, couvert d’aqueducs, de fontaines, de viviers remplis de poissons et de volières immenses, était abrité d’un bois de deux mille cèdres, que l’historien admirait encore au moment où il réunissait lés souvenirs intimes qui donnent tant de charme à sa narration.
Le roi de Tetzcuco ne possédait pas seulement les jardins de Huetecpan et de Cillan, qui étaient devenus l’ornement de sa capitale; il en avait fait planter un grand nombre d’autres, et le plus célèbre de tous était celui de Tezcotzinco. Nous ne dirons rien ici de ceux de Cauchiacao, de Zinacamoztoc, de Cuetlachiuhtitlan, etc. etc., qui étaient disséminés sur ce beau lac, dont on évaluait alors l’étendue à quatorze lieues, sur sept de large. Plusieurs de ces parcs, au dire de l’historien américain, étaient de véritables jardins d’acclimatation, où l’on cultivait les fleurs et les fruits des régions les plus diverses. Le roi de Tetzcuco ne se contentait point de ces jardins de luxe, qu’embellissaient de splendides constructions destinées à l’arrosage et de vastes labyrinthes; il s’était réservé cinq lots de terre des plus fertiles, qui s’étendaient non loin de la ville, et dont les produits étaient consommés dans le palais. On nous a conservé les noms des cultures royales, qu’entretenaient, hélas! de pauvres gens soumis à la corvée: prestation fâcheuse, sous un roi dont on vante la sagesse, et dont il ne nous paraît point s’être suffisamment préoccupé.
Tezcotzinco, nous l’avons déjà dit, était le lieu de délices par excellence, où le souverain des Alcolhuas allait se délasser de ses travaux. Son étendue était immense, et par sa construction il rappelait les fameux jardins de Sémiramis. «On y montait, rapporte Ixtlilxoxitl, par des gradins dont une partie était en maçonnerie, et l’autre taillée dans le roc.» Des ouvrages hydrauliques d’une admirable exécution avaient été pratiqués dans une montagne voisine, et entretenaient une éternelle fraîcheur dans ce parc aérien. Les eaux amenées ainsi en abondance, grâce à des constructions gigantesques, avaient permis de creuser sur la montagne plusieurs viviers. «Au milieu de l’étang supérieur s’élevait un rocher autour duquel on avait sculpté les hiéroglyphes de toutes les années qui s’étaient écoulées depuis le commencement du règne de Netzahuatlcoyotzin jusqu’à cette époque, ainsi que ce qui s’était passé de plus remarquable dans chacune d’elles: au centre de la roue des années on avait représenté ses armes, qui étaient une maison consumée par les flammes.»
Fatal emblème héraldique, dont le Salomon américain ne soupçonnait pas la dure vérité! Non-seulement le beau jardin de Tezcotzinco fut ravagé avant le temps, le palais incendié; mais l’ouvrage splendide qui entourait le rocher fut brisé. L’ordre de destruction vint d’un saint évêque qui, effrayé des terribles holocaustes humains exigés par la religion sanguinaire de Huitzilopuchtli, tentait d’en effacer jusqu’aux moindres vestiges. Zumarraga, le premier évêque de Mexico, et l’admirable Domingo Betanzos, qui réhabilita les Aztèques dans leur dignité d’hommes, étaient cependant de fervents amis des Indiens. Pourquoi faut-il que l’archéologie américaine ait de si cruels reproches à leur faire!
Si l’on en croit la tradition conservée par l’historien indigène Tezozomoc, le plus ancien jardin de l’empire de Mexico aurait été planté à Huestepec sous la direction d’un certain Tinocetl, surintendant du palais. Le grand roi Mocteuczoma-Illimacuna, qui régnait au quinzième siècle, sentant sa fin approcher, voulut qu’on gravât son image sur les rochers escarpés qui portaient le nom de ces vastes jardins; mais comme il n’y avait en cet endroit que des marais, de grandes herbes et des joncs de dimensions extraordinaires, il fit d’abord amender le terrain, puis on y transporta avec soin les plus beaux arbres de la vallée, les fleurs les plus éclatantes. Disons-le tout de suite, ce que fait aujourd’hui l’horticulture la plus avancée fut pratiqué alors par un peuple à demi barbare: des nattes de roseaux furent tressées pour envelopper les racines des arbres précieux que l’on avait à transplanter et pour les préserver du contact de l’air. Ce jardin s’éleva donc comme par enchantement dans un lieu autrefois désert, et l’empereur en exprima hautement sa satisfaction à l’intendant de ses palais. Tezozomoc a poussé le soin jusqu’à nous indiquer les essences qui furent employées pour l’embellissement de ces jardins, et il ajoute que le grand Mocteuczoma ne pouvait se lasser d’admirer l’innombrable variété des fleurs qu’il ne connaissait pas jusqu’alors, et que l’on avait réunies si curieusement pour charmer ses regards.
Ces beaux jardins ne paraissent pas avoir été destinés au public. L’empereur s’y promenait solitaire. Armé d’une sarbacane d’un prix inestimable, et sur laquelle l’art minutieux des Aztèques avait peint une variété infinie d’animaux, il abattait les oiseaux magnifiques, hôtes paisibles de ces bois improvisés. Il en tirait lui-même ces plumes aux nuances si variées, qu’il obtenait comme un tribut précieux de son vaste empire: espèces monétaires bien fragiles, il est vrai, mais dont on ne pouvait nier l’éclat. Parler de plumes brillantes à propos de jardins, cela peut paraître au premier aspect une sorte d’anomalie: il n’en est rien; les artistes mexicains étaient sans contredit les plus habiles fabricants de fleurs artificielles en plumes qui existassent au monde. Dès le début de la conquête, on fit hommage au Saint-Père de quelques spécimens de l’art charmant qu’ils pratiquaient avec une si rare habileté, et ils trouvèrent des admirateurs passionnés au temps où vivaient encore les Raphaël et les Léonard de Vinci.
Ces petits chefs-d’œuvre n’existent plus. La fragilité de la matière employée pour les composer les a fait disparaître; mais la tradition, qui s’étend longuement sur leur mérite, ne saurait mentir, et les historiens dont nous consultons les descriptions diverses renferment, à propos de ce qu’ils appellent l’Arte plumatoria, les détails les plus curieux. Le grand roi Tezozomoc, nous le supposons du moins, faisait exécuter en plumes les fleurs splendides qu’offraient ses jardins de Huestepec.
Après avoir signalé ici les beaux jardins du roi de Tetzcuco et ceux dont nous venons de parler, nous aurons moins de choses à dire de ceux que fit planter Mocteuczoma à Mexico. Le principal de tous s’élevait sur l’emplacement occupé par l’église San-Francisco, et l’on ne peut pas dire, d’une façon absolue, que tout vestige en ait disparu. Un acebuche (olivier sauvage), qu’un ordre fatal faillit détruire en1811, et dont la végétation est d’une admirable vigueur, est tout ce qui reste des merveilles végétales admirées encore par Cortez.
Ce n’est pas seulement le vainqueur de Mocteuczoma qui vante les jardins de Chapultepec; le chapelain du conquistador, dont on connaît la sincérité parfois dédaigneuse, Gomara ne se refuse point à les considérer comme devant exciter au plus haut degré l’admiration des Européens. Dessinés en partie sur les modèles de ceux de Tetzcuco, les jardins de Tenochtitlan ne renfermaient pas seulement des plantes rares; on y avait établi des ménageries bien supérieures à celles que possédaient l’Espagne et la France. Cortez ne tarit pas dans ses termes pleins d’admiration, lorsqu’il entretient Charles-Quint de ces merveilles, dont une planche grossière de Savorgnano, quasi contemporaine, a transmis les dispositions principales. Il y avait des loges pour les jaguars, les pumas et les ocelots; des cages admirablement disposées, dans lesquelles étaient réunis les plus beaux oiseaux de l’empire, et surtout des aigles majestueux. Des viviers nourrissaient la légion des poissons connus, et les soins les plus minutieux pourvoyaient à la nourriture des diverses espèces; on avait enfin réuni dans des lieux souterrains des serpents énormes et des sauriens gigantesques, qu’on nourrissait avec le sang des victimes recueilli sans trêve au pied des téocallis. Les vainqueurs ne cachent pas l’horreur profonde que leur inspira cette portion des ménageries de Mocteuczoma; et pour en distraire l’esprit du lecteur, ils passent à l’étrange gynécée où l’empereur des Mexicains avait réuni, pour son divertissement, de pauvres créatures appartenant à notre espèce, que la nature avait affligées des monstruosités les plus bizarres. C’était la comédie burlesque à côté des terribles images de l’enfer mexicain.
Parmi les merveilles d’un genre tout à fait nouveau qui attirèrent les regards des Espagnols, il y en avait une que les conquistadors ne se lassaient point d’admirer, la seule, à bien dire, qui ait persisté à travers les siècles, parce qu’elle s’est perpétuée d’elle-même grâce à l’inépuisable fécondité de la nature sous ces climats: nous parlons ici des chinampas, ou jardins flottants.
Les Mexicains avaient imposé eux-mêmes à ces vrais trains chargés de fleurs et de fruits le nom significatif de Terre au milieu des eaux; la nature de la contrée explique leur construction et la perpétuité de leur existence. Les grandes villes baignées par le lac de Tetzcuco s’étaient élevées comme Venise, et comme Venise présentaient aux regards des canaux bordés fréquemment de somptueuses habitations; les chinampas les approvisionnaient chaque jour de légumes, de fruits et surtout de fleurs. Les Mexicains, dont la religion offre à nos yeux tant de barbarié, mêlaient toujours les fleurs à leur culte et en faisaient un perpétuel échange avec leurs dieux. Les jardins flottants du lac les apportaient jusqu’au pied des autels.
SERPENTS DE TENOCHTITLAN.
Au dire des vieux historiens, les antiques chinampas n’avaient pas eu une origine aussi poétique que celle qui leur était accordée par certains écrivains: ils étaient nés de la famine et de la guerre. Selon Clavigero, les jardins flottants remontaient au commencement du quatorzième siècle. A cette époque, on le sait, les peuples de Colhuas et les Tepanèques avaient triomphé des Mexicains proprement dits. Ceux-ci, après une défense énergique, n’avaient conservé de libre que Tenochtitlan et les alentours du lac sur lequel elle a été bâtie. Il fallait vivre: les Aztèques trouvèrent dans les plantes aquatiques qui croissaient en abondance sur les rives du lac les matériaux de ces champs légers, formés d’une terre noire, substantielle et abondante; on planta sur ces plateaux verdoyants, qu’un ou deux rameurs entraînaient loin des rives, du maïs, des racines nutritives, de simples légumes enfin. Le vieil historien fait observer que ces chinampas primitifs étaient fortifiés de broussailles. Les cultures mouvantes, se multiplièrent, et les habitants de Mexico se virent sauvés ainsi de la famine. Plus tard, les chinampas furent conservés; mais on les couvrit de fleurs variées et de plantes odoriférantes. Il y a un siècle environ, on voyait encore de ces radeaux fleuris, du sein desquels sortait un arbre dont l’ombre pouvait garantir l’horticulteur de l’ardeur du soleil; sur quelques autres de ces jardins une sorte de cabane rustique remplissait le même office.
La tradition s’est perpétuée, mais seulement parmi les Indiens, Ces lits de glaïeuls couverts d’une terre fertile, qui se promenaient sur le lac, s’y promènent encore. C’est même, à Mexico, à peu près tout ce qui reste aujourd’hui d’une civilisation originale dont les vestiges se sont de plus en plus altérés. Seulement, au lieu d’apporter leurs beaux fruits et leur tribut de fleurs devant les téocallis, où des milliers d’hommes sacrifiés faisaient comme un tapis de pourpre à ces pyramides tronquées destinées à de si épouvantables sacrifices, ils approvisionnent les ménagères de Mexico de légumes excellents et de fleurs parfumées.
C’est surtout à Santa-Anita, à Ixtacalco, jolis villages situés sur le lac à peu de distance de la capitale du Mexique, que les chinampas se parent de leurs plus belles fleurs. Ixtacalco signifie, dans la langue des Aztèques, la Maison blanche. Cette bourgade montre, en effet, ses riantes habitations à l’origine du grand canal par lequel la lagune de Chalco mêle ses eaux à celles du lac. Santa-Anita n’est pas non plus bien loin de là. La population, aisée et laborieuse, de ces deux petites localités se compose exclusivement d’Indiens. Et l’on peut dire que ces braves gens sont aujourd’hui à peu près ce qu’ils étaient au temps de la conquête. Quelques-unes des maisonnettes où ils trouvent le repos sont construites en adobes ou briques séchées au soleil; d’autres, plus simples encore, en canizos ou joncs d’une immense venue; il y en a très-peu qui soient en pierres. Tous les habitants sont propriétaires, mais propriétaires de petits lots de terre destinés à flotter sur le lac. Le support primitif de ces jardins que l’homme promène à son gré dans toutes les directions, est l’objet d’un assez long travail.
Avant de planter des fleurs, il faut créer le solide radeau qui doit supporter le sol par l’adjonction successive de glaïeuls ou de roseaux; la terre végétale n’est apportée que beaucoup plus tard sur ce train verdoyant. Les chinampas portent un nom quasi mexicain, fort altéré par la prononciation espagnole, et qui se composait originairement de deux mots aztèques: tlali-ompaatl, dont la réunion signifie «terre dans l’eau».
Les chinampas ne sont pas seulement de brillante parterres; comme nous-venons de le dire, on y fait venir des légumes, et ces cultures utiles peuvent être transportées facilement, pour l’agrément des consommateurs, d’un lieu à un autre; le canal en est parfois couvert.
A une certaine époque de l’année, rien n’est plus pittoresque que Santa-Anita et Ixtacalco, se mirant dans le canal et environnés de ces jolis jardins flottants. Si les horticulteurs indiens les parent à l’envi de nos roses et de nos œillets d’Europe, ils n’ont pas oublié ces violettes amaporas, ces beaux chicharos dont les parfums emportent leurs souvenirs vers d’autres temps et excitent parfois leurs sombres regrets. Il faut lire les vieilles relations originales des chroniqueurs espagnols, pour se faire une idée de la prodigieuse quantité de fleurs réclamée par le culte sanguinaire des dieux mexicains. Il y avait dans le Panthéon mexicain un dieu du sang; mais il y avait aussi une déesse des fleurs.
Les chinampas chargés de verdure et de fruits font vivre les deux villages désignés ici, et probablement plusieurs hameaux de leur voisinage. Il faut de la vigueur, mais peu d’industrie, pour les promener sur la surface du lac. Un bon câble solidement tressé, un petit canot pourvu de quelques rameurs, voilà ce qui donne la locomotion indispensable à ces jardins flottants. On sème et l’on récolte en toute saison à peu près sur cette, terre humide, fécondée par le soleil, qu’on adorait jadis à Mexico sous un nom barbare.
Il y a un moment toutefois où les petits champs fleuris des chinampas se flétrissent, et ne parfument plus les rives qu’ils côtoient. C’est à l’époque où commence chez nous le printemps, et au moment ou la semaine sainte amène avec elle ses austérités. Alors le canal de la Viga se couvre de chaloupes et même de simples pirogues remplies d’admirables végétaux; la moisson a été faite autre part. En cette saison les chinampas n’offrent plus qu’une surface désolée; mais peu de jours suffisent pour qu’ils verdoient de nouveau et pour que les fleurs montrent leurs corolles variées. Il y en a encore pour plusieurs mois, et une somme de douze mille pesos au moins vient rémunérer les efforts des laborieux horticulteurs. L’usage veut qu’à un certain moment de l’année on aille admirer sur place les jolis jardins d’Anita et d’Ixtacalco; c’est une partie de plaisir pour les bourgeois de Mexico.
Si nous remettons le pied sur le continent, ce sera pour dire un mot de Tacubaya, tout auprès de Mexico, où il y eût jadis quelques splendides jardins. Là, au milieu d’un bouquet de bois, on vous fait voir la fontaine de la Reine: c’est un tout petit lac, de l’eau la plus limpide. On l’appelle l’Alberca.
Au temps jadis, dit la légende, la Malincheallait s’y baigner avec ses dames, parées comme elle dè longs vêtements blancs. Or, un jour, la belle reine des Aztèques fut surprise par des chasseurs; elle n’avait pas alors sa robe d’un tissu précieux. Confuse, elle n’hésita pas; elle prit sa course et se précipita dans la claire fontaine, à l’endroit même où les eaux s’agitent en tourbillonnant. Jamais depuis la Malinche n’est apparue aux yeux des mortels; mais tous les jours, à l’heure de midi, l’heure à laquelle la belle reine se baignait, les gens clairvoyants voient apparaître au-dessus du remous un tecomatl peint d’or et de vermillon. C’est l’élégante coiffure de la reine mexicaine surprise, il y a des siècles, par les chasseurs. Le demi-globe si richement orné ne bondit qu’un moment au-dessus des flots, il montre aux mortels la place qu’habite dans son palais de cristal la Malinche; mais il disparaît comme l’éclair, si un regard profane cherche à le suivre dans ses mouvements capricieux. La légende indienne de l’Alberca remonte à des temps bien antérieurs à ceux de la conquête. Malinche était aussi le surnom indien de la belle Marina, l’interprète et la compagne de Cortez.
La ville péruvienne de Jauja, singulièrement déchue aujourd’hui de son antique magnificence, mais construite fort régulièrement, tirait jadis sa renommée des fameux vergers de l’Inca, qu’on pouvait appeler les jardins aux fleurs d’or; mais il est inutile d’ajouter qu’il n’en reste plus aucun vestige. Il ne paraît pas, du reste, que cette cité, capitale d’une province étendue, ait rien dans son voisinage immédiat qui constate l’abondance des produits du règne minéral, bien qu’on signale ceux du Quero. Jauja, traversé par un petit fleuve, pour ainsi dire inutile aux habitants, en raison des profondeurs escarpées de ses rives, est une ville régulière, dont les rues sont coupées à angle droit, et la principale d’entre elles n’a pas moins de vingt-deux mètres de largeur.
JARDINS FLOTTANTS AU MEXIQUE
Une circonstance physique notée par M. Paz Soldan pourrait peut-être expliquer la nature des plantations métalliques de ces singuliers jardins. L’eau manque à Jauja pour subvenir aux arrosements, et toutes les plantations attendent pour prospérer des pluies bienfaisantes, toujours fort rares en ces contrées. Peut-être les Incas s’étaient-ils fait un jeu, au moyen du métal qu’ils savaient travailler en perfection, mais qui était sans grande valeur à leurs yeux, de réunir les fleurs, les fruits et même les animaux dont ils prétendaient garder les spécimens durables, dans un lieu qui leur servait parfois de résidence. Malgré les anfractuosités des terrains adjacents, il est question aujourd’hui d’ouvrir une voie ferrée entre Jauja et Lima. Il serait vraiment curieux que les fouilles nécessitées par ce travail permissent de retrouver quelques-uns de ces grands quadrupèdes en or, dont les Incas ornaient leurs jardins. Les vieilles traditions nous parlent d’un troupeau de lamas avec leur toison métallique, que semblait diriger un berger en or. Mille plantes éclatantes, dit la légende, étaient là, en apparence, pour la nourriture de ces brillants animaux. Soyons certains que ces lamas, évanouis depuis des siècles, n’étaient point, en tous les cas, fabriqués en or massif. Admirables fondeurs, orfèvres non moins habiles, les Péruviens savaient parfaitement ménager un métal dont ils ne se servaient pas comme monnaie, mais qu’ils ne se procuraient pas sans peine, et ils étaient d’ailleurs parvenus à réaliser de vraies merveilles en ce genre par la fonte. Les orfévres de François Ier eurent lieu de s’en apercevoir lorsqu’on transporta à Fontainebleau les vases énormes qu’un de nos hardis corsaires, Jean Florin, avait pris en mer sur les Espagnols, et qu’il apporta au roi.
Si Francisco Pizarre ne savait même pas signer son nom, l’armée qu’il commandait avec une résolution digne d’un grand capitaine n’était certes pas composée de gens fort lettrés. A l’exception des deux frères du conquistador, Diego et Fernand, auxquels il faut joindre Cieça de Léon, qui écrivit le récit de la conquête, puis d’un certain Mora, sorte d’artiste-soldat, dont le crayon sut esquisser, dit-on, les traits d’Atahualpa, il ne se trouvait parmi cette poignée de gens résolus aucun individu capable en réalité de décrire un seul des monuments et des jardins de l’empereur du Pérou. L’or employé en guise d’autre métal dans la construction des temples, et parfois dans une certaine ornementation bizarre des vases sacrés, à laquelle il fallait ajouter surtout l’habileté merveilleuse de la fonte, les éblouissait par-dessus tout. Cette circonstance, selon nous, doit suffire pour expliquer aujourd’hui les récits de magnificence exagérés qui commencèrent à circuler en Europe, et qui donnèrent lieu à la locution proverbiale connue de tout le monde. Il en fut sans doute des jardins splendides de l’Inca comme de tout le reste. Il est avéré néanmoins qu’un enclos magnifique, attenant à la demeure du souverain à Jauja, renfermait les plus étranges spécimens de ses incalculables richesses. Le descendant des souverains du Pérou, Garcilaso de la Vega, dont le témoignage n’est jamais exempt d’exagération, se présente parmi les historiens de la conquête comme l’un des premiers qui nous aient transmis la description de ces fameux jardins. Ce récit, en lui-même, pourrait être assimilé aux mille légendes créées par la conquête, s’il n’était confirmé par le témoignage moins suspect d’un témoin oculaire. Francisco Xérès, le propre secrétaire de Pizarre, qu’on n’accusera certes pas, dans sa naïve sécheresse, de s’être abandonné aux écarts d’une imagination trop vivement frappée, nous apprend que parmi les nombreux spécimens d’objets métalliques livrés immédiatement au creuset, il y en avait un grand nombre qui excédaient par leurs dimensions tout ce que l’ancien monde connaissait d’extraordinaire en ce genre. Il ajoute: «Suivant les rapports d’Atabalipa, de Chilicuchima et de bien d’autres personnes, ce prince avait à Jauja des moutonset des bergers tout en or, et ces moutons ainsi que ces bergers étaient de grandeur naturelle; ces objets appartenaient à son père, et il promit de les donner aux Espagnols.»
En offrant ici une représentation des jardins de l’Inca, nous n’avons nullement prétendu ajouter une fiction à des récits purement légendaires. L’histoire naturelle a ses rêves innocents, et l’archéologie a ses licences. Il est permis à tout architecte qui vient d’examiner les vestiges confus d’un monument célèbre d’en essayer la restitution; c’est un jeu de l’art que nous avons tenté dans la planche qu’on a sous les yeux. Disons-le d’ailleurs, sans l’œuvre à laquelle ont pris part un archéologue et un naturaliste célèbres, la restitution des jardins de l’Inca n’eût pu être essayée. Nous sommes loin, sans doute, de l’époque où l’art rudimentaire des Péruviens se révélait en sculpture, dans ses grandes dimensions, pour peu que l’œuvre fût d’un métal précieux; les statues péruviennes qui ornent le musée de Lima, celles que l’on voit encore à Paris, au musée ethnographique du Louvre, sont en assez grand nombre pour donner une idée de ce que devaient être, au milieu des végétaux pittoresques de la montagne, les effigies métalliques qui brillaient dans les jardins de l’Inca.
Ce qui se passait dans la région montueuse de Jauja, où les métaux sont si abondants, avait lieu durant le même siècle au sein de la fertile vallée de Mexico, où l’or n’était certes pas répandu avec autant de profusion. Le Salomon mexicain, dont nous avons déjà révélé au lecteur les magnificences horticoles, avait dressé non loin de ses véritables jardins des compartiments ingénieusement distribués, où brillaient, fondus en or pur, les plantes rares, les fleurs remarquables par leur beauté, les animaux même qui erraient dans les contrées reculées de l’empire, ou qu’on voyait rarement dans la vallée de Mexico. L’ensemble formait une sorte de muséum d’histoire naturelle en plein air, propre aux études des savants de Tetzcuco. A ce point de vue les jardins d’or du roi Netzahuatlcoyotzin avaient un but d’utilité publique, qu’il est superflu de faire ressortir. Les jardins construits à Jauja par le père d’Atahualpa étaient, au contraire, des jardins de pur agrément, constatant l’habileté des artistes péruviens. Pour jouir de plus frais ombrages, c’était à Jucay, bourgade de cent cinquante à deux cents habitants, que les Incas allaient se reposer du fardeau de leur gouvernement. Le palais de ces souverains, qui n’avait rien d’imposant, mais d’où les yeux se portaient sur un paysage magnifique, s’élevait à peu de distance des rives fertiles du Vilcamayu. On en voit encore les ruines. Deux places immenses, environnées d’arbres gigantesques qui s’élèvent à quarante mètres de hauteur, indiquent de quelle beauté furent les vrais jardins des souverains du Pérou. De là on se rend à Urubamba, où sont encore les plus délicieux jardins de la contrée; ils sont situés pour la plupart dans la Quebrada, où les accidents de terrain offrent des points de vue admirables. Ajoutons à tous ces détails, qu’il ne faut chercher ni au Mexique ni au Pérou les traces d’une horticulture soignée, nous reportant aux temps antérieurs à la conquête. Il est certain que les deux grandes places de Jucay offrent encore des arbres immenses présentant dans leur vigueur tous les signes de leur antiquité; mais l’imagination seule peut reconstruire, sous leurs ombrages magnifiques, les méandres fleuris qui les entouraient. On ne saurait faire revivre une civilisation dont les derniers vestiges n’apparaissent plus qu’immobilisés dans le granit ou dans la pierre.