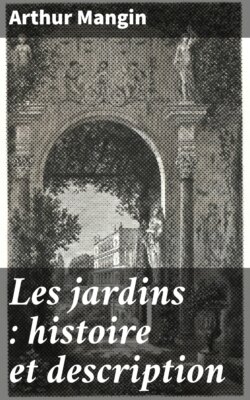Читать книгу Les jardins : histoire et description - Arthur Mangin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE IV
LES JARDINS PRIMITIFS–JARDINS ANCIENS DE LA CHINE ET DE L’INDE
Table des matières
LORSQUE, négligeant dans l’histoire les événements superficiels et bruyants qui captivent seuls l’attention du vulgaire, on étudie les phénomènes plus profonds et plus intimes de la vie sociale des peuples; lorsqu’on examine et que l’on compare les di verses manifestations de leur activité morale et intellectuelle, œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, édifices et constructions, costumes, armes, institutions, entreprises militaires, industrielles ou commerciales, on ne tarde pas à se convaincre que tous ces actes d’une même individualité collective ont entre eux certains caractères fondamentaux communs, et portent comme une empreinte indélébile du génie qui les a produits.
Cette solidarité, que la théorie indique à priori et que l’observation confirme, est d’un précieux secours pour les difficiles recherches de l’historien philosophe; elle peut être justement comparée à la corrélation constante que l’anatomie et la physiologie ont reconnue entre les diverses parties des êtres organisés. Qu’un naturaliste retrouve dans le sol quelques ossements d’un animal dont l’espèce a disparu de la surface du globe depuis des milliers d’années: il pourra dire à quelle classe, à quel ordre, à quelle famille, à quel genre appartenait cet animal; quels étaient son habitat, son mode de locomotion, son régime alimentaire; s’il était aérien, terrestre ou aquatique, marcheur ou grimpeur, carnassier ou herbivore; il pourra décrire la structure, non-seulement du squelette complet, mais du corps même auquel ce squelette servait de charpente. De même, avec les débris épars d’une civilisation éteinte, l’érudit habitué à interroger les ruines du passé peut restituer cette civilisation, la faire revivre dans son intégrité. La tâche devient accessible à tout esprit attentif et réfléchi et n’exige pas une science vaste et profonde, lorsqu’il s’agit seulement de combler, à l’aide de l’analogie et de l’induction, les lacunes que peut offrir le tableau, d’ailleurs bien connu, des grandes civilisations.
Ainsi, encore bien que les écrits des auteurs anciens ne nous apprennent pas directement de quelle manière l’art des jardins fut pratiqué par les principaux peuples de l’antiquité, et bien que les jardins n’aient pu nulle part se conserver à travers les siècles comme beaucoup de monuments de marbre, de granit ou de briques, il n’est pas impossible de remonter à l’origine probable de cet art, d’en suivre les évolutions et d’indiquer les formes les plus caractéristiques de son développement au sein des sociétés anciennes.
Et d’abord, si nous recherchons le principe, la cause génératrice de l’art des jardins, nous apercevons sans peine qu’il procède à la fois de deux sentiments, de deux besoins auxquels se rattachent également les plus importantes créations de l’esprit humain. Ce sont: la notion et l’amour du beau (qui ne sont qu’une seule et même chose, puisqu’on ne saurait aimer le beau sans le connaitre, ni le cnnnaîfee sus l’aimer), et le sentiment ou le besoin du bien-être: c’est tout un encore. La création des jardins suppose donc préalablement chez l’homme l’éclosion du sens esthétique, l’intelligence des beautés et, si l’on pouvait ainsi dire, des bontés ou des utilités de la nature. Elle suppose en outre une demeure fixe, de la sécurité, de l’aisance, des loisirs: autant d’avantages qui ne peuvent se trouver que dans un état social déjà perfectionné. Elle suppose enfin des connaissances de quelque étendue en botanique, des rudiments de l’art du dessin et de l’architecture, Donc, point de jardins chez les peuples plongés dans l’ignorance et la barbarie, ni même chez ceux qui sont encore adonnés à la vie nomade et pastorale. Cela se voit fort bien à notre époque, où tous les degrés de la barbarie et de la civilisation sont encore représentés dans les diverses parties du monde. Les sauvages de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Océanie, n’ont point de jardins, non plus que les Kirghiz et les Mongols des steppes, non plus que les Arabes du désert.
UNE OASIS DU SAHARA.
Les jardins n’apparaissent que là où les hommes ont déjà formé des agglomérations sédentaires, bâti des villages et appris à cultiver le sol. A ce point de vue, on peut dire avec Delille qu’ils sont le luxe de l’agriculture. Les oasis du Sahara nous offrent aujourd’hui le spécimen des jardins primitifs, où l’utile encore domine l’agréable, et qui sont plutôt des potagers ou des vergers que des jardins d’agrément. La composition et la culture sont commandées par le climat, par la nature du sol et de ses productions; mais le caractère est uniforme comme celui de toutes les œuvres rudimentaires de l’homme. Les types ne se dessinent que plus tard, sous les influences combinées des causes physiques inhérentes à chaque contrée, et du génie propre à chaque race et à chaque peuple.
On s’accorde généralement à considérer l’Asie comme le berceau des sciences et des arts, et la civilisation paraît avoir fait d’abord de très-rapides progrès dans l’extrême Orient et dans l’Asie méridionale. Il est certain que plus de deux mille six cents ans avant l’ère chrétienne, alors que tout l’univers était encore plongé dans la barbarie, les Chinois étaient déjà parvenus, sous l’empereur Koang-Ti, à un état social régulièrement organisé; que le peuple était divisé en castes, et l’empire en provinces; qu’ils avaient des villes, des tribunaux, des écoles; qu’ils pratiquaient l’agriculture et la navigation; qu’ils construisaient des routes et creusaient des canaux.
Il serait peu intéressant de rechercher ce que furent à cette époque reculée les jardins chinois. Nous verrons plus loin ce qu’ils sont de nos jours. Or on sait que la mobilité est le moindre défaut des peuples du Céleste-Empire, et que, depuis une longue suite de siècles, les arts, l’industrie, la science n’ont accompli chez eux que des progrès insignifiants. Il est donc très-plausible d’admettre que leurs jardins n’ont pas plus changé que leurs palais, leurs maisons, leurs costumes et le reste, et que l’origine du style chinois, tel qu’on le connaît présentement, est contemporaine des commencements mêmes de leur civilisation.
Si la civilisation chinoise est restée stationnaire, elle s’est du moins maintenue, grâce à la force d’inertie, à la ténacité singulière qui, à défaut d’autres vertus, distingue cette race étrange. Il n’en est point de même des autres civilisations orientales. L’Inde et l’Indo-Chine, la Perse, l’Asie Mineure, l’Égypte, n’offrent plus que les lambeaux ou les ruines des grands empires dont la puissance et la splendeur étonnaient autrefois l’univers. Ces empires ont succombé, les uns sous les coups des barbares envahisseurs; les autres sous les armes des nations intelligentes de l’Occident; d’autres seulement aux atteintes profondes de ces maladies sociales dont tous étaient plus ou moins infectés, et qu’on nomme la servitude, la paresse, l’ignorance, la superstition et l’immoralité. On sait que dans toutes leurs conceptions, dans toutes leurs œuvres, les Orientaux visent au grandiose, ou plutôt au gigantesque; qu’ils cherchent à éblouir, que dis-je? à s’éblouir eux-mêmes. Ces tendances ont donné de tout temps à leurs monuments un caractère facile à reconnaître, et qui n’a guère varié tant que les arts ont été florissants en Asie et en Égypte. On connaît, d’autre part, l’indolence et la sensualité proverbiales de ces peuples. Ces éléments, joints à ceux qui sont donnés par la nature au sein de laquelle les arts ont pris naissance et se sont développés, permettent de suppléer à la pénurie des renseignements relatifs aux anciens jardins de l’Orient, dont il ne reste aujourd’hui que peu de vestiges.
Dans ces contrées, où les richesses, ainsi que le pouvoir, étaient concentrées aux mains de tyrans absolus; où le faste tenait lieu d’élégance; où l’accumulation des objets précieux était la suprême expression de la magnificence; où des troupeaux d’esclaves étaient employés à travailler pour quelques maîtres orgueilleux et débauchés, les ardins devaient être rares, mais vastes et somptueux; ils devaient étonner par leur faste, plutôt que charmer par leur beauté. Nous avons dans la peinture du paradis de Mahomet, que j’ai reproduite précédemment, l’idéal d’un jardin tel que peuvent le concevoir des hommes à imagination puissante, avides de voluptés excessives, et aspirant, sous les feux du soleil, à la fraîcheur des ombrages verts et des fontaines parfumées. On conçoit que, dans leurs créations en ce genre, les Orientaux se soient efforcés de réaliser ces délices surnaturelles, de se donner, en attendant le paradis céleste, des paradis terrestres, et d’y réunir autant qu’il était en eux toutes les jouissances qui constituent à leurs yeux le bonheur parfait.
C’est sans doute aux empereurs, aux khans, aux rajahs de l’Indoustan qu’il fut donné d’approcher le plus de l’idéal rêvé. Ils avaient à leur disposition toutes les richesses minérales et végétales de leur admirable pays. Pour bâtir et décorer des palais, des vérandahs, des pavillons, des terrasses, des péristyles, ils avaient le granit, le marbre, le porphyre, le jade, la malachite, les bois de teck, de fer, de santal; pour former des bosquets, des allées, des massifs, des berceaux, ils avaient d’innombrables plantes au port majestueux, au feuillage élégant et toujours vert, aux fleurs magnifiques et parfumées, à l’écorce aromatique; pour remplir les bassins, pour arroser le sol, pour rafraîchir et embaumer l’air, ils avaient les eaux des fleuves sacrés, qu’ils pouvaient charger des senteurs du musc, de l’ambre, du benjoin et des essences; pour peupler et animer leurs jardins, ils avaient les charmantes gazelles, les chèvres du Tibet, les singes agiles, objet de leur vénération, et des légions d’oiseaux au plumage éclatant, au ramage mélodieux. On voit encore à Delhi les ruines des jardins du grand Mogol, plantés d’orangers séculaires, ornés de kiosques, de terrasses et d’escaliers de marbre, et de bassins aujourd’hui envahis par la mousse et par les herbes sauvages, d’où s’élançaient autrefois des jets d’eau parfumée.
JARDINS DU GRAND MOGOL.