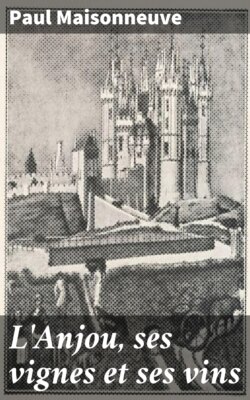Читать книгу L'Anjou, ses vignes et ses vins - Paul Maisonneuve - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. ARRONDISSEMENTS D’ANGERS ET DE BAUGÉ
ОглавлениеTable des matières
Ier siècle. — On peut assurer, en s’appuyant sur les documents du chapitre précédent, que dès le premier siècle de l’ère chrétienne la vigne existait en Anjou.
IVe siècle. — Saint Martin, au commencement du IVe siècle, évangélise notre région et y propage la vigne. Son souvenir est resté si populaire dans le monde des vignerons, que le 11 novembre, jour de sa fête, fut choisi par tout le royaume pour célébrer la fête de la vendange.
VIe siècle. — Nous avons des documents qui établissent qu’au temps de Childebert Ier, elle florissait sur les bords de la Loire. Témoin ces vers du poète Apollonius:
Est juxta œquores urbs durâ in rupe Britannos,
Et Ceresis dives et Bacchi munere plena,
Andecavi greco sumens a nomine nomen .
Le premier document authentique que nous possédions remonte à l’an 515 et se trouve dans ce qu’on a appelé les Formules Angevines, sorte de protocole de notaire, dans lequel on trouve un modèle relatif à la vente des vignes.
Grégoire de Tours parle des vignes déjà très étendues dans notre contrée et de petits instruments bruyants alors en usage pour en chasser les oiseaux, sans doute les étourneaux, qui dévoraient les vendanges.
Les Cartulaires des Abbayes ont conservé le souvenir des nombreux dons ou transactions dont les vignes ont été l’objet au moyen âge. Evidemment les mêmes opérations devaient avoir cours entre les particuliers; mais les documents que nous possédons à leur sujet sont bien plus rares.
D’ailleurs, tout monastère possédait son clos de vigne. Le noble arbuste a toujours eu, en quelque sorte, un caractère sacré, qu’il doit sans doute à l’usage auquel sert son produit dans les plus augustes cérémonies du culte catholique et aux allusions qu’y font fréquemment les auteurs sacrés, les hommes justes étant comparés à des grappes superbes et bien mûres, les mauvais au fruit acerbe de la vigne sauvage (ISAÏE).
VIIIe siècle. — Au mois de mai 769, Charlemagne confirma le don fait par son père Pépin-le-Bref à l’Abbaye de Saint-Aubin (actuellement la préfecture d’Angers), d’une vigne située auprès du monastère.
IXe siècle. — Le 1er mars 839, Rorgon donne à l’Abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil des vignes situées dans les «vigneries» de Mazé.
Charles-le-Chauve (1er août 847) fait don à l’Abbaye de Saint-Aubin d’Angers, de vignes situées à Seiches.
En 850, le seigneur Saucon cède à Dodon, évêque d’Angers, l’alleu de Brionneau avec ses vignes.
Charles-le-Chauve donne (13 février 874) au Chapitre de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Lezin d’Angers la villa de Blaison avec ses vignes.
Xe siècle. — Allain III le Grand, roi de Bretagne, donne à l’évêque d’Angers l’Abbaye de Saint-Serge avec ses vignes.
Néfingue, évêque d’Angers (966), restitue à l’Abbaye de Saint-Aubin un arpent et demi de vigne sis dans la banlieue d’Angers.
La comtesse Adèle, la grande bienfaitrice de l’Abbaye Saint-Aubin, fait don, à ce monastère, de l’ «Isle du Mont», appelée depuis lors l’île Saint-Aubin, et de cinq arpents de vignes.
XIe siècle. — Foulques Nerra, comte d’Anjou (1022), donne à l’Abbaye Saint-Nicolas-lès-Angers, qu’il avait fondée deux ans auparavant, des vignes au bord de Brionneau, une autre entre la Maine et Brionneau, l’exemption du «banvin» en deçà du ruisseau de la Barre.
Fondation de l’Abbaye du Ronceray (emplacement actuel de l’Ecole des Arts et Métiers) par le même, qui lui fait don de quarante arpents de vigne, situés près du monastère (14 juillet 1028).
Des vignes importantes étaient, à la même époque, cultivées à Pouillé, sur le territoire des Ponts-de-Cé : «In Saiaco, inter viam publicam, quœ ducit ad Andecavem civitatem et vineas de Poliaco .
Geoffroy Martel, comte d’Anjou, donne à l’Abbaye de Vendôme (31 mai 1040), le monastère de Saint-Sauveur (actuellement Lesvière) avec ses vingt arpents de vigne, l’église Saint-Jean-sur-Loire de Saint-Rémy-la-Varenne, avec ses trente arpents de vignes, et la même année encore, à l’Abbaye de Vendôme, l’église de Saint-Saturnin avec les vignes qui se trouvent dans cette localité.
Vers 1040, Geoffroy Martel échange avec l’Abbaye du Ronceray une terre sise à l’Anglée (Frémur), pour en faire une plantation de vignes de Bordeaux .
Il abandonne à l’église Toussaint (vers 1044), le jour de sa dédicace par l’évêque d’Angers, le vinage de sept arpents de vigne.
Il confirme vers 1055 aux chanoines de la chapelle Sainte-Geneviève, où était conservé le corps de Saint Laud, le don de vignes à Epluchard, Lesvière, Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Hugues de Saint-Laud donne au Chapitre de la Cathédrale un arpent de vigne à Chanzé (La Baumette).
Vers 1090 l’Abbaye de Saint-Aubin achète des vignes à Pruniers, et le Chapitre de la Cathédrale cède à l’Abbaye de Saint-Serge ses vignes de Monriou (Feneu).
Vers 1100, Raimbert donne à l’Abbaye Saint-Aubin un quartier de vigne situé à Saint-Rémy-la-Varenne.
A la même époque, l’Abbaye Saint-Aubin fait don au sénéchal du comte d’Anjou de trois arpents de vigne situés à Angers.
XIIe siècle. — Un accord est conclu entre l’Abbaye de Fontevrault et le Chapitre Saint-Laud d’Angers (28 juin 1116), en vertu duquel Saint-Laud conservera la dîme de la Pignonnière, à Saint-Barthélémy, sauf des vignes appartenant en propre à Fontevrault en cet endroit.
En 1120, l’Abbaye de Saint-Serge achète au prix de quarante sols un arpent de vigne pour son prieuré de Saint-Melaine.
Vers 1135, Guillaume Boucher donne aux chanoines de la Cathédrale un arpent de vigne situé aux Jonchères (Angers).
A la même époque, Béatrice donne au Chapitre de la Cathédrale la dîme d’un arpent et demi de vigne qu’elle possède au Plessis-Grammoire.
Le comte d’Anjou accorde à l’Abbaye du Ronceray (14 février 1141) des vignes situées au lieu dit Chef-de-Ville.
Aigrefoin (commune de Brain-sur-l’Authion), fut le premier beau domaine de vignes de l’Hôtel-Dieu d’Angers, qui y tenait plusieurs pressoirs à ban .
Comme on le voit par cette énumération, longue, quoique incomplète, Angers et ses environs étaient déjà, à cette époque reculée, abondamment pourvus de vignes. Voici, d’ailleurs, un document du temps qui vient confirmer ce dire.
Un auteur anglais, Raoul de Diceto, doyen de Londres, décrit la ville d’Angers en 1149 et dit: Vers le nord et le levant (sans doute sur l’emplacement actuel du château) s’élève un vaste bâtiment qui serait digne de porter le nom de palais; de là la vue s’étend sur le cours de la rivière et sur les coteaux consacrés à la culture de la vigne .
Vers 1175 le Chapitre de Saint-Laud concède au prieuré de Saint-Gilles-du-Verger (actuellement Ecole Régionale des Beaux-Arts), un arpent de vigne sis au fief de Verrières, près Angers.
Guillaume Le Breton, chapelain de Philippe-Auguste, fait, dans un poème latin consacré à la gloire du roi, cet éloge de la ville d’Angers: «A peine peut-on trouver ailleurs une ville plus riche et mieux décorée, plus abondante en dons de Bacchus. De tous côtés ce ne sont que champs couverts de vignes qui fournissent à boire aux Normands et aux Bretons, si bien que les possesseurs de ces terres ne manquent jamais d’argent.»
En 1231, le Chapitre de Saint-Maurille d’Angers concède aux Cordeliers une portion de terrain planté en vigne pour y construire une église (rue des Cordeliers).
XVe siècle. — En pleine ville d’Angers on cultivait encore d’assez grands morceaux de vigne. Dans un bail à vente du château de Grohan, daté de 1415, on parle de biens de religieux du Loroux, «citués en Hannelou, près d’Angers, contenant le tout quatre arpents, que vignes, que terres et jardins». Et dans une déclaration d’héritages appartenant aux mêmes religieux, en 1425, on lit: «Le hébergement et appartenances ancien appellé chasteau Grohan, sis en Hanneleu, joignant la rue par laquelle on vait à Saint-Lienart (Saint-Léonard), d’une part,..... demeurant en la rue de Bréchigne (Bressigny), d’autres contenant celles appartenances troys arpents, que vignes, que courtilz ou environs.»
A cette époque les vignes constituaient une partie importante des établissements religieux ou de bienfaisance, par suite de dons successivement reçus. C’est ainsi que l’hôpital Saint-Jean d’Angers possédait 8 quartiers de vigne à Morin (Bouchemaine), 18 aux Fouacières et à la Papillaie (Angers), 8 à Challay, 20 à Piré, 8 à Frémur, 20 à Pigeon, 8 au Pressoir Cornu, 20 à l’Oisonnière, 14 à la Tartentière (Plessis-Grammoire), 54 à Aigrefoin, 4 à Cullay (Tiercé), 12 à Prézaye (Jarzé), 14 à Fontaine-Bresson (Vernantes), soit au total 208 quartiers.
Une partie de la récolte de ce vaste vignoble était débitée par privilège de banvin , dans la maison des Tuffeaux, rue Saint-Nicolas, par un commis ayant reçu un mandat spécial et son bénéfice réglé.
Dans le même temps, Jean Bourré, ce grand bâtisseur de maisons seigneuriales, l’habile compère de Louis XI, s’intéressait vivement, au milieu de ses vastes entreprises, au vin blanc qu’il récoltait sur sa propriété de Vaulx, en la paroisse de Miré, et il écrivait à son intendant: «Gardez-le moi bien à quant je yré par de là, et gardez qu’il n’en soit point tyré, et le faictes bonder et abiller, qu’il n’y ayt point de vent; si d’adventure il n’en a besoingt, par un petit pertuis empress le bondin.»
«Escript au Plessis-Bourré, ce dimanche dernier jour d’octobre (vers 1483 au 1485). Signé : BOURRÉ.»
XVIe siècle. — Dans la ville d’Angers, écrit Claude Ménard (1537), au faubourg Bressigné se trouve une hôtellerie qui a pour enseigne la Côte de Baleine, et près le jardin, dans le milieu d’une vigne une place ovale.....»
De nombreux documents de ce genre établissent l’existence de fréquentes transactions analogues aux précédentes dans le canton de Baugé, où nous voyons les seigneurs et les bourgeois donner, du XIe au XVIIe siècle, des vignes situées sur les paroisses de Jarzé, Chartrené, Seiches, Brion, Chaumont, Vernoil-le-Fourrier, etc.
En 1571, le curé de Fontaine-Milon écrit dans son registre paroissial: «Fontaine-Milon, bonne ville de renom, où il croît de bon vin; Dieu y en veuille toujours amener ainsi!»
François Réchin, avocat à Montpellier, écrit dans son Histoire de l’Anjou, 1537: «De tout temps et encore aujourd’hui le vignoble de l’Anjou excelle sur celui de son voisinage; en ses coteaux plantés de vignes..... il porte des vins blancs dont la réputation est allée fort loin.»
Et en ce même XVIe siècle, un poète bordelais, Pierre de Brack, dans une hymne à Bacchus, parle avec éloge du vin d’Anjou, qu’il appelle l’Angevin falernois.