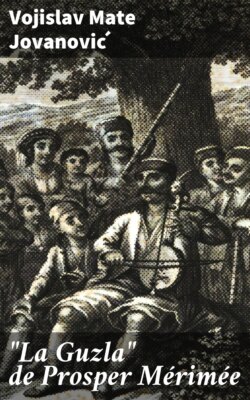Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES VOYAGES DE FORTIS
ОглавлениеL'abbé Albert Fortis[33], membre de plusieurs académies italiennes et étrangères, que l'on nomme aujourd'hui encore «il primo naturalista d'Italia et uno dei primi d'Europa», publia à Venise, en 1771, son Saggio d'Osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero (pp. 169, in-4°). Ce livre était le fruit d'une excursion scientifique faite au mois de mai 1770, en compagnie de John Symonds, professeur d'histoire moderne à l'Université de Cambridge, aux côtes et aux îles dalmates[34].
À la fin de son savant ouvrage, après avoir apporté quantité de documents nouveaux, concernant l'archéologie et l'histoire naturelle, l'abbé Fortis publia une lettre adressée à son compagnon anglais; il y parle des pismé ou chansons populaires des Serbo-Croates; il n'estime pas beaucoup ce genre de poésie, et c'est, semble-t-il, pour faire plaisir à son ami qu'il a commencé d'y prendre intérêt. «Io era in collera con questo abuso di tradizione, disait-il, ma me la sono lasciata passare; dopo che ò trovato che nello stesso modo si perpetuano molti curiosi e interessanti pezzi di Poesia Nazionale all'uso de'vostri Celti Scozzesi fra'contadini spezialmente…Voi non vi troverete gran forza di fantasia, niente di maraviglioso, non vani ornamenti: ma bensì condotta quanto in alcun allro Poema, e cognizione dell'uomo, e carattere di nazione, e ciò, che mi sembra più pregevole, esattissima verità Storica[35].»
Il en parla et promit même d'en parler davantage dans un autre ouvrage qu'il préparait alors. Pour le moment, il se contenta d'ajouter à la relation de son voyage une ballade serbo-croate («morlaque») traduite en italien, Canto di Milos Cobilich e di Vuko Brancovich. Cette ballade nous intéresse, car, sous le titre de Milosch Kobilich, Mérimée en a donné une traduction française dans la seconde édition de la Guzla. Nous en parlerons en son temps; qu'il nous suffise de faire remarquer ici que Mérimée ne connaissait pas les Osservasioni et qu'il a tiré sa ballade d'une autre source.
Le Canto di Milos Cobilich e di Vuko Brancovich n'est pas à proprement parler de la poésie véritablement populaire, bien qu'il appartienne au cycle le plus important peut-être des chants serbes: celui de la bataille de Kossovo, qui est une lamentation sur la fatale défaite de 1389. Un savant franciscain dalmate, qui voulut instruire son peuple, André Kačić-Miošić (1696-1760), avait composé cette ballade, comme beaucoup d'autres, sur les thèmes populaires et l'avait publiée, en 1756, à Venise, dans un recueil qui porte le titre de Razgovor ugodni naroda slovinskoga(Entretiens familiers de la nation slovinique). Une copie manuscrite de ce poème se trouve à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris (n° 8701).
Fortis ne dut avoir entre les mains qu'une copie de cette chanson et non pas le texte imprimé, car il s'y trompa et la crut véritable poésie populaire. Nulle part, en effet, il ne mentionna Kačić comme en étant l'auteur[36].
Quoi qu'il en soit, il est intéressant et même utile de se demander comment Fortis eut l'idée de joindre cette pièce à son ouvrage et de promettre la publication ultérieure d'autres ballades «morlaques».
Sur le continent européen, cette idée était chose peu commune en 1770. Dix ans seulement s'étaient écoulés depuis qu'en Angleterre les poèmes d'Ossian avaient été publiés; cinq ans seulement depuis la première édition des Reliques of Ancient English Poetry de Percy, et l'influence de ces deux livres, qui sera énorme, commençait à peine à se faire sentir.
Nous parlerons, au chapitre suivant, du retour à la poésie populaire qui se produisit en Angleterre vers le milieu du XVIIIe siècle; cette nouvelle orientation du goût anglais devait exercer par la suite une profonde influence sur les littératures européennes. Ici nous ne dirons que quelques mots de l'origine probable des préoccupations folkloriques de Fortis.
C'est visiblement sous l'influence britannique qu'il se mit à recueillir les poésies populaires serbo-croates. Il connaissait bien, semble-t-il, la littérature anglaise du temps[37], et admirait particulièrement Ossian qu'il lisait dans la traduction de Cesarotti[38]. Il avait de nombreuses relations en Angleterre et il en parle souvent avec un sentiment de reconnaissance; il avait fait son premier voyage de Dalmatie en compagnie d'un savant anglais; de même qu'il fera son second voyage en accompagnant un évêque irlandais. En Italie, il avait pour amis des Anglais et des Écossais qui l'aidaient de leur bourse et auxquels il dédiait ses œuvres: lord Bute, ancien premier ministre de George III, qui était, comme on le sait, protecteur de James Macpherson[39]; John Strange, résident de Sa Majesté Britannique à Venise; lord Frédéric Hervey, évêque de Londonderry, etc.[40]. Enfin, c'est en anglais qu'il fit rédiger l'édition définitive de son Voyage (1778). Hâtons-nous pourtant de dire qu'à notre sens, plus que la littérature de ce pays, ce sont ses amis qui lui donnèrent le goût de la ballade primitive.
Fortis parle avec dédain de la poésie populaire, dont un vrai savant ne devrait pas s'occuper. Le principal but de son ouvrage fut de lancer quelques nouvelles théories géologiques. Et cependant, le meilleur succès qu'obtint son livre sur la «Morlaquie» et les «Morlaques[41]>», il le dut aux littérateurs plus qu'aux savants.
Le Canto di Milos Cobilich e di Vuko Brancovich ne restera pas enseveli dans les Osservazioni. Un illustre penseur et poète allemand, Herder, va le traduire bientôt en sa langue et l'insérer dans le premier tome de sa fameuse collection de Chansons populaires. Et ce sera la première conquête de la poésie serbo-croate[42].
Au mois de juin 1771, Fortis partit pour la seconde fois en Dalmatie. Il y resta plusieurs mois, envoyant à ses protecteurs anglais de longs rapports qu'il réunira en 1774 et publiera à Venise[43]. Dans un des plus intéressants chapitres de ce célèbre Voyage en Dalmatie, le chapitre De' Costumi de' Morlacchi, il parla de nouveau de la poésie populaire serbo-croate, décrivit la guzla et les bardes «morlaques»: «V'è sempre qualche cantore, il quale accompagnandosi con uno stromento detto guzla, che à una sola corda composta di molti crini di cavallo, si fa ascoltare ripetendo, e spesso impasticciando di nuovo le vecchie pisme o canzoni[44].»
Dans ce chapitre il inséra un poème «morlaque», la Triste ballade de la noble épouse d'Asan-Aga («Xalostna Piesanza plemenite Asan-Aghinize») avec, en regard, une traduction en vers italiens («Canzone dolente della nobile sposa d'Asan Aga[45]»). Nous ne savons pas de qui Fortis avait obtenu le manuscrit de cette pièce, car, non seulement elle était inédite à cette époque, mais avait des chances de le demeurer toujours sans son initiative: en effet, aucun collectionneur n'a pu l'entendre réciter[46]. Notons avec la plus grande réserve l'assertion de Hugues Pouqueville dans son Voyage de la Grèce:
Cette pièce (Triste ballade) avait été communiquée à l'abbé Fortis par M. Bruère qui a laissé une grande quantité de poésies slaves inédites qu'il avait recueillies et traduites[47].
M. Bruère, qui a laissé une quantité de poésies slaves, est Bruère-Dérivaux fils (Marko Bruerović) dont nous avons déjà dit quelques mots[48]. Né vers 1770, il n'avait que deux ou trois ans à l'époque des voyages de Fortis; il n'a donc pas pu lui fournir le texte en question. Quant à Bruère-Dérivaux père, qui n'a pas laissé de poésies slaves, il est vrai, mais qui fut longtemps consul de France auprès de la République de Raguse, la chronologie nécessaire nous manque pour pouvoir confirmer ou réfuter la note de Pouqueville[49].—Remarquons aussi que les guzlars serbes n'intitulent jamais leurs productions: ce sont les collectionneurs qui s'en chargent. C'est ainsi que l'on s'explique ce titre prétentieux: la TRISTE ballade de la NOBLE épouse; c'est là le pur langage littéraire des pseudo-classiques dalmates qui avaient recueilli le poème.
Le Voyage en Dalmatie ne trouva pas ce qu'on appelle un accueil chaleureux, du moins auprès des gens de science, malgré tous les efforts de l'auteur pour faire remarquer son ouvrage au moyen de différentes traductions étrangères. Le crédit en fut surtout ébranlé quand un écrivain dalmate, Jean Lovrich, publia sa très sévère critique où il reprochait à Fortis trop de crédulité, les erreurs les plus absurdes et quelques hypothèses très téméraires[50]. Cette réfutation donna lieu à une polémique assez longue, qui finit selon l'usage par devenir fort amère et coûta la vie à celui qui avait entrepris de la faire[51]. Il est juste d'ajouter que plusieurs des conjectures de Fortis ont été depuis confirmées par la science, et que personne n'avait jamais mis en doute sa bonne foi. Il est cité comme autorité par Élisée Reclus, qui fait rarement un tel honneur aux voyageurs anciens[52].
L'année qui suivit la publication du Voyage, le chapitre De' Costumi de' Morlacchi fut traduit en allemand et imprimé à Berne, sous forme de brochure[53]. En 1776 parut dans la même ville la traduction complète en deux volumes in-8º[54]. Au mois de février 1777, le Mercure de France publia un «Fragment sur les mœurs et coutumes des Morlâques (sic) tirés de l'extrait du Voyage en Dalmatie, de M. l'abbé Fortis, inséré dans le tome XX du Journal littéraire de Pise», fragment qui est sans doute la première mention française de l'ouvrage de cet écrivain[55]. Quant à la traduction française, elle sortit en 1778, à Berne, des mêmes presses d'où était sortie la traduction allemande. À titre d'essai, on publia d'abord l'opuscule sur les Mœurs et usages des Morlaques appelés Monténégrins, et celui sur le Pays de Zara[56]; puis, peu de temps après, le Voyage complet[57]. Cette même année 1778 parut à Londres l'édition anglaise, édition définitive, somptueusement imprimée aux frais des amis de l'auteur: Travels into Dalmatia, to which are added Observations on the island of Cherso and Osero; translated with considerable additions (pp. x-584, in-4°).
La ballade «morlaque» publiée et mise en vers italiens à la fin du chapitre sur les mœurs eut plus de succès que le livre entier: elle inspira une trentaine de traductions étrangères, dont treize françaises,—parmi lesquelles la plus importante pour nous est celle de Mérimée, dans la Guzla.
Nous aurons à parler plus loin de la Triste ballade de la noble épouse d'Asan-Aga; ici, nous noterons seulement le succès immédiat qu'elle remporta en Allemagne, succès qui assura à la poésie serbo-croate une certaine renommée européenne bien avant le livre de Mérimée.
Dès le mois de mars 1776, les Annonces savantes de Francfort, en présentant la petite brochure bernoise, se mirent à louer le «Klag-Gesang» morlaque[58]. Ces louanges s'adressaient à la lourde version qu'en avait donnée le poète Werthes; mais une traduction plus réussie ne tarda pas à en être faite.
Un grand poète en assuma la tâche. On ne sait pas exactement quand ni comment Die Sitten der Morlakken arrivèrent entre les mains de Goethe, et à quelle occasion ce dernier entreprit de mettre en vers le petit poème. Toutefois, l'auteur de Werther dut composer sa traduction en 1775 ou 1776, et cela non seulement en utilisant celle de Werthes[59], mais aussi en recherchant dans le texte original, imprimé au recto, les particularités de la métrique serbo-croate, ce que Fortis et Werthes avaient négligé. (Le fait est brillamment démontré par Karl Bartsch[60].) Devenu désormais le Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga, ce morceau trouva, en 1778, une place dans le premier tome des Chansons populaires de Herder[61]. Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'éditeur de ce recueil y avait déjà introduit un chant serbo-croate: le Canto di Milos Cobilich e di Vuko Brancovich. Il y avait ajouté, au tome second, deux autres ballades «morlaques», traduites cette fois sur les versions inédites de Fortis: Radoslaus («Pisma od Radoslava») et Die schöne Dollmetscherin («Pisma od Sekule Jankova netjaka, divojke dragomana i passe Mustaj bega»)[62] empruntées toutes deux aux Entretiens familiers d'André Kačić-Miošić. Les versions italiennes sur lesquelles Herder avait traduit ces deux poèmes de Kačić n'ont jamais été imprimées. Nous n'avons trouvé que la copie manuscrite de l'une d'elles: celle du Canto di Mustài Pascià e della Donzella Dragomana («Die schöne Dollmetscherin»), conservée parmi les papiers de John Strange au British Museum, et nous la publions, de même qu'une autre traduction inédite de Fortis, dans l'Archiv für slavische Philologie[63].
D'après le Klaggesang de Goethe, Walter Scott composa plus tard une Lamentation of the Faithful Wife of Asan Aga; mais ce poème, dont nous tracerons l'histoire à son heure[64], resta inédit jusqu'à nos jours.
Ainsi les voyages de Fortis en Dalmatie ont eu leurs conséquences littéraires: ils ont fait découvrir la poésie populaire serbo-croate; elle aussi trouve sa part dans l'influence qu'exerça la ballade populaire sur la littérature romantique.
La Guzla qui doit beaucoup, directement et indirectement, au Voyage en Dalmatie n'est pas cependant la première œuvre inspirée par ce livre.
Avant d'étudier ce que Mérimée, auteur de la Guzla, a pris à Fortis ainsi qu'à d'autres sources, il nous faut dire quelques mots des précurseurs, envers qui il se trouve redevable dans une certaine mesure.
§ 4