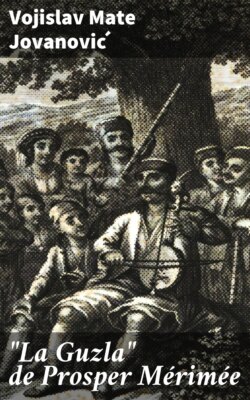Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCe pays idéal, c'est la Morlaquie. Les sauvages paysans slaves sont ces heureux humains qui ont toujours des «jouissances paisibles d'une vie conforme aux goûts de la nature», et qui ne connaissent «pour le moment d'autres lois que celles de la nature et d'autre droit que la force».
Au milieu d'un monde blasé et frivole, la comtesse de Rosenberg avait toujours conservé un très vif attrait pour la mâle poésie des mœurs simples et barbares. Comme nous l'avons déjà noté, elle avait pris dans sa Nouvelle vénitienne plébéienne des gondoliers de Venise pour héros. Dans les Morlaques, elle sort complètement de la société civilisée; elle célèbre d'abord la nature sauvage de la Morlaquie: la mer et les rochers, les silencieuses forêts de sapins, les chutes d'eau vertes, les grottes et les cavernes mystérieuses. Et dans ce décor majestueux, elle nous présente une famille heureuse qui «sur toutes les autres répandait par son exemple l'esprit d'une douce égalité sociale».
Mais l'auteur des Morlaques ne s'en tient pas à peindre un peuple de pasteurs et à glorifier les vertus de la vie patriarcale, comme l'ont imaginé quelques lecteurs peu patients. Le sujet de son roman est un événement tragique dont elle aurait été vivement impressionnée, et qui se serait passé à Venise, sur le quai des Esclavons, vers l'an 1781: la rencontre et le combat acharné de deux voyageurs dalmates, ennemis mortels, par suite d'une rivalité d'amour, combat qui se termina, dit-elle, par la mort du rival préféré. L'auteur eut l'idée de nous faire connaître au fur et à mesure les mœurs primitives des «Morlaques» dans une fiction romanesque, dont l'aventure poignante du quai des Esclavons devait former le dénouement.
La suite naturelle des événements dans une famille morlaque, dit-elle, va nous mettre au fait des mœurs et des usages de la nation, d'une manière plus sensible que la relation froide et méthodique d'un voyageur. On n'a pas cru avoir besoin de recourir au romanesque ou au merveilleux. Les faits sont vrais et les détails nationaux fidèlement exposés. Mœurs, habitudes, préjugés, caractères, circonstances locales, tout résultera des événements et des personnages mêmes mis en action. C'est peut-être la plus agréable façon de donner l'idée juste d'un peuple qui pense, parle et agit d'une manière différente de la nôtre[72].
Il faut relever cette intention de «donner l'idée juste d'un peuple qui pense, parle et agit d'une manière différente de la nôtre». Il est, en effet, curieux de voir une femme auteur s'exprimer de cette façon avant que Mme de Staël ait déclaré qu'il «faut avoir l'esprit cosmopolite»; avant que l'influence de Walter Scott se soit généralisée; avant, enfin, que le mot «couleur locale» ait été découvert[73]. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que Mme de Rosenberg ne s'en tint pas à la théorie, mais essaya de réaliser son idée. Sa grande préoccupation reste, en effet, toujours visible, et de cette préoccupation proviennent les qualités les plus originales des Morlaques: peinture extrêmement vive des passions les plus violentes qui font agir les acteurs du drame sanglant, peinture qui ne tend nullement à démontrer la supériorité morale des «primitifs incorrompus», et qui ne dégage aucune proposition plus ou moins utopique, pour servir à corriger les «civilisés corrompus». Il serait très injuste de voir dans les Morlaques une simple illustration des idées de Rousseau, car, si la comtesse de Rosenberg déplorait la disparition des sociétés primitives, elle la déplorait exclusivement au point de vue artistique,—ce qui était, en 1788, d'une originalité indiscutable. Elle regrettait la disparition des costumes pittoresques, des coutumes barbares, des croyances populaires, voire même de l'ignorance. Rousseau eût abhorré la superstition, dont—en vraie dilettante littéraire—était amoureuse la comtesse de Rosenberg.
Car, si l'on cherche les influences qui peuvent expliquer—jusqu'à un certain point, cela va sans dire—cette manie du «primitif», on les trouvera dans cette autre source du romantisme: les poèmes ossianiques de Macpherson, poèmes où se retrouvent des idées et des sentiments chers à Rousseau, encore que ces deux auteurs n'aient nullement influé l'un sur l'autre[74]. Les Morlaques furent écrits à l'époque la plus ardente, durant la longue vogue de «l'Homère celtique», et ils en portent visiblement les traces. L'abbé Cesarotti, critique influent, traducteur italien du barde écossais, et, de plus, son grand admirateur, partageait l'intimité de la comtesse de Rosenberg. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'on rencontre dans la Morlaquie semi-arcadienne de cette spirituelle dame, non seulement la monotonie sauvage, la mélancolie du passé, le vague du paysage, «les haines renfermées au fond des cœurs», sentiments de l'époque auxquels le fils de Fingal devait la plus grande partie de son succès,—mais aussi et surtout cet autre trait des chants ossianiques, plus original et plus distinctif celui-là, vrai trait celtique, «heureuse erreur des peuples vivant sous la Grande Ourse», qui «ignorent la pire des craintes, celle de la mort[75]»: l'amour des catastrophes terribles et des massacres fatals, la glorification de la haine meurtrière scandée solennellement dans la phrase pathétique du barde plaintif. Et cette inspiration ossianique ne se reflète pas seulement à travers le sanglant et sentimental carnage illyrien; elle va jusqu'à souffler, en certains endroits des Morlaques, la même poussière pseudo-archaïque que Macpherson étala sur sa prose rythmique.
Mais cette double influence de Rousseau et d'Ossian n'était pas suffisante pour amener à elle seule, en 1788, l'auteur de ce roman exotique à conclure que la civilisation moderne détruit le pittoresque, qu'elle «efface la physionomie» des peuples et des individus, qu'elle est néfaste à la littérature, qu'il faut partir pour les pays barbares à la recherche des héros originaux, pour donner, lorsqu'on les a trouvés, «l'idée juste» de leur manière de penser, de parler et d'agir, manière qui est «différente de la nôtre». Quelque fortes que soient les influences littéraires, elles n'expliquent pas complètement les origines de ce livre peu commun. Il y a dans les Morlaques tant de passages vraiment beaux et qui trahissent, sous le cosmopolitisme d'esprit de l'auteur, une telle sensibilité féminine qu'il est impossible de ne pas voir combien profond et entier était l'amour presque hystérique réservé par l'excentrique comtesse de Rosenberg aux simples et pittoresques peuples «primitifs».
Il nous reste à examiner le soin qu'elle apporte à peindre ses héros, à brosser ses décors: Slaves dalmates, paysages adriatiques.
Comme Mérimée qui, quarante ans plus tard, a choisi pour la Guzla les mêmes personnages et la même scène, la comtesse de Rosenberg n'avait jamais vu la Dalmatie. Ce qu'elle en sait, elle le sait de seconde main, et—disons-le tout de suite—elle en sait bien peu pour mériter les éloges décernés par l'abbé Cesarotti à sa prétendue exactitude. Charles Nodier qui avait vu la Dalmatie, et qui en parlait avec autorité, se trompe absolument en jugeant les Morlaques le «tableau le plus piquant et le plus vrai, etc…[76]» Les Morlaques, comme la Guzla, sont une «drogue», mais une drogue de fabrication plus grossière.
La comtesse de Rosenberg avait puisé la plus grande partie de ses renseignements sur la Dalmatie dans ce même Voyage de Fortis[77] que Mérimée mit, plus tard, à contribution. C'est grâce à cette source commune que la ressemblance entre leurs ouvrages n'est ni vague ni incertaine. Dans tous deux on trouve le même bric-à-brac exotique: noms bizarres, de personnes et de lieux,—mots slaves pieusement copiés dans le Voyage, avec toutes les fautes d'impression et de transcription italienne,—mots soigneusement soulignés, incrustés dans le texte avec une abondance orientale,—descriptions de fêtes populaires, de coutumes, de superstitions, de croyances; dans tous deux la guzla est dépeinte, dans tous deux se retrouvent des pismé (chansons).
Quant à la «couleur locale», il serait injuste d'exiger de l'auteur des Morlaques ce que nous a donné, bien après, l'auteur de la Guzla. Les temps étaient changés: le public romantique en demandait bien davantage. De plus—et sans parler de la supériorité du talent de Mérimée sur celui de la comtesse de Rosenberg—les genres dans lesquels chacun d'eux s'était exercé étaient si différents que l'auteur de la Guzla devait fatalement être amené à rechercher le coloris plus que ne l'avait fait l'auteur des Morlaques. En effet, Mérimée, reconstituant quelques pages de Fortis, ne composera que des morceaux fragmentaires, changeant à chaque moment ses acteurs et sa scène, morcelant à dessein son sujet. La comtesse de Rosenberg, au contraire, puisant à la même source, est contrainte—c'est une nécessité du roman—de combler toutes les lacunes pour donner une unité factice à son œuvre. La tâche était plus lourde, sinon impossible, et il n'est que très naturel d'en constater l'insuccès. Mais l'effort était beau, surtout à une époque où il n'y avait pas de précédent; il mérite une attention d'autant plus sympathique que les Morlaques, pris dans leur ensemble, paraissent beaucoup plus «illyriens» que Jean Sbogar ou Smarra, de Charles Nodier, ouvrages écrits pourtant trente ans plus tard, après un séjour de l'auteur parmi les Slaves du Sud, et qu'on croit aujourd'hui encore avoir subi l'influence de ce séjour[78].
Parlant de l'influence de Macpherson, nous avons fait allusion aux morceaux pseudo-antiques qui se trouvent dans les Morlaques. Ces prétendus spécimens de «poésie esclavonne», au nombre de dix, sont disséminés dans le cours du volume conformément aux exigences du récit. On en a réuni l'indication dans une table particulière placée à la fin des Morlaques. Voici les titres de ces poésies: Chanson de Pecirep, Histoire d'Anka, Épithalame de Radomir aux noces de Jervaz, Épithalame de Dascia aux noces de Jervaz, Prière à l'image de Catherina, Chanson de mort de Dabromir, Chanson de la bienheureuse Dianiza, Chanson de Tiescimir et Vukossava, Chanson de mort pour le Starescina de Rostar, Chanson de mort de Jervaz.
Le biographe de la comtesse de Rosenberg nous assure gravement que quelques-unes de ces poésies sont tirées «d'un recueil d'anciens chants héroïques, publié dans le courant du XVIIIe siècle par un religieux dalmate, le P. Morvizza»; les autres, inédites, auraient été rapportées et traduites à Justine Wynne par ses amis de Venise[79]. «Ces chansons, ajoute-t-il, appartiennent à des époques fort différentes; l'une des plus anciennes, Tiescimir et Vukossava (p. 254), est évidemment antérieure à l'invasion musulmane.»
Ces poésies ne sont que des contrefaçons; l'auteur de la notice que nous citons se trompait, mais il n'était pas le premier qui tombait dans cette erreur, car on verra dans les pages qui vont suivre que Mme de Staël, non plus, ne les suspectait pas. Charles Nodier, qui affectait une connaissance de «l'illyrien», prétendait également que les «morceaux de poésie esclavonne» sont «bien choisis» et que «le style de la traduction a quelque chose de la naïveté, du nerf et de la couleur de l'original[80]».
«Le P. Morvizza, religieux dalmate du XVIIIe siècle», n'ayant eu qu'une existence fictive, aucune des poésies insérées dans les Morlaques ne pouvait être tirée d'un recueil imaginaire. Il est probable que le baron Ernouf pensait à un autre religieux dalmate qui avait publié au XVIIIe siècle une collection de chants serbo-croates, André Kačić-Miošić, l'auteur des Entretiens familiers dont nous avons déjà parlé; mais les ballades de ce poète populaire sont par trop différentes de celles qui se trouvent dans les Morlaques pour qu'on puisse y reconnaître la moindre parenté avec ces dernières; certains détails cependant nous ont paru assez significatifs pour ne pas exclure la possibilité d'une connaissance directe des Entretiens familiers de la part de la comtesse de Rosenberg; ce sont de nombreux noms serbo-croates qu'on ne trouve pas chez Fortis, mais qui tous ou presque tous ont été employés par Kačić: Anka, Dobroslave, Pecirep, Dianiza, Radomir, Tiescimir, Vukossava, etc.—Toutefois, la présence de ces noms dans le livre de Mme de Rosenberg peut s'expliquer d'une autre façon: l'auteur des Morlaques n'avait-elle pas des amis qui, connaissant la Dalmatie, Dandolo, par exemple (ou Fortis lui-même peut-être?) ont pu lui donner des renseignements qui ne sont pas dans le Voyage?
Pour donner une idée de ces «morceaux de poésie esclavonne»—qui n'ont pour nous d'autre intérêt que de précéder la Guzla—citons-en un: la chanson récitée aux funérailles d'un ancien chef slave. Le sujet est celui que traitera Mérimée dans une de ses ballades «illyriques», le Chant de mort, ce vocero dalmate qui ressemble tant au vocero corse dont on lit un spécimen dans Colomba.
Qui nous guidera encore sur les frontières des Turcs, pour leur
enlever le bétail?
Qui jugera des meilleurs coups et donnera le prix au bras le plus
robuste?
Qui mènera l'épouse à l'époux avec pompe et joie, si notre chef
est mort?
Qui nous éclairera de ses conseils, comme notre père, dont la prudence
égalait la clarté des flambeaux qui dissipent les ténèbres?
Que t'avons-nous fait, Marnan, pour que tu nous quittes? Nous
t'aimions, nous obéissions toujours à tes ordres, ô brave Staréscina!
Mes frères, il nous écoute, il nous entend: nos voix descendent jusqu'à lui, mais la sienne ne peut plus monter jusqu'à nous.
Il faut se demander maintenant si Mérimée connaissait cet ouvrage, et si ce roman n'a pas inspiré la Guzla. La réponse qu'on peut faire est à peu près celle-ci: les Morlaques n'étaient pas destinés au public, et le bibliomane Nodier qui en possédait un exemplaire, donné par l'auteur à lord Glenbervie, le jugeait «extraordinairement rare» en 1829[81]. Il est donc fort douteux que Mérimée ait lu cet ouvrage avant 1827—s'il l'a jamais lu—du moins nous n'avons pu trouver trace d'une pareille lecture dans la Guzla, quoique les ressemblances provenant d'une commune source—le Voyage de Fortis—ne manquent pas.
L'on verra que Mérimée n'ignorait pas les nouvelles illyriennes de Charles Nodier: Jean Sbogar (1818) et Smarra (1821); il serait donc intéressant de rechercher si Nodier, lui, connaissait les Morlaques. On pourrait dire alors qu'il existe dans la Guzla une certaine influence provenant indirectement des ballades-pastiches de la comtesse de Rosenberg. Ces recherches seraient d'autant plus utiles que, dès 1862, Paul Lacroix (bibliophile Jacob) remarquait un certain air de parenté entre ces productions[82], et que tout récemment, M. Curčin en est arrivé à conclure que toutes ces «mystifications» forment une «série ininterrompue» de pastiches «qui servaient toujours de modèle l'un à l'autre»: les Morlaques à Smarra, Smarra à la Guzla[83].
Pour des raisons qui nous paraissent bonnes et que nous donnons ci-dessous, nous ne croyons pas que Nodier connût les Morlaques au moment où il écrivait ses feuilletons «illyriques» (1813), ni même à l'époque de Jean Sbogar (1818) et de Smarra (1821). Les Morlaques sont un livre très rare et, probablement, Nodier ne les connaissait pas avant 1823, c'est-à-dire au moins deux ans après la publication de Smarra, son dernier ouvrage «esclavon».
Tout d'abord, il est aisé de se rendre compte qu'en 1816, il n'avait pas encore eu les Morlaques entre les mains. Il fit en effet paraître cette année dans la Biographie universelle un article sur Albert Fortis, où il prétendait que le roman de Mme Wynne n'était qu'une «paraphrase un peu étendue d'un chapitre du Viaggio in Dalmazia», ce qui provoqua une maligne rectification de la part de Ant.-Alex. Barbier (dans son Examen critique et complément des Dictionnaires historiques, Paris, 1820, p. 346). Nodier fut piqué au vif,—c'était au bibliographe qu'on s'en prenait!—il répondit finement à Barbier, tout en avouant du reste s'être lourdement trompé: il avait jugé le livre sans l'avoir jamais vu[84].
D'autre part, lord Glenbervie, à qui avait appartenu l'exemplaire de Nodier, ne mourut qu'en 1823[85]; il n'est guère probable que la bibliothèque de ce grand seigneur, homme d'État, ait été dispersée avant sa mort.
Mais si Mérimée ignorait les Morlaques et si Charles Nodier ne les a connus que longtemps après Jean Sbogar et Smarra, Mme de Staël, bien avant eux, avait lu l'ouvrage de la comtesse de Rosenberg et en avait parlé sans que personne s'en fût jamais douté[86].
§ 5