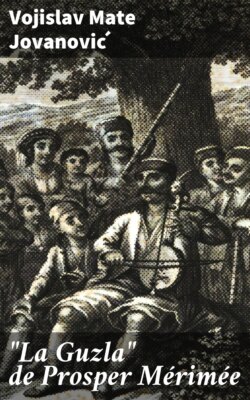Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA COMTESSE DE ROSENBERG-ORSINI
ОглавлениеDe nos jours, Justine Wynne, comtesse des Ursins et Rosenberg, auteur des Morlaques, est absolument inconnue. Ni Sayous ni M. Virgile Rossel ne disent un seul mot de cette Anglo-Italienne qui fut écrivain français; et le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Larousse, qui a exhumé les noms les plus oubliés, ignore pourtant le sien.
Cependant, elle fut célèbre en son temps; les Morlaques, imprimés en 1788, furent lus par Goethe qui s'en souvenait quarante ans après[65]; l'abbé Cesarotti, littérateur distingué du temps, traducteur italien d'Ossian, les loua comme «une poésie qui n'a pas besoin de versification, comme Vénus n'avait besoin, pour se faire aimer de Pâris, ni de ses vêtements ni même de sa ceinture[66]». Les Morlaques eurent l'honneur d'être traduits en allemand[67] et en italien; ils inspirèrent une page de Corinne; et Charles Nodier, qui en possédait l'un des rares exemplaires, les appela un jour «le tableau le plus piquant et le plus vrai des mœurs les plus originales de l'Europe[68]».
Ce roman aujourd'hui complètement oublié méritait que l'histoire littéraire sinon le public lui fît un meilleur sort. Car, malgré tous ses défauts, le livre des Morlaques ne manque pas, à plus d'un point de vue, d'originalité et d'intérêt. Ajoutons que ce curieux ouvrage est un des premiers romans français où se trouve décrite la vie des nations étrangères, avec le souci de ce qu'on appellera plus tard la couleur locale; il se révèle de plus chez son auteur un profond sentiment de la nature sauvage et des mœurs barbares, ce qui est également rare et exceptionnel en 1788. C'est là, sans doute, un titre suffisant pour valoir à la comtesse de Rosenberg au moins une mention parmi les précurseurs de l'exotisme romantique.
Justine (Giustiniana) Wynne naquit à Venise vers 1735. Son père était anglais et protestant; sa mère greco-italiote était catholique fervente. «Placée, au début de la vie, dit son biographe[69], sous ces deux influences religieuses contradictoires, elle subit un tiraillement moral dont l'impression demeura ineffaçable. Ses idées s'altérèrent au contact d'un monde frivole et sceptique, mais elle retint l'exaltation en perdant la foi. Rien ne put détruire en elle le germe de cette sensibilité profonde, qualité qu'elle tenait de sa mère, et qui donne, en grande partie, leur valeur à ses œuvres.
«Justine était l'aînée de cinq enfants, trois filles et deux fils; elle avait quatorze ans, quand une violente attaque de goutte remontée lui enleva son père. Quoique celui-ci habitât l'Italie depuis plusieurs années, il était resté sujet britannique, et sa famille dut se conformer aux prescriptions des lois anglaises. Lord Holland, l'un des grands seigneurs philosophes de cette époque, fut nommé tuteur de Justine et de ses frères et sœurs. Il voulut attirer en Angleterre toute cette famille, y marier avantageusement les filles et donner aux garçons une éducation anglaise. L'opiniâtre Mme Wynne avait l'idée fixe de soustraire ses enfants à l'influence protestante. Deux fois elle fut contrainte de venir avec eux en Angleterre (1751-1756) et deux fois elle parvint à les ramener en Italie sous prétexte que le climat du Nord était préjudiciable à leur santé.
«Malgré ces efforts, les fils de Mme Wynne furent définitivement rendus à l'Angleterre. L'un d'eux, Richard, devint ministre du culte anglican, et s'est fait connaître par des travaux philologiques d'une certaine valeur. Justine elle-même était sur le point de redevenir anglaise, quand un événement, qu'elle ne désigne que sous le nom de combinaison fâcheuse, l'éloigna pour toujours du pays de sa famille.
«Cette combinaison fâcheuse fut son mariage avec le comte de Rosenberg-Orsini, ambassadeur d'Autriche à Venise.
«Jolie, ambitieuse et avide de plaire, ayant eu des aventures galantes dès l'âge de seize ans, la jeune comtesse ne paraît pas avoir été très contente de son mari, car elle a gardé à son sujet un silence complet dans ses œuvres où se trouve cependant un assez grand nombre de fragments autobiographiques. On sait, seulement, qu'elle résida à diverses reprises en Allemagne, et qu'elle s'amusa fort pendant ce temps qu'elle appelle «les cinq plus belles années de sa vie.»
«Elle se trouva veuve à Venise, jeune et sans enfants. «J'étais charmante, écrivait-elle longtemps après; il m'est permis de le dire aujourd'hui, parce que je survis à ma beauté, et qu'il n'est pas plus ridicule de se louer sur ce que l'on a été que de composer soi-même son épitaphe.» Elle fut une des reines de l'aristocratie vénitienne pendant près de vingt ans (1760-1780) à l'époque de l'omnipotence féminine dans les affaires politiques et administratives de la Sérénissime République.
«Parvenue au déclin de l'âge, elle montra plus de tact que la plupart de ses contemporaines, qui prolongeaient leurs galanteries bien au delà de la jeunesse, ou achevaient de s'avilir en demandant des émotions nouvelles à la funeste passion du jeu. Quand Justine Wynne se sentit vieille, elle se fit ermite.
«C'est alors qu'elle s'adonna à la littérature. Elle s'installa avec ses livres et ses chiens près de Padoue, dans une excentrique villa nommée Alticchiero, appartenant à son vieil ami le sénateur Angelo Quirini. Elle se mit à écrire, même à beaucoup écrire, en français et en anglais; mais ne fit imprimer que quelques ouvrages tirés à un très petit nombre d'exemplaires. Elle nous a expliqué elle-même l'origine de ses premiers essais littéraires. «Quand j'étais jolie femme, dit-elle dans les Pièces morales et sentimentales, j'avais eu du moins le bon esprit de comprendre qu'il me resterait une longue vie au delà de la vie brillante de la jeunesse. Je consacrais à la lecture le temps que j'avais de reste, celui que les autres femmes réservent à leur chien ou à leur sapajou. Heureusement que je n'aimais pas les bêtes alors; je les aime à présent, et je donne à mes chiens les moments que je donnais alors à mes adorateurs. Les livres me restent toujours, ainsi que quelques amis, qui m'aident à supporter l'âge du repentir.»
«Parmi ces amis, on remarquait, outre Quirini, un sénateur nommé Dandolo, qui avait été et redevint depuis provéditeur de Dalmatie, et auquel le futur auteur des Morlaques devait, sans doute, plus d'une information sur ce pays où il a situé ses personnages et où l'action se déroule. Mais le visiteur le plus assidu de la villa Alticchiero était un certain comte Benincasa, qui prit même, paraît-il, une part aux travaux littéraires de la comtesse de Rosenberg. C'est pour ses amis que l'auteur des Morlaques écrivait et faisait imprimer ses œuvres, évitant la grande publicité, agissant avec une ambition littéraire des plus discrètes et des plus mesurées; aussi ses ouvrages sont-ils fort rares aujourd'hui et très recherchés des bibliophiles.» En voici la nomenclature:
1° Alticchiero, par Mme J.W.C.D. R. Genève, 1781?
Cet ouvrage est la description détaillée de la villa appartenant au sénateur Quirini, et fut adressé en manuscrit à M. Huber, de Genève (ami de Voltaire), qui le fit imprimer à ses frais à un très petit nombre d'exemplaires. En 1787, Quirini en tira une nouvelle édition avec un très grand nombre de planches et une épître dédicatoire signée par le comte Benincasa: Padoue, gr. in-4° de 5 ff. et 80 pp. de texte, avec un plan et 29 planches (British Museum).
Nous empruntons au baron Ernouf la description de cette originale demeure: «Moins somptueuse que ses orgueilleuses voisines, les villas Pisani, Foscarini, etc., Alticchiero avait néanmoins son cachet et sa réputation à part. Une partie du domaine était consacrée à des expériences agronomiques; les jardins étaient dessinés à la française, suivant le goût alors dominant; mais l'agréable y était partout sacrifié à l'utile avec une affection systématique et parfois originale. Les bosquets, les massifs, les avenues étaient exclusivement composés de beaux arbres fruitiers de toute espèce, et symétriquement décorés de statues des divinités du paganisme, de bustes de grands hommes anciens et modernes, notamment ceux de Voltaire et J.-J. Rousseau. On rencontrait là Hercule et Vénus dans un massif d'orangers, Mars de garde au milieu d'un carré de pastèques, et un autel dédié aux Furies, au rond-point d'une belle treille formant labyrinthe. Cette propriété si classiquement décorée avait encore une qualité qui passerait aujourd'hui pour un défaut aux yeux de bien des gens: tout y était aussi uni, aussi plat que régulier. Aucun mouvement de terrain, aucune inégalité malséante, même à l'horizon, n'y altérait l'harmonie et la précision des lignes.»
2º Du séjour des comtes du Nord à Venise en janvier 1782. Venise, 1783.
Lettre de la comtesse de Rosenberg à son frère Richard Wynne sur les voyages du grand-duc héritier de Russie, Paul Pétrovitch (depuis Paul Ier), et la princesse de Wurtemberg, sa seconde femme. Comme l'ouvrage précédent, cet opuscule est sans valeur littéraire.
3º Pièces morales et sentimentales de Mme J. W., C-T-SS de R-S-G, écrites d'une campagne sur les rivages de la Brenta dans l'État vénitien. Londres, J. Robson, 1785.
On remarque, parmi ces pièces, surtout la Nouvelle vénitienne plébéienne, placée à la fin du recueil, où l'auteur trace un tableau curieux des costumes et de la physionomie des gondoliers de Venise, encore originaux et pittoresques dans ce temps-là. Mme Wynne se révolte contre la civilisation moderne: «À force de communiquer ensemble, disait-elle, les hommes finissent par se ressembler tous parce qu'ils substituent indistinctement aux caractères nationaux, des manières et des idées de convention générale, ce qui efface la physionomie des nations.» Cette Nouvelle plébéienne fut traduite en italien et publiée en 1786, à Venise, sous le titre Il Trionfo de' Gondolieri.
Il existe aussi une édition anglaise de ce recueil, publiée à la même époque à Londres, en deux volumes, sous le titre des Moral and sentimental Essays.
4º Les Morlaques, Venise, 1788, dont on va parler plus loin.
5º Une chronique scandaleuse de la société vénitienne de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est restée inédite[70].
Après avoir fait imprimer les Morlaques, la comtesse de Rosenberg voulut revoir une dernière fois l'Angleterre, qu'elle n'avait pas visitée depuis longtemps. Elle fit ce voyage avec Benincasa, devenu son inséparable, et passa près d'une année auprès de son frère Richard, avec lequel elle était toujours restée en correspondance. Elle revint par la France, où Benincasa se fit fort applaudir dans quelques clubs par ses adhésions chaleureuses à la Révolution, mais elle trouva peu d'agrément dans ce Paris tumultueux de 1790. Rentrée à la villa Alticchiero, elle y mourut presque subitement, peu de temps après son retour.
Les Morlaques[71], dans une certaine mesure, rappellent Bernardin de Saint-Pierre; on y reconnaît également, avons-nous besoin de le dire? l'influence de Rousseau.
Dans sa préface, la comtesse de Rosenberg expose son plan: elle veut peindre dans les Morlaques un pays qui «offre l'image de la nature en société primitive, telle qu'elle a dû être dans les temps les plus reculés… Avant qu'une nouvelle révolution change la nature et l'aspect de ce pays, poursuit-elle, qu'on le voie dans son état actuel beaucoup plus intéressant que celui de la civilisation la plus achevée, dont les biens et les maux sont également connus depuis longtemps parmi nous».