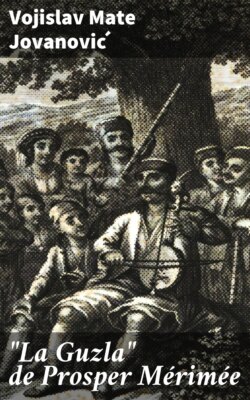Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«JEAN SBOGAR»
ОглавлениеD'après Nodier, Jean Sbogar est un personnage historique «dont la renommée aventureuse remplissait encore les États vénitiens» à l'époque où il publia son histoire. C'est un bandit illyrien révolté contre le gouvernement napoléonien, ou plutôt contre tous les gouvernements du monde. Ce n'est pas un bandit banal, mais un bandit philosophe, comme le témoignent les nombreuses pensées parsemées dans l'ouvrage et qui auraient été toutes «tirées de sa conversation avec une scrupuleuse littéralité[153]». «Ennemi décidé des forces sociales, il tendait ouvertement à la destruction de toutes les institutions.» Avec sa bande armée, qui se donne le nom des Frères du bien commun, il habitait le château de Duino en Istrie, d'où il répandait la désolation et la terreur par l'incendie, le pillage et l'assassinat. Aussi n'était-ce point un simple paysan comme la plupart des camarades qui l'accompagnaient. «Le vulgaire le faisait petit-fils du fameux brigand Sociviska, et les gens du monde disaient qu'il descendait de Scanderbeg, le Pyrrhus des Illyriens modernes.» Il parlait avec élégance le français, l'italien, l'allemand, le grec moderne et, cela va sans dire, la plupart des langues slaves.
Il était pâle et mélancolique, aimait la solitude et les cimetières, et, pour soulager le terrible mal qu'il ressentait sous son front noble et dédaigneux, il passait souvent sa main «blanche, délicate et féminine» dans ses cheveux blonds. Il s'était épris d'une jeune fille d'origine française, la mystique Antonia, qui habitait seule avec sa sœur aînée, Mme Alberti, dans un vieux château près de Trieste. Cette jeune fille venait de perdre son père, taciturne et morose royaliste, émigré au bord de l'Adriatique, et sa mère, poitrinaire, à la sombre imagination.
Mais Sbogar savait qu'il était «né sous une étoile fatale», que «Dieu n'avait rien fait pour lui»; il voulait rester seul, toujours seul, accablé de son châtiment éternel. Il voulait étouffer en lui cet amour criminel, «chimère qu'il n'avait créée que pour la combattre», dans son désir de ne pas rendre Antonia malheureuse, ou plutôt dans son désir de ne partager avec personne ses douleurs infinies.
Antonia ne savait rien de la terrible passion qui consumait Sbogar. Elle ne connaissait de lui que son nom effrayant et les sanglants exploits sur lesquels elle avait longtemps pleuré. Mais, en rêve, elle sentait qu'une âme perdue planait au-dessus de la casa Monteleone, elle entrevoyait un œil farouche qui veillait sur elle jour et nuit; elle entendait des voix sourdes d'inconnus invisibles qui suivaient de loin chacun de ses pas.
Un jour, elle dut quitter l'Istrie et se rendre à Venise avec sa sœur. En ce temps-là, on y parlait beaucoup d'un jeune étranger, nommé Lothario, personnage mystérieux sur lequel couraient les bruits les plus singuliers. Lothario qui se trouve partout, et qui n'est connu de personne, inspire, par son caractère imposant, sa vie cachée, ses libéralités, sa magnificence, un enthousiasme général. «Il s'était concilié, sans qu'on sût de quelle manière, et la faveur du peuple et l'estime des grands.» Il répandait l'or avec la profusion digne d'un souverain. Son pouvoir était tel que, de sa propre autorité, il arrachait aux mains des sbires les malfaiteurs et les prisonniers d'État; d'un seul mot il pouvait exciter la révolte, la guerre civile et renverser les gouvernements. Personne ne lui connaissait d'amis. On se rappelait seulement que, quelques années auparavant, il avait paru s'occuper beaucoup d'une jeune fille noble, qui, de son côté, avait témoigné une vive passion pour lui; mais un grand malheur mit fin à cet amour: Lothario partit; la jeune fille disparut, et on ne retrouva son corps que longtemps après, dans le sable d'une lagune.
Antonia fut très émue de cette histoire; cependant, elle éprouvait un vif désir de voir Lothario: ce désir fut bientôt satisfait, elle le rencontra dans un concert de Venise. La puissance romanesque de ce fascinateur lui inspira un amour violent. «Antonia fut saisie à son aspect d'une émotion qu'elle n'avait jamais éprouvée et qui ne ressemblait point à un sentiment connu. C'était quelque chose de vague, d'indécis, d'obscur, qui tenait d'une réminiscence, d'un rêve ou d'un accès de fièvre. Son cœur palpitait violemment, ses membres perdaient leur souplesse; elle essayait inutilement de rompre ce prestige, qui s'augmentait des efforts qu'elle faisait pour le surmonter. Elle sentait quelque chose de semblable à je ne sais quoi d'odieux et de tendre.»
Lothario paraît ne pas comprendre ce qui se trahit si visiblement chez cette fille sensible. Il continue de maudire la vie et la société civilisée. Il vante à Antonia les charmes d'une vie indépendante, et fait l'éloge des chefs de brigands illyriens:
Bien jeune encore, je sentais déjà avec aigreur les maux de la société, qui ont toujours révolté mon âme, qui l'ont quelquefois entraînée dans des excès que je n'ai que trop péniblement expiés. Par instinct plutôt que par raison, je fuyais les villes et les hommes qui les habitent; car je les haïssais, sans savoir combien un jour je devais les haïr. Les montagnes de la Carniole, les forêts de la Croatie, les grèves sauvages et presque inhabitées des pauvres Dalmates, fixèrent tour à tour ma course inquiète. Je restais peu dans les lieux où l'empire de la société s'était étendu; et, reculant toujours devant ses progrès qui indignaient l'indépendance de mon cœur, je n'aspirais plus qu'à m'y soustraire entièrement. Il est un point de ces contrées, borne commune de la civilisation des modernes et d'une civilisation ancienne qui a laissé de profondes traces, la corruption et l'esclavage: le Monténégro est comme placé aux confins de deux mondes, et je ne sait quelle tradition vague m'avait donné lieu de croire qu'il ne participait ni de l'un ni de l'autre. C'est une oasis européenne, isolée par des rochers inaccessibles et par des mœurs particulières que le contact des autres peuples n'a point corrompues. Je savais la langue des Monténégrins. Je m'étais entretenu avec quelques-uns d'entre eux, quand des besoins qui ne s'accroissent jamais, et qui ne changent jamais de nature, en avaient amené par hasard dans nos villes. Je me faisais une douce idée de la vie de ces sauvages qui se suffisent depuis tant de siècles, et qui depuis tant de siècles ont su conserver leur indépendance en se défendant soigneusement de l'approche des hommes civilisés. En effet, leur situation est telle que nul intérêt, nulle ambition ne peut appeler dans leur désert cette troupe de brigands avides qui envahissent la terre pour l'exploiter. Le curieux seul et le savant ont quelquefois tenté l'accès de ces solitudes, et ils y ont trouvé la mort qu'ils allaient y porter (sic); car la présence de l'homme social est mortelle à un peuple libre qui jouit de la pureté de ses sentiments naturels.
Malgré toute cette misanthropie, Antonia aime plus que jamais cet inconnu qu'elle croit victime d'une des révolutions qui bouleversaient l'Europe de 1808. Mais Lothario refuse sa main et lui écrit qu'il ne la reverra jamais.
Après d'aussi brusques adieux, les deux sœurs quittent Venise pour l'Illyrie, où Antonia espère que Lothario la rejoindra. En route, elles sont attaquées par la troupe de Jean Sbogar. Mme Alberti meurt d'un coup de feu; Antonia évanouie est transportée au château de Duino. Elle y devint folle, mais les égards et le respect qu'avait pour elle Jean Sbogar—notons que la tête de celui-ci était toujours voilée d'un crêpe noir et que personne ne connaissait son visage—commencèrent à lui procurer quelques moments lucides pendant lesquels elle put réfléchir sur son état.
Un jour, le canon gronda aux environs du château. Bientôt un cliquetis d'épées annonça à la jeune fille que l'on se battait à l'intérieur même des murs. Les troupes françaises poursuivaient sans relâche les brigands qui infestaient le pays. Elles venaient d'entrer dans le repaire de Jean Sbogar. Tout à coup, Antonia entendit un tumulte horrible, au milieu duquel s'élevait le nom du fameux bandit dalmate. Un homme poursuivi s'élança dans l'escalier, et passa auprès d'elle comme un éclair.
Antonia courut vers sa chambre; et, en y rentrant, il lui sembla qu'on la nommait d'une voix sourde.
—Qui m'appelle!—dit-elle en tremblant.
—C'est moi—répondit Jean Sbogar,—ne t'effraie pas. Adieu pour toujours.
Quelques instants plus tard, le château de Duino était tombé aux mains des ennemis. On conduisit Jean Sbogar et les siens à Mantoue pour y être jugés. La jeune fille trouvée parmi eux, et dont l'état de démence était bien constaté, fut placée dans un hôpital et confiée aux soins d'un médecin célèbre. Elle recouvra la raison et se décida à prendre le voile dans la maison où elle avait trouvé asile. Le jour de la profession était arrivé, lorsque deux sbires vinrent la chercher au nom de la justice.
L'instruction du procès était achevée; ils avaient été condamnés à mort au nombre de quarante, mais on ne savait si Jean Sbogar était parmi eux, lui, dont personne ne connaissait le visage, et dont le nom continuait à inspirer la terreur dans les campagnes. On se souvint de la jeune fille trouvée dans le château et l'on pensa qu'elle le reconnaîtrait parmi ses complices. Antonia fut donc placée dans la grande cour de la prison, au moment où les condamnés devaient y passer pour la dernière fois. Ils parurent; l'aspect de l'un d'eux la frappa immédiatement: c'était lui. «Lothario!» s'écria-t-elle d'une voix déchirante. Lothario se détourna et la reconnut. «Lothario!» dit-elle en s'ouvrant un passage au travers des sabres et des baïonnettes; car elle comprenait qu'il allait mourir!—«Non,» répondit-il, «je suis Jean Sbogar!»—«Lothario! Lothario!»—«Jean Sbogar!» répéta-t-il avec force.—«Jean Sbogar!» cria Antonia. «Ô mon dieu!» et son cœur se brisa.
Elle était par terre immobile; elle avait cessé de respirer. Un des sbires souleva sa tête avec la pointe de son sabre, et lui laissa frapper le pavé en l'abandonnant à son poids.
«Cette jeune fille est morte»,—dit-il.
—«Morte»,—reprit Jean Sbogar en la considérant fixement.—«Marchons!»
Jean Sbogar parut sous le couvert de l'anonymat au mois de mai 1818, quatre ans et demi après que Nodier fût revenu de Laybach[154]. Il eut d'abord ce que l'on appelle aujourd'hui une mauvaise presse, malgré l'artifice qu'avait imaginé son auteur pour exciter l'intérêt du public. Sur ce point, encore mal éclairé, nous relevons dans le Journal de Paris du 20 juin 1818, cette curieuse note:
Les éditeurs de cet ouvrage nous apprennent, dans une espèce d'avertissement mystérieux, que l'auteur leur avait envoyé son manuscrit au moment où il se disposait à franchir l'espace qui le séparait encore de la Russie. Depuis la publication de ce roman, une note insérée le même jour dans tous les journaux prouve que l'on a voulu profiter de cette circonstance pour attribuer Jean Sbogar à Mme de Krudener. Cet artifice était trop grossier pour réussir; comment, en effet, le lecteur aurait-il pu confondre la mélancolie douce et suave, les sentiments pudiques, les pensées religieuses qui distinguent l'auteur de Valérie, avec cette misanthropie farouche, cet amour forcené d'un brigand pour une femme dont la tendresse est plus bizarre encore, avec des aventures extravagantes qui renchérissent sur les ténébreuses productions d'Anne Radcliffe, en un mot, avec Jean Sbogar[155]?
Ce blâme n'empêcha pas Nodier de déclarer dans sa préface de l'édition de 1832:
L'anonyme me porta bonheur… Des journalistes qui se crurent bien avisés, et qu'avait trompés je ne sais quel mélange d'ascétisme, d'amour et de philanthropie désespérée qui se confondent dans cette bluette (Jean Sbogar), en accusèrent Mme de Krudener… Je n'intervins pas dans ce combat qui ne pouvait durer longtemps.
Jean Sbogar aurait été complètement oublié si un nouvel artifice n'était intervenu quatorze mois plus tard. Le 17 octobre 1819, la Renommée annonça, «d'après les journaux anglais», que le prisonnier de Sainte-Hélène s'était occupé de ce roman deux jours: une nuit à le lire et quelques heures à l'annoter. «Cette apostille, venue de haut lieu, excita un instant de rumeur dans les bureaux de rédaction des feuilletons bonapartistes», et le roman devint célèbre en quelques jours. Le libraire, Gide fils, qui semble avoir beaucoup contribué à répandre cette nouvelle[156], lança à grand fracas une seconde édition dont la couverture porte en entier le nom de l'auteur. Cette révélation ne fut pas très prudente. Nodier ne jouissait pas d'un grand crédit auprès de la presse de l'opposition et, malgré tout le succès du livre, il fut de suite accusé de plagiat: Jean Sbogar, disait-on, était volé au Corsaire de Byron[157].
On avait raison et tort tout à la fois de le prétendre; car, s'il est vrai que Jean Sbogar a été écrit sous une influence étrangère, il n'en reste pas moins vrai que cette influence ne fut pas celle de Byron, malgré les ressemblances frappantes qui existent entre le poème anglais et le roman français. Jean Sbogar est inspiré des Brigands de Schiller, d'où procédait, par une voie différente, l'ouvrage de Byron[158].
Nodier sut se défendre de cette accusation. Il prétendit avoir ébauché son roman «en 1812, aux lieux mêmes qui l'ont inspiré»; donc, «Jean Sbogar avait quatre ou cinq ans de plus que son aîné d'invention»[159] (le Corsaire est du mois de janvier 1814!). Et ce n'était pas tout. Jean Sbogar avait réellement existé: les petits enfants des bords du golfe de Trieste vous l'attesteront quand vous prendrez la peine de les interroger sur ce sujet. La cour de justice qui le condamna était présidée par M. le comte Spalatin. «Je me vois obligé, disait Nodier dans sa préface de 1832, à déclarer que personne au monde n'a de plagiat à m'imputer dans cette affaire, si ce n'est, peut-être, le greffier des assises de Laybach en Carniole, l'honnête M. Repisitch, qui voulut bien me donner, dans le temps, les pièces de la procédure en communication pour y corriger quelques germanismes esclavonisés dont il craignait de s'être quelquefois rendu coupable dans la chaleur de la rédaction. Je proteste en outre que tout ce que j'ai pris dans son dossier se réduit à certains faits que je n'aurais pas pu mieux inventer, quand j'aurais été Zschocke.»
Et, dans ses Souvenirs de la Révolution et de l'Empire, Nodier raconta une conversation qu'il aurait eue avec Fouché, en Illyrie, au sujet de son héros:
La cour impériale venait de déposer sur son bureau le dossier d'un
arrêt en suspens qui attendait son aveu. C'était celui de ce fameux
Jean Sbogar, dont les journaux de Paris ont si bien prouvé que j'avais volé le type à lord Byron, par anticipation, sans doute. «Quel est cet homme?» me dit le gouverneur.
—Un bandit systématique, répondis-je; un homme à opinions exaltées, à idées excentriques et bizarres, qui s'est acquis au fond de la Dalmatie une réputation d'énergie et d'éloquence, accréditée par des manières distinguées et une figure imposante.
—A-t-il tué?
—Peut-être, mais à son corps défendant. Au reste, je n'en répondrais pas. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un brigand fort intelligent et fort résolu, dont le nom revient souvent dans la conversation du peuple.
—Assez, reprit le duc d'Otrante en jetant le dossier dans la corbeille, etc.[160]
Les biographes de Nodier crurent à cette histoire. Émile Montégut, dans sa belle étude qui reste toujours la première à consulter, affirme que Nodier avait «suivi de près les exploits et le procès de Jean Sbogar[161]»; de même que, dans son livre extrêmement intéressant sur _Charles Nodier et le groupe romantique, _M. Michel Salomon, ne se doutant pas combien sont suspectes les prétendues «pièces de la procédure» de «l'honnête M. Repisitch», alla jusqu'à proclamer Jean Sbogar «roman documentaire avant l'invention de ce mot[162]»! Sainte-Beuve lui-même, qui, pourtant, connaissait très bien son «biographié», se laissa tromper et n'hésita guère à dire, parlant du séjour de Nodier en Illyrie, que «_Jean Sbogar _et Smarra et Mademoiselle de Marsan furent, dès cette époque [«vers 1811»], ses secrètes et poétiques conquêtes[163]».
Il nous reste à examiner maintenant à quel point Nodier a su pousser la «couleur locale» dans la peinture qu'il a faite de son poétique aventurier dalmate, ce prétendu «personnage historique, dont la renommée aventureuse remplit encore les États vénitiens».
D'abord, le nom même de son héros n'est pas un nom dalmate, mais un nom tchèque. Nodier, qui aimait les vieux bouquins, le découvrit sans aucun doute, sur la couverture du Theologia radicalis par Jean Sbogar (Prague, 1698 et 1708).
En Illyrie, Nodier n'a vu que des choses toutes extérieures: le pays et les costumes, et il en a donné de très jolies descriptions dans son roman. Une trentaine d'années plus tard, Gérard de Nerval, visitant la Dalmatie, écrira en ces termes à un ami:
Je t'écris en vue de Trieste, ville assez maussade, située sur une langue de terre qui s'avance dans l'Adriatique, avec ses grandes rues qui la coupent à angles droits et où souffle un vent continuel. Il y a de beaux paysages, sans doute, dans les montagnes sombres qui creusent l'horizon; mais tu peux en lire d'admirables descriptions dans Jean Sbogar et dans Mademoiselle de Marsan de Charles Nodier; il est inutile de les recommencer[164].