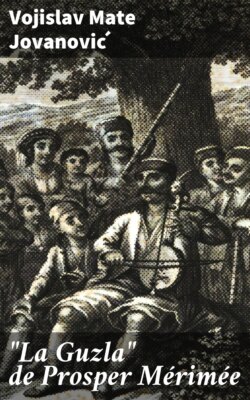Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MME DE STAEL ET LA POÉSIE «MORLAQUE»
ОглавлениеAprès avoir parcouru toute l'Italie dans leur promenade poétique, Corinne et lord Nelvil arrivent à Venise. Ils montent au campanile de Saint-Marc et contemplent la «Reine de l'Adriatique» dans toute sa splendeur. Ils regardent, ensuite, vers les rives lointaines de l'Istrie et de la Dalmatie, et Corinne, cette improvisatrice admirable, impulsive et éloquente, parle ainsi à son ami:
«Cette Dalmatie que vous apercevez d'ici, et qui fut autrefois habitée par un peuple si guerrier, conserve encore quelque chose de sauvage. Les Dalmates savent si peu ce qui s'est passé depuis quinze siècles, qu'ils appellent encore les Romains les tout-puissants. Il est vrai qu'ils montrent des connaissances plus modernes, en vous nommant, vous autres Anglais, les guerriers de la mer, parce que vous avez souvent abordé dans leurs ports; mais ils ne savent rien du reste de la terre. Je me plairais à voir, continua Corinne, tous les pays où il y a dans les mœurs, dans les costumes, dans le langage, quelque chose d'original. Le monde civilisé est bien monotone, et l'on en connaît tout en peu de temps; j'ai déjà vécu assez pour cela… Mais donnons encore, poursuivit-elle, un moment à cette Dalmatie; quand nous serons descendus de la hauteur où nous sommes, nous n'apercevrons même plus les lignes incertaines qui nous indiquent ce pays de loin aussi confusément qu'un souvenir dans la mémoire des hommes. Il y a des improvisateurs parmi les Dalmates; les sauvages en ont aussi; on en trouvait chez les anciens Grecs; il y en a presque toujours parmi les peuples qui ont de l'imagination et point de vanité sociale; mais l'esprit naturel se tourne en épigrammes plutôt qu'en poésie dans les pays où la crainte d'être l'objet de la moquerie fait que chacun se hâte de saisir cette arme le premier; les peuples aussi qui sont restés plus près de la nature ont conservé pour elle un respect qui sert très bien l'imagination. Les cavernes sont sacrées, disent les Dalmates; sans doute qu'ils expriment ainsi une terreur vague des secrets de la terre. Leur poésie ressemble un peu à celle d'Ossian, bien qu'ils soient habitants du Midi; mais il n'y a que deux manières très distinctes de sentir la nature: l'aimer comme les anciens, la perfectionner sous mille formes brillantes, ou se laisser aller, comme les bardes écossais, à l'effroi du mystère, à la mélancolie qu'inspire l'incertain et l'inconnu[87].»
Cette page de Corinne est intéressante à plus d'un point de vue. Elle démontre d'abord que Mme de Staël, malgré toute la germanisation de son esprit, ne saisissait ni le but des études entreprises sur la poésie populaire par les savants allemands de cette époque; ni les beautés de cette poésie dont les recueils succédaient aux recueils; ni l'importance de tout un courant littéraire influencé par les vieux chants nationaux des «sauvages qui ont de l'imagination et point de vanité sociale». Mais nous reviendrons sur ce sujet.
Ensuite, ce qui est encore plus important pour nous, cette page témoigne que Mme de Staël connaissait bien l'ouvrage de la comtesse de Rosenberg. En effet, ce qu'elle dit de la poésie dalmate, par la bouche de Corinne, est l'expression de réflexions faites après la lecture des Morlaques.
M. Jean Skerlitch, d'après qui nous citons cette page[88], conjecture—sous réserve d'ailleurs—que l'auteur de Corinne devait connaître la poésie «morlaque» par les traductions de Herder et de Goethe dont nous avons déjà parlé.
Il est parfaitement vrai que Mme de Staël connaissait la Triste ballade de la noble épouse d'Asan-Aga, qu'elle avait lue dans la traduction de Goethe, et cela avant la publication de Corinne. «Je suis ravie de la Femme morlacque», écrivait-elle, en 1804, à l'illustre poète, dans un de ses billets conservés à Weimar, et publiés depuis par M. F. Th. Bratranek[89]. Elle en était ravie, mais elle ne savait pas que la Femme morlaque fût une production des sauvages «qui ont de l'imagination et point de vanité sociale». Elle pensait que cette pièce était une poésie originale de Goethe, car, six ans après, en 1810, elle écrivait au chapitre XIII de la deuxième partie de son livre De l'Allemagne: «Il [Goethe] devient quand il veut, un Grec [elle faisait allusion à la «Fiancée de Corinthe»], un Indien [«Dieu et la Bayadère»], un Morlaque[90]» Il est hors de doute qu'elle pensait à la Triste ballade serbo-croate.
Il est moins probable que Mme de Staël ait remarqué les poèmes «morlaques» dans les Volkslieder de Herder, car, comme nous l'avons dit, et comme nous le mettrons plus tard en lumière, elle n'admirait pas beaucoup ce genre de poèmes et le recueil de Herder tout particulièrement[91].
Mais ce qui est certain, c'est que Mme de Staël avait lu les Morlaques de la comtesse de Rosenberg, et qu'elle jugeait les Dalmates d'après le tableau qu'en donne cet auteur. Elle ne suspectait pas l'authenticité des ballades populaires qui s'y trouvent et qui «ressemblent un peu à celles d'Ossian, bien que les Morlaques soient habitants du Midi». Toutes les allusions qu'elle fait à la Morlaquie se rapportent exclusivement au roman dalmate que nous connaissons. En voici des preuves:
LES MORLAQUES, pp. 8-9: CORINNE, liv. XV, chap. IX:
Les cavernes de l'Herzovaz cachaient Les cavernes sont sacrées, ses trésors, et les vautours dévoraient disent les Dalmates… au grand air les cadavres des Turcs tombés sous sa main… La pierre qui couvre ses cendres durera moins que sa mémoire, et notre postérité marquera toujours la place de ses restes sacrés.
Ensuite, pp. 9 et 52:
Ainsi les eaux de la Kerka, après avoir Les Dalmates savent si peu ce menacé les arcs des puissants qui s'est passé depuis quinze et renversé les ponts de Roncislap, siècles, qu'ils appellent encore se répandent et se calment dans le lac les Romains les Proclian. tout-puissants.
[En note: «Les Morlaques dans leurs chansons indiquent par ce mot les anciens Romains.»]
……………………………….
Quelque temps après eux, les puissants de l'Italie traversèrent la mer et parurent sur nos côtes.
Enfin, p. 167:
Nous les y suivîmes et, conduits par Il est vrai qu'ils montrent des les guerriers de la mer, nous connaissances plus modernes, en brulâmes leur flotte, nous renversâmes vous nommant, vous autres la ville et il ne resta de toutes les Anglais, les guerriers de la deux le lendemain que des cendres et mer, parce que vous avez des pierres. souvent abordé dans leurs ports.
[Note: «Le Morlaque indiquait de cette manière les Anglais.»]
Il faut noter que les cavernes ne sont et ne furent jamais «sacrées» pour les Dalmates; qu'ils n'appellent pas les Italiens «les tout-puissants», mais leur donnent des noms moins respectueux tels que «foi de chien» ou «foi de Latin»; de même que les Anglais ne sont nullement pour eux les «guerriers de la mer». Toutes ces expressions poétiques furent créées de toutes pièces par la comtesse de Rosenberg, et c'est dans les Morlaques que Mme de Staël les a prises.
Nous avons déjà dit que les ballades prétendues dalmates qui se trouvent dans les Morlaques sont de pure fabrication vénitienne; ainsi, l'appréciation qu'en donne Mme de Staël ne porte pas sur la vraie poésie serbo-croate. Mais au point de vue pratique, il importait peu qu'elles fussent authentiques: cette page avait son importance pour avoir fait mentionner, en 1807, dans un livre à grand tirage et qui eut une grande vogue, l'existence d'improvisateurs parmi les Dalmates et celle d'une poésie nationale slave qui «ressemble un peu à celle d'Ossian».
Prosper Mérimée avait-il lu cette page de Corinne? Et s'il l'avait lue, en avait-il gardé le souvenir? Il est difficile de le prétendre ou de le nier, mais il est aisé de voir, une fois de plus, que l'auteur de la Guzla n'était ni le «seul» ni le «premier» Français qui «pût trouver quelque intérêt dans ces poèmes sans art, production d'un peuple sauvage», comme le relate si candidement la spirituelle préface de la Guzla.
Ce passage de Corinne, peut-être inconnu de Mérimée, ne le fut pas de tout le monde. Le Globe, par exemple, vingt ans après, exprime le désir de voir paraître en France une traduction de poèmes des Dalmates, «aussi célèbres chez eux qu'ils sont inconnus parmi nous»; il va jusqu'à dire: «Il semble que la guzla des Slaves sera bientôt aussi célèbre que la harpe d'Ossian[92]». Nous croyons ne pas nous tromper en reconnaissant là comme un écho d'une leçon entendue à l'Arsenal; un regard que dirige la blanche main de Corinne, montrant du haut du campanile les rives incertaines de la Dalmatie.
§6