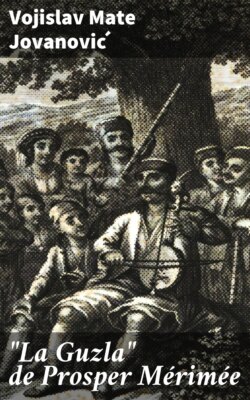Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHARLES NODIER EN ILLYRIE
ОглавлениеLe 20 septembre 1812, le comte Bertrand, premier gouverneur des provinces illyriennes, signa l'arrêt par lequel M. Ch. Nodier, homme de lettres à Paris, était nommé bibliothécaire de la ville de Laybach. En même temps, il confia à l'auteur du Peintre de Saltzbourg la direction de la partie française du Télégraphe officiel. Ce fut M. de Tercy, secrétaire général de l'Intendance en Illyrie, qui demanda et obtint cette place pour son futur beau-frère «dans le double but de lui créer une position et de lui faire partager son exil, fort supportable du reste[118]».
Après avoir difficilement pourvu aux frais d'un long voyage[119], Nodier partit de Paris, en pauvre émigré, à la fin de novembre, emmenant avec lui sa jeune femme malade[120] et son enfant de dix-huit mois qu'il faillit perdre dans une tourmente de neige au Mont-Cenis; cette enfant devait être plus tard la «Notre-Dame de l'Arsenal» à laquelle Alfred de Musset adressera de si jolis vers.
Nodier arriva à Laybach vers la fin de décembre 1812[121]. «J'ai vu enfin l'Illyrie, écrivait-il alors à son ami Charles Weiss, bibliothécaire à Besançon, et à travers des neiges de deux pieds j'ai gagné les rigoureux sommets de la Carniole. À peine avais-je cessé de rencontrer l'heureux habitant de l'Adriatique légèrement vêtu d'un frac de toile lilas, et la tête couverte de son grand chapeau où flottent des rubans de toutes couleurs, que j'ai aperçu l'Istrien frileux qui grelotte sous sa mante de poils de chèvre et son bonnet de laine à trois pièces[122].»
Ce n'est parmi ces paysans exotiques qu'il vécut dans ce nouveau pays. Il habita Laybach et se trouva «au milieu d'une cour qui éclipsait celle de plus d'un roi d'Europe». En décrivant à son ami Weiss un dîner chez le comte de Chabrol, qui remplaçait le gouverneur, il disait qu'il y avait été le seul sans dentelles, sans diamants, sans épée, et qu'il «s'aperçut alors qu'il était encore à Paris[123]».
Il ne s'occupa point de politique à Laybach, lui, l'éternel conspirateur que redoutait Napoléon[124]. «Les éventualités de la possession m'étaient à peu près étrangères», dit-il à propos de ses conversations avec Fouché, conversations qu'il inséra dans les Souvenirs et portraits, et qui sont fort sujettes à suspicion[125]. Ses principales occupations se réduisaient à la direction d'une bibliothèque et à la rédaction du Télégraphe officiel[126].
Le Télégraphe officiel datait de 1810: Nodier ne l'avait donc pas fondé, comme le prétendent Sainte-Beuve[127], Quérard[128] et M. Georges Vicaire[129]. Trente mois avant l'arrivée du charmant conteur à Laybach, un arrêté du gouverneur, instituant la censure, avait ordonné qu'un journal serait publié par les soins de l'Intendance[130]; le 28 juillet 1810, un prospectus fut lancé pour annoncer la prochaine apparition du Télégraphe officiel des provinces illyriennes. Ce journal devait avoir quatre éditions: française, italienne, allemande et slave[131]; il devait paraître deux fois par semaine, in-4°, et contenir, outre les actes publics, «toutes les nouvelles qui pourront influer sur l'esprit des lecteurs et sur les intérêts du commerce».—Remarquons que Nodier (qui, personnellement, ne revendique pas le nom de fondateur du Télégraphe comme le font pour lui ses biographes) mentionne cependant dans ses Souvenirs[132] qu'il fut celui qui conseilla à Fouché de publier aussi une «édition en slave vindique» et que Fouché fut enchanté de cette proposition. Comme nous le disions tout à l'heure, la chose était résolue plus de deux ans avant l'arrivée de Nodier à Laybach. Du reste, il ne fut que «directeur chargé de la rédaction du texte françois[133]»; les autres éditions avaient leurs rédacteurs spéciaux.
On ne trouve ce journal ni à la Bibliothèque Nationale, ni dans aucune autre bibliothèque de France. Mais il en existe à Laybach deux collections, toutes deux, il est vrai, incomplètes: au Musée «Rudolphinum» et à la Bibliothèque du Lycée. Nous n'avons pu en obtenir communication, aussi nous bornerons-nous à reproduire la description faite par un lecteur plus heureux, description utilisée par les biographes et bibliographes de Nodier.
«Ce journal (in-4°, bi-hebdomadaire) comprend deux parties. Dans la première se trouvent les lois, décrets et autres actes de l'autorité, ainsi que les dépêches officielles, matériaux fort intéressants pour celui qui entreprend l'étude de cette période historique.
«La partie non officielle ne présente pas moins d'intérêt: car elle était rédigée par un écrivain qui depuis est devenu justement célèbre: Charles Nodier qui, bien que fort jeune encore, avait été nommé conservateur de la Bibliothèque de Laybach et rédacteur du Télégraphe.
«Nous ne trouvons, il est vrai, sa signature qu'au bas d'avis indiquant au lecteur les moyens de faire parvenir à la direction les vingt francs, prix de l'abonnement. Mais on reconnaît sans peine l'auteur des articles qui paraissaient dans le corps du journal. Sous cette rubrique toujours neuve; «on nous écrit» de Palerme, ou du Caire, ou de Berlin… nous retrouvons toujours la même langue pure et élégante, le même style limpide et brillant, une argumentation serrée et ingénieuse qui ne laisse aucun doute sur l'identité des nombreux correspondants que le Télégraphe officiel des provinces illyriennes devait entretenir à l'étranger.
«Enfin, sous le titre de «Variétés», nous voyons paraître des études fort curieuses sur les peuples slaves, leurs mœurs, leur langue, leur littérature, et des articles de critique littéraire ou théâtrale, qui sont dus à la plume féconde qui devait produire plus tard tant de morceaux délicats.
«Le Télégraphe officiel dura autant que l'occupation française. Le dernier numéro paru a Laybach est du 24 août; il fallut reculer devant les armées autrichiennes: la rédaction du journal, transportée à Trieste, fit encore paraître huit numéros (69 à 76) dont le dernier est du 26 septembre; ces derniers numéros étaient imprimés en trois langues: français, allemand et italien. C'est ce qui a donné lieu à la légende communément admise du journal polyglotte[134]. Il faut mettre cette légende au rang de beaucoup d'autres et constater que Nodier n'a pas cherché à éclipser le cardinal Mezzofanti: il s'est contenté d'écrire dans sa langue maternelle des pages charmantes qui méritaient mieux que de dormir oubliées dans la poussière d'une bibliothèque étrangère[135].»
N'ayant pas eu entre les mains le Télégraphe illyrien, nous ne savons rien de ces articles de Nodier. M. Tomo Matić, qui avait consulté la collection de la Bibliothèque du Lycée, et qui en a donné quelques extraits dans l'Archiv für slavische Philologie, ne s'intéressa qu'aux écrits relatifs à la poésie populaire serbo-croate et à la littérature ragusaine; il garda sur le reste le plus complet silence. À en juger d'après la plus grande partie de ce que M. Matić a publié comme de l'inédit[136], et dont on va énumérer de suite les cinq réimpressions postérieures à 1813, Nodier insérait volontiers, dans ses œuvres ainsi qu'ailleurs, ses articles du Télégraphe. Seulement en a-t-il agi de même pour tous? C'est ce que nous nous demandons, avant qu'une réponse ne parvienne de Laybach[137].
Nodier n'était pas très satisfait de son séjour dans la capitale illyrienne. Il devait attendre deux mois ses appointements de bibliothécaire et six mois ses appointements de journaliste, «avec quarante-deux francs, sans plus[138]». D'autre part, le journal l'obligeant à abandonner, après un mois, la direction de la Bibliothèque[139], sa situation devint alors beaucoup moins brillante qu'on ne lui avait laissé espérer. Il fallut créer pour lui de nouveaux postes et le dispenser de se faire faire un costume de cour.
C'est lui qui raconte ainsi sa vie à Laybach, mais il se peut qu'il ait dû renoncer à la direction de la Bibliothèque pour une autre raison. La municipalité de Laybach n'avait pas cessé de protester contre sa nomination: on avait un bibliothécaire allemand[140] et Nodier ne comprenait pas les langues dans lesquelles était écrite la plus grande partie des livres de la Bibliothèque.
D'après M. Matić, on voit que Nodier publia au Télégraphe officiel, du 11 avril au 20 juin 1813, quatre articles intitulés «Poésies illyriennes»; il en fera—M. Matić l'ignore—deux feuilletons pour le Journal des Débats, dès son retour à Paris, c'est-à-dire quelques mois plus tard[141].
Dans le premier, il se plaint que l'étude de la poésie illyrienne soit trop négligée: «Pourquoi, dit-il, un homme instruit, spirituel et sensible ne s'occuperait-il pas de recueillir ces vieux monuments de la poésie illyrique et de les faire imprimer en corps? Ce serait peut-être le moyen de faire renaître l'amour de cette belle langue nationale, qui a aussi ses classiques et ses chefs-d'œuvre[142].» Comme l'a bien remarqué M. Louis Leger[143], Nodier songe ici aux vieux monuments de la littérature ragusaine, dont il a entendu parler, et qu'il confondait avec la poésie populaire, dont il a pu lire un spécimen dans le Voyage en Dalmatie. À cette époque, il connaissait fort bien cet ouvrage, car il en parle dans son premier article, et, dans le troisième et le quatrième, il donne une analyse de la Triste ballade de la noble épouse d'Asan-Aga.
Charles Nodier ne savait ni la langue serbo-croate, dont il voulait présenter les chefs-d'œuvre littéraires au public français, ni la langue slovène, parlée à Laybach. Il ne se doutait même pas de la différence qui existe entre elles: ainsi les deux langues ne furent pour lui qu'un seul et même «illyrien». Il ne resta pas longtemps dans ce milieu, à cette époque plus allemand que slave: neuf mois en tout[144]; il lui manqua le temps d'apprendre bien des choses sur les indigènes de ce pays.
Mais, malgré son tempérament extraordinairement fantaisiste, Nodier était un homme infatigable,—ne copiait-il pas Rabelais pour apprendre le français, et ne lisait-il pas jusqu'à sept épreuves de ses ouvrages[145]?—Le temps passé par lui à Laybach ne fut pas complètement perdu. Il se mit en «nombreux rapports avec ces hommes studieux et zélés pour la science, qui sont partout l'élite des peuples, et que l'Illyrie compte par centaines[146]»; il soumit même au comte Bertrand l'idée de créer une Académie libre illyrienne[147]. Ses amis lui avaient communiqué certains livres italiens où il y avait bien des choses à apprendre: en particulier «les savants mémoires d'Appendini sur les antiquités de Raguse et la littérature illyrienne[148]», mémoires d'après lesquels il traduisit, dans son quatrième article (20 juin 1813), le Ver luisant d'Ignacio Giorgi, petit poème d'Ignace Gjorgjić, poète ragusain; il devait en donner plus tard une nouvelle traduction[149].
Il y a dans nos Alpes helvétiques, disait-il dans un de ces articles qui sont toujours agréables à lire[150], des chansons simples et touchantes, qui ne consacrent pas le souvenir des grandes guerres, comme celles du fils de Fingal, parce que la guerre a rarement troublé la paix des chalets, mais qui peignent merveilleusement les sentiments les plus doux de l'homme et qui ne le cèdent point du tout sous ce rapport aux plus beaux chants de l'Homère de Selma. Je retrouve le même genre de poésie dans tout ce qui reste des traditions illyriennes, à cette différence près que la pureté du ciel, la beauté des productions, la grandeur des souvenirs et l'heureux voisinage de la Grèce ont dû donner au barde des Alpes Juliennes une foule d'inspirations que le nôtre n'a pas reçues. Qu'on se représente d'abord le chantre morlaque, avec son turban cylindrique, sa ceinture de soie tissue à mailles, son poignard enfermé dans une gaine de laiton garnie de verroterie, sa longue pipe à tube de cerisier ou de jasmin, et son brodequin tricoté, chantant le pismé ou la chanson héroïque en s'accompagnant de la guzla, qui est une lyre à une seule corde composée de crins de chevaux, entortillés. C'est ordinairement après les premières heures du soir que le Morlaque se promène sur la montagne, en racontant dans son chant monotone, mais solennel, les exploits des anciens barons slaves. Il ne voit pas les ombres de ses pères dans les nuages, mais elles vivent partout autour de lui. Celle de l'homme hospitalier et fidèle, qui n'a point été désavoué par ses amis dans l'assemblée du peuple, et qui a été brave à la guerre, descend souvent à travers les rameaux des yeuses dans un rayon de la lune; elle tremble sur le gazon de sa tombe, la caresse d'une lumière douce, et remonte. Celle du méchant s'égare dans les lieux abandonnés; elle fréquente les sépultures, déterre les morts, ou, plus téméraire, va boire dans un berceau négligé de la nourrice, le sang des enfants nouveau-nés. Souvent un père épouvanté a rencontré le vampire tout pâle, les cheveux hérissés, les lèvres dégoûtantes, et le corps à demi enveloppé des restes de son linceul, penché sur la petite famille endormie, parmi laquelle, d'un regard fixe et affreux, il choisit une victime. Heureux s'il parvient à trancher alors d'un coup de son hanzar les jarrets du cadavre; car désormais celui-ci ne sortirait plus de son cercueil… C'est au milieu de ces prestiges que marche mon poète, car il est poète aussi, et ne se borne pas à répéter les chants connus. La douceur de sa langue harmonieuse, la liberté de son rythme qui n'admet ni la symétrie fatigante d'une césure obligée, ni le monotone agrément de la rime, lui permettent d'obéir à toutes ses inspirations et d'embellir de ses pensées la vieille ballade que la tradition lui a transmise.
Pour se faire une idée du chant morlaque, il faut l'avoir entendu. Fortis essaie de le décrire, mais il oublie une chose qui me paraît essentielle à dire, c'est qu'il ressemble très peu à la voix humaine… Je me souviens d'un voyage que je faisais de nuit sur les bords de l'Adriatique. La lune brillait de cette clarté bleue et immobile qu'on croirait ne lui avoir vue qu'en Italie; l'eau faisait un bruit long, mais très doux et très imposant, celui des mers qui ont peu de reflux. Les roues de la voiture criaient d'une manière uniforme sur le sable égal qui la balançait, et je quittais, fatigué de courses à pied et surtout de grands souvenirs, les plaines historiques de Campo-Formio. Je dormais à demi quand ce bruit étrange d'un chant morlaque frappa mon oreille et me transporta en imagination au milieu des concerts nocturnes de Puck, d'Ariel et de tous les lutins de Shakespeare, lorsque nouvellement sortis des fleurs et encore humides de rosée, ils forment des chants que les hommes n'ont jamais entendus. Je devais cette illusion à un postillon dalmate…
Ces bardes obscurs, dont le nom sera tout à fait ignoré de l'avenir, font le charme d'une nation vive, spirituelle, sensible, qui confine d'un côté à la patrie de Virgile, de l'autre à celle d'Homère et qui ne le cède ni à l'Italie ni à la Grèce antiques dans la beauté du territoire, dans la variété des sites, dans l'originalité des mœurs et des inspirations.
Mais les «études illyriennes» de Nodier furent de courte durée. Quelques mois plus tard, quand Fouché arriva à Laybach, la restitution des provinces illyriennes était, en secret, décidée. Au mois d'août 1813, on abandonna Laybach aux Autrichiens; en septembre, ce fut Trieste. Au commencement de novembre, Nodier se trouvait à Paris et donnait des articles au Journal des Débats[151]. Arrivèrent la chute de Napoléon et les Cent-Jours; c'est alors qu'il fit sa célèbre réponse à Fouché qui, se souvenant de leurs récentes relations en Illyrie, l'avait fait appeler et lui avait demandé ce qu'il désirait: «Cinq cents frans pour aller à Gand[152]!»
«Ce séjour en Illyrie, dit M. Émile Montégut, quelque court qu'il ait été, fut mieux qu'une aventure de plus à ajouter au roman si accidenté de sa jeunesse, car il eut une importance capitale sur ses destinées littéraires. C'est de là que sont sortis à diverses dates Jean Sbogar, Smarra et Mademoiselle de Marsan.»
Nous allons examiner de près cette influence «illyrienne».
§ 8