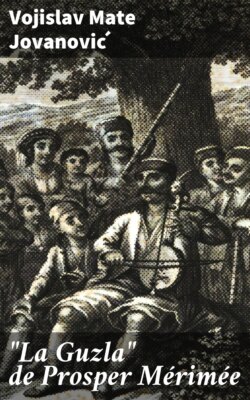Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«SMARRA»
ОглавлениеD'Illyrie encore Nodier rapporte Smarra, bizarre interprétation des bizarreries du cauchemar.
M. RENÉ DOUMIC, Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1907, p. 928.
Son séjour de huit mois à Laybach, de trente jours à Trieste «dans une pension allemande», valut à Nodier la réputation de se connaître aux choses d'Illyrie, réputation qui persista jusqu'à sa mort.
Une fois rentré à Paris, l'ancien rédacteur du Télégraphe officiel de Laybach fait réimprimer au Journal des Débats, sous le titre prétentieux de Littérature slave, ses feuilletons illyriens[167]. Quelques mois plus tard, ses articles sont déclarés dignes de foi par le traducteur français d'un ouvrage scientifique sur l'Illyrie et la Dalmatie[168]. Encouragé par le succès, Nodier va les réimprimer plusieurs fois encore[169]!
Ensuite, il rédige, pour le Journal des Débats (1er février 1815), une prétendue étude critique sur les différents ouvrages relatifs à l'Illyrie, parus dernièrement en France et à l'étranger. Il oublie ce qu'il leur doit lui-même, les déprécie tous et déclare avec une belle impertinence que «ces itinéraires sont improvisés par des écrivains estimables mais mal dirigés qui avaient pris tout au plus quelques notes fugitives sur les usages dont ils méconnaissaient le plus souvent le véritable objet, au milieu d'un peuple dont ils ignoraient jusqu'à la langue (sic)».
Après cette sévère critique, quoi de plus naturel qu'une confiance universelle en l'érudition slavicisante de Nodier.
L'année suivante (1816), il en reçut le premier témoignage: on le chargea de composer l'article sur Fortis pour la Biographie universelle de Michaud. Cet article est conservé dans la dernière édition du même dictionnaire.
En 1820, L. Rincovedro (est-ce un pseudonyme?), dans un article sur les romances espagnoles,—où il blâme l'hispanisme fantaisiste des frères Hugo,—espère que M. Ch. Nodier va donner bientôt sa traduction de poésies nationales des Morlaques, «qui chantent encore le succès de Scander-Beg et les malheurs de Spalatin-Beg[170]». Quelques mois plus tard, les journaux annoncent comme un événement littéraire la prochaine publication d'un poème traduit de l'esclavon par M. Nodier. Les Annales de la littérature et des arts, qui se font l'écho de ce bruit, demandent à leur estimable collaborateur son manuscrit et en détachent une page «qui pourra donner une idée de l'ouvrage original et du mérite de la traduction[171]».
En 1836, quand on a besoin d'un article sur la «langue (sic) et la littérature illyrienne» pour le Dictionnaire de la conversation, c'est encore à M. Ch. Nodier, de l'Académie françoise, que l'on confie ce travail. Il envoie, naturellement, ses vieux feuilletons, qui auront du crédit même en 1856, quand on les réimprimera dans la seconde édition de ce répertoire.
Vers la même époque, l'érudit Depping, qui écrivait au Bulletin des sciences historiques rédigé par MM. Champollion, qui savait les langues slaves, et de plus avait composé, en 1813, un article sur la poésie ragusaine pour les Annales des Voyages de Malte-Brun, cite comme le meilleur spécimen de la poésie «morlaque»… Jean Sbogar de M. Ch. Nodier[172].
En 1840, un écrivain polonais de talent, Christian Ostrowski, croit devoir dédier à l'auteur de Smarra un article paru dans la Revue du Nord, sur le poète ragusain Givo Gungulié (Jean Gondola), dont le sympathique bibliothécaire de l'Arsenal avait doctoralement parlé à plusieurs reprises.
Vingt ans après la mort de Nodier, la Biographie universelle de Michaud rend hommage à ses «recherches intéressantes sur les productions littéraires de la Dalmatie, alors complètement ignorées»; recherches «dont quelques-unes portent l'empreinte profonde de ses conquêtes en ce genre[173]».
Aujourd'hui même, d'éminents académiciens croient sérieusement que c'était «d'Illyrie encore» que Nodier rapporta Smarra.
Et toutefois Nodier, qui a mystifié avec ses études illyriennes au moins autant de monde que Mérimée avec les siennes,—car après tout, s'il joua l'érudit, ce fut uniquement dans l'intention de railler la crédulité contemporaine,—Nodier, disons-nous, n'obtint jamais dans ce genre la célébrité de l'auteur de la Guzla, dont il était, comme on le verra, non seulement le prédécesseur, mais aussi en quelque sorte l'initiateur.
C'est ainsi qu'il publia, en 1821, un livre assez étrange: prétendue traduction de «l'esclavon», intitulé Smarra, ou les démons de la nuit, songes romantiques[174].
Dans la préface, il nous raconte que cet ouvrage, dont il «n'offrait que la traduction», est moderne et même récent. «On l'attribue généralement en Illyrie, dit-il, à un noble Ragusain qui a caché son nom sous celui de comte Maxime Odin, à la tête de plusieurs poèmes du même genre. Celui-ci, dont je dois la communication à l'amitié de M. le chevalier Fédorovich-Albinoni, n'était point imprimé lors de mon séjour dans ces provinces. Il l'a probablement été depuis.»
Il existait à cette époque un certain comte KREGLIANOVICH-Albinoni, auteur d'un mémoire sur la Dalmatie, que Nodier connaissait, puisqu'il en a parlé, en 1813, dans les numéros 15 et 16 du Télégraphe officiel de Laybach, et dans le Journal des Débats du 1er février 1815; mais un «chevalier FÉDOROVICH-Albinoni» n'a jamais existé pour la raison bien simple que le nom de Fédorovich n'est pas serbo-croate mais russe, tandis que la famille d'Albinoni était une famille italo-dalmate. Nodier a donc forgé un nom imaginaire, et lui a donné un air d'authenticité, en le modelant sur le nom qu'il avait cité plusieurs fois auparavant et dont personne ne pouvait mettre en doute l'existence.
Comme il l'avait prétendu en 1819, au Journal des Débats, au sujet du Vampire, nouvelle faussement attribuée à Byron, Nodier affirma de nouveau que smarra n'est que «le nom primitif du mauvais esprit auquel les anciens rapportaient le triste phénomène du cauchemar. Le même mot, disait-il, exprime encore la même idée dans la plupart des dialectes slaves, chez les peuples de la terre qui sont les plus sujets à cette affreuse maladie. Il y a peu de familles morlaques où quelqu'un n'en soit tourmenté[175]». Et après avoir donné cette explication qui a si bien l'air savante, il se met à broder dans son «poème esclavon» une étrange histoire sur un thème non moins étrange.
Il y a un moment où l'esprit suspendu dans le vague de ses pensées… Paix!… La nuit est tout à fait sur la terre. Vous n'entendez plus retentir sur le pavé sonore les pas du citadin qui regagne sa maison, ou l'ongle armé des mules qui arrivent au gîte du soir: le bruit du vent qui pleure ou siffle entre les ais mal joints de la croisée, voilà tout ce qui vous reste des impressions ordinaires de vos sens, et au bout de quelques instants, vous imaginez que ce murmure lui-même existe en vous. Il devient une voix de votre âme, l'écho d'une idée indéfinissable, mais fixe, qui se confond avec les premières perceptions du sommeil. Vous commencez cette vie nocturne qui se passe (ô prodige!…) dans des mondes toujours nouveaux, parmi d'innombrables créatures dont le grand Esprit a conçu la forme sans daigner l'accomplir, et qu'il s'est contenté de semer, volages et mystérieux fantômes, dans l'univers illimité des songes. Les Sylphes, tout étourdis du bruit de la veillée, descendent autour de vous en bourdonnant. Ils frappent du battement monotone de leurs ailes de phalènes vos yeux appesantis, et vous voyez longtemps flotter dans l'obscurité profonde la poussière transparente et bigarrée qui s'en échappe, comme un petit nuage lumineux au milieu d'un ciel éteint. Ils se pressent, ils s'embrassent, ils se confondent, impatients de renouer la conversation magique des nuits précédentes, et de se raconter des événements inouïs qui se présentent cependant à votre esprit sous l'aspect d'une réminiscence merveilleuse[176].
C'est pendant une nuit semblable que le jeune Lorenzo, endormi auprès de la belle Lisidis, dans une antique villa au bord du lac Majeur, a l'imagination hantée des rêves les plus bizarres: il se croit transporté en Thessalie; là, il écoute les discours d'un prétendu ami, Polémon, qui lui raconte qu'il est sans cesse poursuivi par les démons de la nuit et surtout par Smarra, roi des terreurs nocturnes. Le narrateur Lorenzo, qui se croit Lucius—Lucius de l'Âne d'Or—se rend ensuite à un repas voluptueux auquel assistent également Polémon et son esclave favorite, Myrrthé et les belles sorcières, Théis et Thélaïre. Les sépulcres s'ouvrent; des morts affamés sortent de leurs cercueils; ils déchirent les vêtements des cadavres, dévorent les cœurs et s'abreuvent de sang. L'affreux festin commence dans les vapeurs du vin et les caresses des enchanteresses; des fantômes s'y mêlent, froids reptiles, salamandres «aux longs bras, à la queue aplatie en rame», monstres sans couleur et sans forme, insectes invisibles comme la pluie. Tous s'endorment et, pendant leur sommeil, Smarra met à mort Polémon et Myrrthé; les Thessaliens accusent Lucius de les avoir tués. Sa tête tombe sous la main du bourreau et «mord le bois humecté de son sang fraîchement répandu»; les chauves-souris la caressent en lui chuchotant: «Prends des ailes!» Et voici que s'envole la tête de Lorenzo par je ne sais quels lambeaux de chair qui la soutiennent à peine… jusqu'au moment où la voix de la belle Lisidis réveille cette «victime d'une imagination exaltée, qui a transporté l'exercice de toutes ses facultés sur un ordre purement intellectuel d'idées», comme nous l'explique quelque part l'auteur.
En 1832, Nodier déclara que ce récit fantastique, n'était qu'un pastiche du premier livre de l'Âne d'Or, dans lequel, sauf quelques phrases de transition, tout appartient à Homère, à Théocrite, à Virgile, à Catulle, à Stace, à Lucien, à Dante, à Shakespeare, à Milton. «Mais, ajouta-t-il amèrement, le nom sauvage de l'Esclavonie prévint les littérateurs de ce temps (1821) contre tout ce qui pouvait arriver d'une contrée de barbares[177].»
Il avait raison dans une certaine mesure. En réalité, rien n'est moins «esclavon» que ces hallucinations littéraires que Mérimée, son successeur à l'Académie française, appellera un jour «le rêve d'un Scythe raconté par un poète de la Grèce». Quoi qu'en dise É. Montégut[178], Nodier, à coup sûr, n'a pu trouver une inspiration suffisante pour un conte de cette nature, ni dans le caractère national des «Esclavons», ni dans leur littérature, ni dans leurs traditions—qu'il ne connaissait pas, du reste—ni dans le caractère sauvage des paysages dalmates qu'il avait vus et qu'il avait décrits dans Jean Sbogar. Quant à l'assertion émise par lui: d'avoir fait dans Smarra un travail de compilateur, plaquant des passages de Théocrite, Virgile, Shakespeare, etc., sur un fond emprunté à Apulée, cette assertion, à notre avis, ne doit être acceptée que sous les plus expresses réserves. Nodier n'était-il pas l'auteur d'une brochure intitulée les Pensées de Shakespeare, dont un tiers appartient en effet au poète anglais, mais dont les deux autres ne sont dus qu'à la plume de leur prétendu traducteur français?
Dans quelle mesure Smarra fut-il un pastiche de l'Âne d'Or? C'est ce que nous ne pouvons décider, mais il nous semble que même au cas où l'on pourrait prouver qu'il y a imitation, la principale question n'est pas là. Peu importe, en effet, que la fantaisie de Nodier se trouve apparentée à la fiction antique alors que l'écrivain ne faisait après tout que satisfaire au goût de l'époque.
M. André Le Breton, dans sa remarquable étude sur Balzac, a déjà rattaché d'une façon péremptoire la nouvelle de Nodier à cette «école de cauchemar» ou «genre frénétique» qui florissait en France de 1820 à 1830[179]. Smarra était le descendant direct de la littérature d'épouvante inaugurée en Angleterre vers 1794 par Mrs. Anne Radcliffe (1764-1823)[180]; par M. G. Lewis (1775-1818), auteur du Moine (que Nodier cite en tête du chapitre VI de Jean Sbogar) et éditeur des Histoires terrifiantes, recueil de ballades anglaises et étrangères[181]; enfin, par l'Irlandais Ch. Robert Maturin (1782-1824), auteur de Melmoth le vagabond, bizarre écrivain dont Nodier traduisit, avec son ami Taylor, la tragédie de Bertram (1821)[182]. Malgré son caractère peu français, le «genre frénétique» obtint en France un succès fou et contribua, pour une part, au développement du roman réaliste. Balzac lui paya son tribut dans ses premiers romans: l'Héritière de Birague, le Centenaire ou les deux Beringheld, le Vicaire des Ardennes (tous les trois de 1822); exemple suivi par Victor Hugo dans Han d'Islande (1823) et Bug-Jargal (1825). Bien plus, ce fameux «grotesque» préconisé par Hugo dans la Préface de Cromwell n'était qu'une conséquence des années passées à cultiver le «genre frénétique[183]».
Ce genre convenait au goût maladif et passager de l'époque où le romantisme apparaissait à peine; en haine des dieux et des héros gréco-romains, froids et impassibles, on se noyait volontairement dans les ténèbres de la magie du vampirisme barbare[184].
Ce goût, qui devait s'accroître, puis se calmer, assura dès 1829 le grand succès des contes fantastiques de Hoffmann[185]; pour quelques-uns, même, l'attrait du «terrifiant» se doublait du plaisir de la mystification et c'est ainsi que la nouvelle «à faire peur» devint un genre fin et agréable par excellence. Nous n'avons pas besoin de dire que l'auteur de la Guzla y excella.
La fureur du «frénétique» était un des points les plus vulnérables de la nouvelle école; les adversaires du romantisme ne la pardonnaient pas facilement. Henri de Latouche, dans son poème burlesque des Classiques vengés, se moque agréablement de ce genre aux dépens de V. Hugo:
Dites que si, le soir, sous des porches gothiques,
L'Angelus réunit deux auteurs romantiques,
Le plus naïf des deux dit à l'autre innocent:
Monsieur a-t-il goûté l'eau des mers et le sang?
A-t-il pendu son frère? Et lorsque la victime
Rugissait palpitante au-dessus d'un abîme,
A-t-il, tranchant le nœud qui l'étreint sans retour,
Vu la corde fouetter au plafond de la tour[186]?
Cette satire est de 1825, Han d'Islande de 1823, Smarra de 1821; ce n'est donc pas sans raison qu'un autre ennemi de cette littérature macabre, accusa Nodier d'avoir inauguré la série[187].
Du reste, Smarra agit directement: Victor Hugo s'en souvint dans la Ronde du Sabbat, qu'il dédia,—ce serait une preuve suffisante,—«à M. Charles N.»:
Goules dont la lèvre
Jamais ne se sèvre
Du sang noir des morts!…
Psylles aux corps grêles
Aspioles frêles…
Volez oiseaux fauves,
Dont les ailes chauves,
Aux ciels des alcôves
Suspendent smarra[188].
En 1835, un certain M. Brisset, donna un conte poétique, le Mauvais œil, tradition dalmate, qui n'est autre chose qu'un Smarra plus farouche et plus lyrique encore; l'imitation y va quelquefois jusqu'au plagiat. (Urbain Canel, éditeur.) De même que, beaucoup plus tard, Théophile Gautier se rappela Nodier et sa nouvelle dans les «fantasmagories confusément effrayantes et vaguement horribles» et les «malaises causés par les visions nocturnes», dont est remplie sa Jettatura[189]. La ressemblance des sujets n'est pas accidentelle; en effet, à la page 89 de l'édition originale (Hetzel, 1837, in-16), Gautier parle du smarra qui, «offusqué, s'enfuit en agitant ses ailes membraneuses, lorsque le jour tire ses flèches dans la chambre, par l'interstice des rideaux». Pour prouver encore avec plus d'évidence que Nodier fut le guide de V. Hugo et de Gautier dans ces régions d'épouvanté, disons que ce mot de smarra, employé par ces derniers, ne figure dans aucun dictionnaire, pas même dans celui de Nodier. Par conséquent, ce vocable prétendu esclavon ne put être emprunté qu'au «comte Maxime Odin».
Comme nous avons eu occasion de le dire au cours de ce chapitre, cette «bizarre interprétation des bizarreries du cauchemar» n'a rien de commun avec les croyances illyriennes; elle ne fut pas composée en Illyrie et si le volume qui la contient ne renfermait pas d'autres poèmes, nous n'en parlerions que pour signaler la fausseté de cet état civil auquel on fait toujours crédit[190].
À Smarra succède une dissertation très ingénieuse, qui tend à prouver que le rhombus dont se servaient les magiciennes de l'antiquité, était ce jouet dernièrement renouvelé sous le nom de diabolo, jouet qui faisait fureur en 1821.
C'est après cette dissertation que vient la plus importante partie de l'ouvrage, du moins en ce qui nous concerne. Elle se compose de trois courts poèmes, également traduits de l'esclavon, affirmait Nodier avec plus de raison.
Le premier est un «poème de tradition morlaque», le Bey Spalatin, pièce inédite, disait le traducteur, «une de ces romances nationales qui ne sont conservées que par la mémoire des hommes».
En vingt-cinq pages de prose française, le poète y racontait la triste histoire du vieux bey Spalatin: l'enlèvement de sa petite-fille, la belle Iska, par le cruel Pervan, «chef de mille heyduques farouches», et la course désespérée du vieillard, les poursuivant jusqu'au château même de l'intrépide brigand.
Sa barbe descend en flocons argentés sur ses flancs robustes qu'embrasse une large courroie. Le hanzar est caché dans les vastes plis de sa ceinture de laine bigarrée. La guzla pend à son écharpe.
Il monte d'un pas ferme encore le sentier périlleux du rocher qu'il a vu pendant quatre-vingts ans sous les lois de sa tribu. Il s'arrête devant la palissade impénétrable des jardins de Zetim.
Là il détache la guzla mélodieuse, instrument majestueux du poète, et frappant d'une main hardie avec l'archet recourbé la corde où se lient les crins des fières cavales de Macarska, il commence à chanter.
Il chante les victoires du fameux bey Skender qui affranchit sa patrie de la terreur de l'ennemi; les douceurs du sol natal, les regrets amers de l'exil: et chaque refrain est accompagné d'un cri douloureux et perçant;
Car le chant de deuil du Morlaque ressemble à celui du grand aigle blanc qui plane on rond sur les grèves et tombe avec un gémissement aigu à la pointe la plus avancée du promontoire de Lissa,
Quand il voit la vague immense se rouler comme un long serpent sur l'onde épouvantée, se tourner en replis innombrables, s'arrondir, s'étendre, et soulever une tête écumante et terrible jusqu'au nid de ses petits.
Ainsi chante le divin vieillard devant le château du terrible «chef de mille heyduques farouches». Aucun de ses ennemis ne comprend la vieille chanson; seule, sa petite-fille captive saisit les paroles tristes du morlaque; elle court et se précipite vers la «palissade impénétrable des jardins de Zetim». Le vieux bey laisse tomber sa guzla, il dégage de sa ceinture multicolore son hanzar redoutable et, à travers les barres de fer, tue sa petite-fille et se laisse, à son tour, tuer par ses ennemis pour sauver sa tribu menacée. «Et, ajoute le poète, l'histoire du bey Spalatin, de sa petite-fille morte et de sa tribu délivrée, est la plus belle qui ait été jamais chantée sur la guzla.»
Nous ne savons s'il est besoin de dire que cette «romance nationale morlaque» est une pure invention de Nodier; car, il faut le reconnaître, la «couleur locale» du Bey Spalatin est sensiblement supérieure à celle de Jean Sbogar. En effet, son héros n'est plus ce bandit-gentleman au menton glabre, musicien, peintre, polyglotte, qui mène une double vie dans la haute société vénitienne et sur les chemins malfamés dalmates. Si nous ne retrouvons pas dans le Bey Spalatin les heyduques authentiques de la ballade serbo-croate: ces brigands vulgaires qui sont sympathiques au chanteur national parce qu'ils sont amis du pauvre, bons chrétiens et ardents patriotes; si nous n'y rencontrons pas davantage les heyduques fantaisistes de Mérimée: gaillards moustachus, durs et féroces,—nous avons en revanche des hommes qui leur ressemblent par cette soif instinctive de carnage et de vengeance qui subsiste même sous le vague et le pompeux qui les enveloppe, sous l'air «divin» et «majestueux» que leur donne Nodier. Tel est ce vieux chef aux cheveux blancs, avec sa «ceinture de laine bigarrée», tel encore ce «cruel Pervan, chef de mille heyduques farouches».
Comme l'avait fait auparavant la comtesse de Rosenberg, comme le fera plus tard Mérimée, Nodier se documente: il emprunte au Voyage de Fortis des noms géographiques, comme Pago, Zuonigrad, Zemonico, Novigradi, Lissa, Castelli, Zeni, Zermagna, Kotar, des mots serbo-croates, comme guzla, hanzar, vukodlack, osvela, pismé, drugh, drushiza, zapis, opancke, kalpack[191]; il copie ces mots soigneusement et les incruste çà et là dans son texte. Le nom du «chef» Pervan est également dû à Fortis, tandis que le vieux bey est baptisé d'une façon plus originale: il reçoit le nom du comte Spalatin, président du tribunal de Laybach à l'époque où Nodier résidait dans cette ville[192]! Chose des plus piquantes, Mérimée, qui s'inspira du Bey Spalatin pour une de ses ballades, et qui crut peut-être à son authenticité, jugea le nom de Spalatin si bien «illyrique» qu'il l'introduisit dans la Guzla[193].
Le Bey Spalatin est accompagné de notes explicatives: sèches, brèves, sans prétentions littéraires. Traitant des questions d'étymologie slave, Nodier y étale avec impertinence sa prétendue érudition, et se moque agréablement de l'ignorance du lecteur. Tout cela rappelle singulièrement les notes de la Guzla; du reste, nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement ailleurs.
Le second poème «esclavon» qui se trouve dans Smarra, nous le connaissons déjà: c'est la Femme d'Asan, la Xalostna Piesanza plemenite Asan-Aghinize. En 1813, Nodier avait fait une analyse de cette pièce dans le Télégraphe illyrien et avait traduit quelques passages en «pentamètres blancs»; cette fois, la version est en prose, très libre, très poétisée, faite non pas sur l'original «esclavon», comme le prétend Nodier et comme le croient le baron d'Avril et M. Pétrovitch[194], mais sur les traductions italienne de Fortis et française de l'anonyme bernois.
C'était donc un poème authentique serbo-croate, et on peut dire qu'il conserve l'empreinte de l'original malgré tous les changements que Nodier lui a fait subir. La Femme d'Asan a d'autant plus d'importance pour nous que ce fut elle qui, dans la version de Nodier, signala à Mérimée le Voyage en Dalmatie. L'auteur de la Guzla le reconnut du reste, quelques années plus tard, dans sa lettre au Russe Sobolevsky («Nodier qui avait déterré Fortis…»), mais il se garda bien de le dire au public français, dans sa préface à l'édition Charpentier in-18[195].
Le troisième morceau «esclavon» qui se trouve dans Smarra, est la Luciole, «idylle de Giorgi», courte poésie, non des meilleures, du poète ragusain Ignace Gjorgjić (1675-1737), que Nodier une fois déjà avait traduite, en 1813, dans le Télégraphe illyrien[196]. Cette production purement littéraire du lyrique dalmate n'a aucun rapport avec la poésie nationale du peuple serbo-croate, mais Nodier l'inséra dans son livre, pour la simple raison qu'elle était une des rares poésies «esclavonnes» qu'il pouvait lire. En effet, la Luciole a été traduite en italien par le docteur Stulli, imprimée par F.-M. Appendini dans ses Notices sur Raguse, et c'est d'après cette traduction italienne que Nodier établit la sienne[197].
Cette poésie de la Luciole, quoique d'une authenticité indiscutable, ne paraît pas offrir d'intérêt pour nous.
Nous avons déjà dit que Smarra était connu avant sa publication; les Annales de la littérature et des arts en avaient même inséré un extrait «qui pourrait donner une idée de l'ouvrage original et du mérite de la traduction», et le public lettré attendait avec impatience le reste du «poème». Le critique littéraire de la Minerve, M. La Beaumelle, l'un des traducteurs de la fameuse collection des drames étrangers que Ladvocat publiait à cette époque, fut pourtant moins crédule que les autres, et ne laissa pas passer sans remarque l'annonce faite par les Annales et par son propre collègue de la Minerve, L. Rincovedro[198]. Il exprima sa grande admiration pour l'Esclavonie, mais il engagea Nodier, «pour l'intérêt des lettres», à joindre à son ouvrage des textes originaux[199].
Cette invitation n'embarrassa pas l'auteur de Jean Sbogar. Après avoir reproduit les quatre premiers vers serbo-croates de la Femme d'Asan, il expliqua ainsi, dans une note spéciale, les difficultés qu'aurait rencontrées une publication intégrale du poème «esclavon»:
Un homme de lettres distingué, disait-il, qui a bien voulu prendre quelque intérêt à mes travaux sur la littérature slave, a témoigné dans un journal le désir que je joignisse à quelques-unes de mes traductions le texte original du poète. Il n'a pas observé que la langue slave possède plusieurs articulations que nous ne pouvons exprimer par aucun signe de notre alphabet, et dont quelques-unes sont extrêmement multipliées dans l'usage; de sorte qu'il serait impossible de reproduire ce texte autrement que par des approximations imparfaites, pour ne pas dire barbares, à moins qu'on ne se servît de l'écriture propre de l'idiome, qui serait illisible pour le très grand nombre des lecteurs. On jugera toutefois de cette langue et de cette écriture par la planche où j'ai représenté le premier quatrain de la Complainte de la noble épouse: 1° avec nos caractères, d'après Fortis qui convient qu'il n'a pas pu se dispenser de s'éloigner un peu de la prononciation, et qui s'en est beaucoup plus éloigné qu'il ne le dit ou qu'il ne le croit; 2° en lettres glagolitiques ou géronimiennes des livres de liturgie; 3° en cyrilliaque ancien; 4° en cursive cyrilliaque moderne, comme elle est encore usitée par les Morlaques, et qui se rapproche beaucoup de la cursive usuelle des Russes[200].
Cette planche était simplement une reproduction de celle qu'avait donnée
Fortis dans son Voyage!
M. La Beaumelle se contenta de cette réponse. Il comprit la chose jusqu'à un certain point, loua Smarra, mais l'attribua de suite à son véritable auteur. Quant à l'autre «romance nationale», il fut complètement dupe.
Vient ensuite, disait-il, le chant de Spalatin-Bey qui est bien certainement d'origine ancienne… Le noble et courageux Spalatin est un des plus beaux caractères qu'ait tracés la poésie. Le récit a dans son ensemble toute la simplicité; dans son expression, toute la fierté des temps anciens. C'est une saga islandaise, un chant d'Ossian, une romance des vieux Espagnols, et, quelquefois même, une rapsodie d'Homère[201].
Quelques «journaux libéraux», que nous n'avons pas réussi à découvrir, avaient cru à l'authenticité de l'ouvrage entier, et la Gazette de France se moqua d'eux cruellement. À son tour, sa bonne foi fut surprise quant au Bey Spalatin dont elle loua la simplicité naturelle[202].
Dans les Annales, un rédacteur qui signait «M.D.V.»—ou plutôt une rédactrice, car ces initiales cachaient Marceline Desbordes-Valmore—eut la hardiesse de dire avec bienveillance «que, peut-être, Smarra n'était point une traduction de l'esclavon, mais qu'il n'en était pas de même des poésies morlaques traduites en français par M. Nodier».
On lit avec le plus vif intérêt le Bey Spalatin, disait-elle, et surtout la Femme d'Asan, dont la touchante histoire pourrait fournir le sujet d'un ouvrage dramatique. Peut-être y a-t-il eu un peu de coquetterie de la part de M. Nodier à placer sous les yeux des lecteurs des chefs-d'œuvre des poésies morlaques, pour prouver que ses propres inspirations égalent ou surpassent celles des poètes esclavons: coquetterie bien permise, et dont, en vérité, je suis bien loin de faire l'objet d'un reproche[203].
Malgré l'affabilité de ce critique, le volume n'eut aucun succès de librairie, et l'éditeur Ponthieu dut vendre l'édition au poids. Smarra ne fut réimprimé qu'une seule fois, en 1832, par Renduel, dans les Œuvres Complètes de l'écrivain[204].
Le droit d'auteur ayant expiré en 1894, plusieurs ouvrages de Nodier reparurent en librairie vers cette date: Smarra n'obtint pas les honneurs d'une nouvelle édition[205].
Mais s'il ne fut pas lu du grand public, il eut, par contre, un lecteur remarquable en Mérimée; et le jour où le jeune auteur du Théâtre de Clara Gazul aura envie de visiter les pays inconnus des «touristes anglais»: c'est dans l'Illyrie de Charles Nodier que ce gentleman à l'humeur vagabonde désirera aller éprouver des impressions nouvelles.