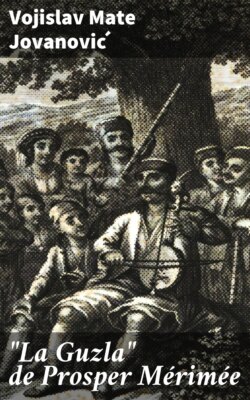Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA BALLADE POPULAIRE EN FRANCE[241]
ОглавлениеIl s’est trouvé en France, en tous temps, des esprits indépendants et délicats qui ont été sensibles au charme naïf de la poésie populaire.
On l’a dit et redit, et dernièrement M. Jean Richepin le faisait à nouveau remarquer dans son discours de réception, Montaigne fut de ce nombre. «La poésie populaire et purement naturelle, écrivait-il, a des naïfvetez et grâces, par où elle se compare à la principale beauté de la poésie parfaicte, selon l’art; comme il se veoid èz villanelles de Gascoigne et aux chansons qu’on nous rapporte des nations qui n’ont cognoissance d’aulcune science, ny mesme d’escripture[242].» À son nom, on ajoute ordinairement le nom de La Fontaine et celui de Molière, qui en parle par la bouche d’Alceste, dans la fameuse scène du sonnet.
Il serait injuste d’oublier, parmi ces précurseurs des études folkloriques, trois autres Français: Christophe Ballard, «seul imprimeur de musique et noteur de la chapelle du Roy», qui publia plusieurs recueils de chansons puisées dans la tradition orale[243]; François-Auguste de Moncrif, qui fit quelques complaintes sur les thèmes populaires[244]; et surtout l’infatigable Restif de La Bretonne, qui cita mainte chanson bourguignonne dans ses étranges romans.
Mais c’étaient là des amateurs d’occasion, et leurs sympathies pour la poésie populaire n’étaient pas assez réfléchies pour constituer un programme littéraire. Moins nombreux et quelque peu attardés furent ceux qui pensèrent à tirer des effets artistiques de la simple et vieille ballade du peuple.
C’est à peine si l’influence anglaise, en Allemagne si bienfaisante, se fit sentir en France au XVIIIe siècle; Percy y fut presque inconnu jusqu’en 1806, aussi les rares tentatives pour transplanter dans ce pays le goût de la ballade populaire demeurèrent-elles toujours sans succès.
Ossian fut plus heureux que Percy. Dès le mois de septembre 1760, le Journal étranger publiait les «fragments d’anciennes poésies, traduits en anglais de la langue erse, que parlent les montagnards d’Ecosse[245]». En 1762 en parut la première traduction française imprimée séparément: Carthon. Le culte de «l’Homère celtique» était entièrement établi quand Letourneur donna sa traduction des «poésies galliques d'Ossian, fils de Fingal» (1778), traduction qui eut un succès prodigieux; il ne sera pas affaibli vingt ans plus tard, quand paraîtra celle de Baour-Lormian.
Chateaubriand, pendant son séjour en Angleterre, se fit grand partisan du barde écossais. «J'aurais soutenu, disait-il beaucoup plus tard, la lance au poing son existence envers et contre tous, comme celle du vieil Homère. Je lus avec avidité une foule de poèmes inconnus en France, lesquels, mis en lumière par divers auteurs, étaient indubitablement, à mes yeux, du père d'Oscar, tout aussi bien que les manuscrits runiques de Macpherson. Dans l'ardeur de mon zèle et de mon admiration, tout malade et tout occupé que j'étais, je traduisis quelques productions ossianiques de John Smith[246].»
Et, en 1797, il écrivait au chapitre XXXVIII de son Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes:
Le tableau des nations barbares offre je ne sais quoi de romantique qui nous attire. Nous aimons qu'on nous retrace des usages différents des nôtres, surtout si les siècles y ont imprimé cette grandeur qui règne dans les choses antiques, comme ces colonnes qui paraissent plus belles lorsque la mousse des temps s'y est attachée. Plein d'une horreur religieuse, avec le Gaulois à la chevelure bouclée, aux larges bracca, à la tunique courte et serrée par la ceinture de cuir, on se plaît à assister dans un bois de vieux chênes, autour d'une grande pierre, aux mystères redoutables de Teutates.
Mme de Staël, dans le fameux chapitre XI de son livre De la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, établit la division, plus fameuse encore, des «deux littératures tout à fait distinctes, celle qui vient du Midi et celle qui descend du Nord, celle dont Homère est la première source, celle dont Ossian est l'origine». Elle ajouta que «l'on ne peut décider d'une manière générale entre les deux genres de poésies dont Homère et Ossian sont comme les premiers modèles. Toutes mes impressions, disait-elle, toutes mes idées me portent de préférence vers la littérature du Nord». Nous n’insisterons pas sur l’importance de ces lignes. Disons seulement que l’impérial ennemi de Mme de Staël, lui aussi, admirait le barde écossais; il en porta avec lui la traduction italienne de Cesarotti et la lisait entre deux batailles—comme Alexandre lisait son Homère. Jusque dans ses proclamations, Napoléon imitait la prose rythmée de Macpherson[247].
Il y eut en France toute une génération de Malvina, d’Oscar et de Selma. Sous le Directoire, on voyait dans les nuits froides et orageuses, au milieu du Bois de Boulogne, des bommes demi-nus, assis autour de feux druidiques[248]. En 1804, Charles Nodier composait les Essais d’un jeune barde. En 1808, Lamartine chantait:
Toi qui chantais l’amour et les héros,
Toi, d’Ossian la compagne assidue,
Harpe plaintive, en ce triste repos,
Ne reste pas plus longtemps suspendue[249].
En 1818, Victor Hugo envoyait aux Jeux floraux de Toulouse un poème ossianique, les Derniers Bardes. Une année plus tard, Balzac, âgé de dix-neuf ans, composant son Cromwell, écrivait à l’une de ses sœurs: «Tiens, ce qui m’embarrasse le plus, ce sont celles [les situations] de la scène première entre le roi et la reine. Il doit y régner un ton si mélancolique, si touchant, si tendre, des pensées si pures, si fraîches, que je désespère! Il faut que cela soit sublime tout du long… Si tu as la fibre ossianique, envoie-moi des couleurs, chère petite, bonne, aimable, gentille sœur que j’aime tant[250]!»
Mérimée, lui aussi, n’échappa pas à cette fièvre bardite, car au mois de janvier 1820, J.-J. Ampère put écrire à son ami Jules Bastide: «Je continue avec Mérimée à apprendre la langue d'Ossian, nous avons une grammaire. Quel bonheur d’en donner une traduction exacte avec les inversions et les images naïvement rendues[251]!»
Sainte-Beuve range Ossian parmi les «grands-oncles étrangers» d’Alfred de Vigny[252] et signale l’influence de Macpherson dans les vers d’Alfred de Musset:
Pâle Étoile du soir, messagère lointaine,
qui sont de 1840, mais qui ne sont pas le dernier écho de «l’Homère celtique».
Les poèmes ossianiques cependant n’ont pas joué en France le même rôle qu’ailleurs. Tandis qu’en Allemagne ou en Bohême, par exemple, ils avaient stimulé le goût de l’étude du passé national, éveillé la curiosité en faveur des traditions populaires, en France, au contraire, ils n’eurent d’influence que par ce qu’ils avaient de plus littéraire et de plus général: cette sensiblerie commune au XVIIIe siècle, cette mélancolie, cette vague tristesse si chère aux solitaires,—sentiments que Rousseau et Goethe n’avaient pas peu contribué à faire partager à leurs contemporains.
Le premier qui ait subi en France l’influence des collectionneurs de ballades anglais, paraît avoir été P.-A. de La Place (1707-1793), écrivain médiocre qui avait appris l’anglais au collège de Saint-Omer et débuté par une insignifiante traduction de la Venise sauvée d’Otway.
En 1773, dans ses Œuvres mêlées, il avait «rajeuni» le langage de quelques «romances historiques» en vers: Léonore d’Argel, Frédégonde et Landri, le Chevalier et la fille du berger[253].
Dans son recueil des Pièces intéressantes et peu connues (Bruxelles, 1784-1785), il donna toute une série d’anciennes romances et contes qui témoignent une certaine connaissance des recueils anglais qu’il avait voulu imiter. C’est ainsi que, dans une note, il reconnaît avoir emprunté à «un historien anglais» la Rosamonde, romance galante et tragique, l’une des plus connues des Reliques de Percy[254]. D’ailleurs, il précisa ses intentions dans une intéressante introduction:
Pourquoi, dit-il, avons-nous si peu ou, pour mieux dire, presque pas, de ces anciennes romances historiques, tragiques ou intéressantes, à quelques égards que ce soit, tandis que les Espagnols, les Anglais, les Allemands, etc., en ont des recueils qui se font toujours lire avec d’autant plus de plaisir, qu’en rappelant plus ou moins bien à la mémoire des événements faits pour occuper ou le cœur ou l’esprit, elles ont de plus le mérite de peindre les mœurs anciennes, toujours faites, soit pour nous amuser, soit pour nous instruire agréablement?
Le prodigieux succès de la romance de Marlborough pourrait seul en donner la preuve, si l’empressement avec lequel nous nous hâtons de transporter les romances étrangères dans notre langue était aujourd’hui moins connu.
Le Français a pourtant chanté dans tous les temps!… Mais dût cette frivolité dont on l’a si souvent accusé, et son goût pour le changement, lui avoir fait négliger et, par degrés, totalement oublier les anciennes chansons de nos aïeux, il n’est pas moins étonnant qu’il s’en trouve si peu de vestiges dans les anciens recueils, où presque tous les genres de poésies qui furent jadis à la mode se trouvent, soit en totalité, soit en partie, conservés jusqu’à nos jours.