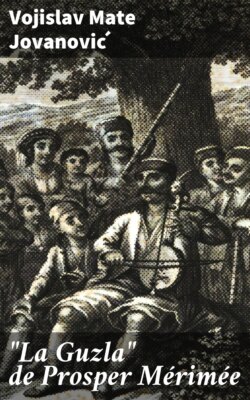Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L'ILLYRIE NAPOLÉONIENNE
ОглавлениеAu moment où Mme de Staël écrivait Corinne, il se passa un événement qui contribua dans une large mesure à faire connaître en France l'Illyrie et les «Illyriens». Par le traité de Presbourg (décembre 1805), la Dalmatie devint une dépendance du royaume d'Italie.
Dans la suite, à l'époque du blocus continental, afin d'isoler complètement l'Autriche de la mer, Napoléon lui enleva, par le traité de Schoenbrunn (14 octobre 1809), la Haute Carniole, une partie de l'Istrie, le Frioul, le Littoral croate et la Croatie méridionale. Il projetait de reconstituer un royaume slave sur l'Adriatique, songeant à y incorporer également et la Bosnie et la Serbie. Il donna le nom de provinces illyriennes à la nouvelle possession impériale. En 1811, il y ajouta l'Istrie vénitienne, la Dalmatie, Raguse et les Bouches de Cattaro[93]. Les provinces illyriennes s'étendaient ainsi des sources de la Save à la frontière monténégrine, et de l'Isonzo à la frontière turque. Le pays avait un gouverneur général à Laybach et était divisé en six provinces civiles et une province militaire; il avait reçu une organisation française, à l'exception de Raguse et de la province militaire[94].
Dans la capitale des provinces, qui était déjà une vraie tour de Babel, une petite colonie française s'était installée et il s'était formé une cour autour du gouverneur. L'éloignement de Paris dans lequel vivait celui-ci lui avait fait décerner «des pouvoirs extraordinaires», suivant les propres paroles de l'Empereur au général Bertrand, le premier titulaire, et le conseil qu'il présidait et dirigeait avait reçu le «pouvoir de prononcer, soit comme Conseil d'État, soit comme Cour de Cassation, sur plusieurs objets importants[95]».
Quatre gouverneurs ont régné à Laybach entre 1811 et 1813: le maréchal Marmont, duc de Raguse, le général comte Bertrand, le maréchal Junot, duc d'Abrantès, et Fouché, duc d'Otrante. Au premier rang de la colonie se trouvait l'intendant général M. de Chabrol, un administrateur actif et capable; il était secondé par le maître des requêtes Las Cases, le futur compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène[96]. «À cette époque, dit le biographe de Fouché, où l'extension de l'Empire avait créé un réel cosmopolitisme en facilitant les relations et les allées et venues de pays à pays, on avait vu apparaître à la «cour» de Laybach plusieurs personnages de la société parisienne qui y apportaient les modes, les bruits et l'air des Tuileries. À côté des officiers et administrateurs groupés autour du gouverneur général, d'autres fonctionnaires, Italiens en grande partie, mais aussi Croates, Dalmates et Istriens, des seigneurs allemands et des chefs slavons, et jusqu'à des évêques grecs ou italiens, jusqu'à des chefs de pandours albanais, jusqu'à des envoyés de pachas voisins, créaient au palais du gouverneur une cour disparate, originale et assez brillante où se sentait un vague goût d'Orient mêlé aux élégances du faubourg Saint-Honoré; où des auditeurs frais émoulus du Conseil d'État coudoyaient des chanoinesses autrichiennes, des officiers vénitiens, des chefs auxiliaires croates, des prélats orthodoxes et des ambassadeurs monténégrins et bosniaques. Des fêtes assez fréquentes égayaient cette cour hétéroclite; le Télégraphe illyrien en faisait dans le style bien connu de la presse impériale d'emphatiques comptes rendus. Le lycée où professaient des maîtres de l'Université impériale, ouvrait ses portes au gouverneur général pour de solennelles distributions de prix; de jeunes Dalmates y composaient en latin l'éloge du grand Napoléon, comme le devaient faire, à la même heure, en d'autres lycées, de jeunes Bretons et de jeunes Hollandais[97]; le proviseur haranguait les «jeunes Illyriens» sur le style de Fontanes, croyant faire à la couleur locale une suffisante concession en soutenant, contre toutes les vraisemblances géographiques, qu'ils pouvaient, du haut de leurs montagnes, apercevoir le Pinde et les Thermopyles[98]. Le pays semblait «napoléonisé». Il n'y manquait que la guillotine, mais les fonctionnaires la réclamaient à grands cris. Dès le 23 novembre 1812, elle fut installée à Laybach. On inondait le pays de croix et de rosettes de la Légion d'honneur: grands seigneurs, évêques, chanoines, maires et chefs de pandours participaient à cette manne[99].»
Le poète slovène Vodnik chantait dans une ode:
Napoléon a dit: «Réveille-toi, Illyrie, quatorze siècles durant la mousse t'a recouverte.» Aujourd'hui, Napoléon lui ordonne de secouer sa poussière. Elle sera glorifiée, j'ose l'espérer. Un miracle se prépare, je le prédis. Chez les Slovènes pénètre Napoléon; une génération tout entière s'élance de la terre. Appuyée d'une main sur la Gaule, je donne l'autre à la Grèce pour la sauver[100].
Mais, malgré ces vers, le gouvernement français ne dura pas longtemps dans les provinces. Ni le peuple «illyrien» ni ses voisins n'étaient contents de lui. Les Russes et les Anglais parurent devant Cattaro; les Monténégrins descendirent de leurs montagnes, et à partir de l'automne 1813, les Français ne furent plus maîtres que du pays dominé par leurs canons, c'est-à-dire de quelques places fortes où l'on célébrait d'imaginaires victoires de l'Empereur pour entretenir l'enthousiasme des soldats. Enfin, les événements de 1814 et 1815 replacèrent définitivement l'Illyrie sous la domination de l'Autriche.
Cette occupation momentanée ne resta pas sans conséquences pour la science et pour la littérature[101].
La géographie y gagna d'abord. La Dalmatie, le Monténégro (qui était à deux pas de la garnison française de Cattaro), la Bosnie—pays tous inconnus jusqu'alors—furent étudiés dans une série d'articles, brochures, mémoires, relations de voyage, qui se prolongea longtemps après la restitution des provinces à l'Autriche.
À Laybach, on publie en français des décrets, arrêtés et règlements[102]. On rédige le Télégraphe officiel des provinces illyriennes, journal tétraglotte, publié par le gouvernement (en français, italien, allemand et slovène[103]). À Trieste, on imprime une grammaire française «à l'usage de la jeunesse guerrière des provinces illyriennes[104]».
En France, les journaux donnent régulièrement des nouvelles du pays et s'efforceront de faire connaître à leurs lecteurs la plus récente conquête impériale[105]. Peu de temps après l'occupation de la République de Raguse par Lauriston (1806), un lettré «slovinique», le comte de Sorgo, fut présenté à Napoléon[106] et élu membre de l'Académie Celtique (plus tard Société des Antiquaires de France). Il lut à cette savante compagnie un Mémoire sur la langue et les mœurs du peuple slave[107] dans lequel il exprimait l'opinion suivante: «Depuis qu'une partie des peuples slaves, notamment les Dalmates, furent réunis à la grande confédération de l'Empire Français, l'histoire, la langue, les antiquités de ces peuples devenus pour les savants français des richesses nationales, peuvent réclamer leur attention et quelques instants de leurs travaux précieux[108].»
En même temps, les Annales des Voyages de Malte-Brun publient une Notice géographique et historique sur le Monténégro et un Tableau des Bouches de Cattaro (1808). Cette publication populaire donne aussi, en 1809, une Description physique de la Croatie et de l'Esclavonie, et, en 1811, un Mémoire sur le Monténégro, par A. Dupré. Cette même année 1811 paraissent: la Croatie militaire, mémoire sur les régiments frontières, par le général Andréossy[109]; les Souvenirs d'un voyage en Dalmatie, par C. B., du département de Marengo [Dr Charles Botta], ouvrage où l'on parle de la poésie populaire serbe (pp. 55-57). En 1812, le Voyage en Bosnie dans les années 1807-1808, par Amédée Chaumette-Desfossés, ancien chancelier du consulat général de Bosnie, ouvrage réédité en 1821, connu de Mérimée et utilisé dans la Guzla[110]. L'année suivante, M. Depping fait un long Tableau de Raguse pour les Annales des Voyages (t. XXI), où il parle de la littérature «illyrienne» d'après l'ouvrage italien de F.-M. Appendini[111]. En 1814, on traduit de l'allemand une étude sur l'Illyrie et la Dalmatie, par le savant autrichien Balthasar Hacquet, et on l'augmente d'un Mémoire sur la Croatie militaire[112]. Le Journal des Débats ouvre son feuilleton aux articles sur la poésie «illyrienne», par Charles Nodier. En 1815, Charles Pertusier, attaché à l'ambassade de France à Constantinople, fait paraître une longue notice sur la Dalmatie, dans ses Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore. En 1818, A. Dupré s'occupe de nouveau de l'Illyrie: il publie son «essai historique et commercial» sur les Bouches de Cattaro[113]. Le dépôt général de la marine fait graver, en 1820 et 1821, les nombreux plans et cartes de la mer Adriatique levés en 1806 par les officiers français[114]. Le colonel L.-C. Vialla de Sommière, ancien chef d'état-major de la deuxième division de l'armée d'Illyrie et de Raguse, donne, en 1820, les deux volumes de son Voyage historique et politique au Monténégro, ouvrage sur lequel Sénancour fait de suite un article dans la Minerve littéraire[115]. En même temps, Hugues Pouqueville, membre de l'Institut, ancien consul général à la cour d'Ali-Pacha de Janina, imprime son grand Voyage dans la Grèce (5 vol. in-8°) qui contient un bon nombre de pages sur les pays «illyriens». En 1822, Charles Pertusier écrit une étude sur la Bosnie, considérée dans ses rapports avec l'Empire Ottoman. Enfin, en 1823, un Dalmate, ancien officier supérieur de la marine, M. le chevalier Bernardini, publie à Paris son Discours sur la langue illyrienne et sur le caractère des peuples habitant la côte orientale du golfe Adriatique[116].
Cette abondance d'ouvrages français relatifs au pays de Hyacinthe Maglanovich dispensa l'auteur de la Guzla (comme il le reconnut lui-même) d'une description géographique, politique, etc.[117]
§ 7