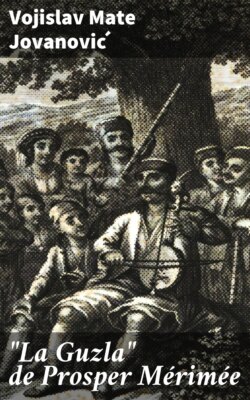Читать книгу "La Guzla" de Prosper Mérimée - Vojislav Mate Jovanović - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA BALLADE POPULAIRE EN ANGLETERRE
ОглавлениеQuoique les premiers collectionneurs de ballades populaires soient les littérateurs du Danemark et de l'Espagne[210], l'Angleterre est le pays qui a donné naissance au goût moderne pour cette poésie, comme nous avons eu occasion de le dire dans notre précédent chapitre.
Sous le règne d'Élisabeth, en effet, la ballade y jouissait déjà d'une grande faveur, et les drames de Shakespeare abondent en couplets tirés des chansons en vogue de son temps. Dans la Douzième nuit (acte II, scène 4), le Duc demande au Fou:
Eh camarade, arrive; dis-nous la chanson de l'autre nuit.—Écoute-la bien, Césario; elle est vieille et simple.—Les fileuses, les tricoteuses qui se chauffent au soleil,—les chastes filles qui tissent avec la navette d'os,—ont coutume de la chanter. C'est la candeur même,—elle respire l'innocence de l'amour—à la manière du bon vieux temps[211].
Et le Fou chante ces vers touchants: Viens, viens, ô mort!
Sir Philip Sidney n'était pas moins enthousiaste de ces vieux chants; voici ce qu'il dit d'un des plus anciens, la célèbre ballade de la Chasse dans les monts Cheviot: «Je n'ai jamais entendu le vieux chant de Perey et Douglas, sans avoir senti mon cœur plus ému que par le son de la trompette. Et pourtant qu'est-ce qui le fait entendre? Quelque ménétrier aveugle, dont la voix n'est pas moins rude que le style. Si dans ce mauvais accoutrement, souillé de la poussière et des toiles d'araignées de cette époque grossière, ce poème nous remue de la sorte, que ne ferait-il pas s'il était paré de l'éloquence magnifique d'un Pindare[212]?»
Mais ce goût ne dura pas longtemps, et vers le commencement du XVIIe siècle la ballade populaire tomba en discrédit. Il paraît que les ménétriers ou chanteurs ambulants répandaient un esprit de révolte en célébrant les exploits des outlaw de la frontière écossaise, car, en 1597, la reine Élisabeth rendit une ordonnance par laquelle les pauvres poètes furent assimilés à des «coquins, vagabonds et mendiants effrontés» et menacés des peines les plus sévères[213]. En Écosse, rapporte Chambers dans ses Annales domestiques, sous la régence de Jacques Morton (1572-1576), la peine de mort fut édictée contre quiconque composerait ou imprimerait des ballades[214].
L'époque austère de Cromwell fut également défavorable à la poésie populaire, qu'elle estimait un vain amusement propre aux âmes insouciantes.
Quant à la Restauration, elle fut trop frivole et trop hautaine pour s'intéresser aux chants du simple peuple. Les brillants écrivains classiques que produisit l'Angleterre de 1660 à 1740, ne crurent pas devoir s'occuper de la «poésie sauvage des âges grossiers, ce dernier reste de la barbarie». Il fallait une réaction contre la symétrie, l'élégance et l'équilibre pompeux de la littérature pseudo-classique; et cette réaction eut lieu au moment où ces qualités poussées jusqu'à l'exagération aboutissaient à une sécheresse et à une finesse artificielle révoltantes.
Dès le début du XVIIIe siècle, on commença à priser de nouveau la poésie populaire. Dans les fameux numéros 70, 74 et 80 du Spectateur, Addison, après avoir loué la simplicité agréable des vieilles ballades, en commentait deux: _la Chasse dans les monts Cheviot _et _les Enfants dans la forêt. _Bientôt l'on publia quelques recueils de ballades, dont le premier fut: A Collection of Old Ballads, corrected (sic) from the Best and most Ancient Copies Extant, with Introductions, Historical, Critical and Humorous (Londres, 1723-27, 3 vol.). On attribue cette collection à Ambrose Philips. En 1724, Allan Ramsay donna son Evergreen, being a Collection of Scots Poems wrote by the Ingenious before 1600 (Edimbourg, 2 vol.). Dans la préface de son livre il expliqua très nettement son intention: «J'ai remarqué, dit-il, que les plus judicieux des lecteurs se plaignent de notre littérature actuelle, disant qu'elle est pleine de délicatesses affectées et de raffinements étudiés, choses qu'ils échangeraient volontiers contre la vigueur de pensée naturelle et la simplicité de style, qui étaient dans l'habitude de nos aïeux. Je crois que cette collection ne recevra pas un mauvais accueil auprès des lecteurs dont je parle.» En 1725, le même poète publia The Tea-Table Miscellany or a Collection of Scots Songs (Édimbourg, 3 vol.).
Au milieu du XVIIIe siècle, un mouvement se dessinait en Angleterre, emportant beaucoup d'esprits distingués vers le passé et vers la nature. Les uns, comme Walpole, comme Warton, comme Hurd, cherchaient à remettre à la mode l'architecture et la poésie médiévales, à publier des manuscrits poudreux, à célébrer les châteaux «gothiques», les ruines druidiques; les antres, à glorifier la campagne, la mer, les rochers, les cimetières.
Naturellement, les naïfs et vieux chants populaires furent alors mis en grand honneur. On s'appliqua à recueillir des ballades anglaises, irlandaises, galloises. Une antiquité nouvelle semblait renaître, antiquité très différente de la Grèce et de Rome, vierge d'imitations, «pâture offerte aux imaginations avides[215]». On voulait ressusciter toute une civilisation morte, celle des peuples du Nord: des Celtes et des Germains que l'on confondait même au temps de Mme de Staël et qu'on opposait triomphalement aux civilisations vieillies de l'Europe latine[216].
Deux grands événements littéraires dominent ce mouvement: la publication des poèmes ossianiques par James Macpherson (1760), et celle des anciennes ballades anglaises par Thomas Percy (1765).
On connaît les polémiques ardentes sur l'authenticité des chants d'Ossian, polémiques qui cessèrent cinquante ans seulement après l'apparition de la première édition de Fingal. On sait depuis longtemps que cette fameuse épopée n'est qu'une imitation emphatique et paraphrasée, qui est loin d'avoir l'âpre énergie et la couleur des chants originaux dont elle prétendait être une traduction fidèle. Mais on n'ignore pas non plus qu'à travers toutes les interpolations de Macpherson, se reflètent d'admirable façon la rudesse des mœurs et l'enthousiasme guerrier des «primitifs»; de même, malgré toutes les réminiscences littéraires dont les Fragments de la poésie gaëlique[218] sont remplis (en particulier de Virgile et d'Homère), on entrevoit dans cette inégale mosaïque tant d'éléments authentiques[219] qu'il serait injuste de contester à l'ingénieux imposteur l'honneur d'avoir eu une part importante dans le réveil du goût pour la poésie populaire, dans son pays aussi bien qu'ailleurs. Sans nous étendre davantage[220], répétons cependant ce que nous avons dit à propos du Viaggio in Dalmazia et des Morlaques: ce fut en s'inspirant d'Ossian que l'abbé Fortis inséra dans ses livres les deux ou trois ballades serbo-croates qui ont établi la renommée européenne de cette poésie; de même, ce fut sous l'influence du barde écossais que la comtesse de Rosenberg composa ces chants prétendus populaires qu'elle a placés dans son roman dalmate. C'est à Ossian que la Triste ballade doit d'être célèbre; la Guzla lui est redevable en partie de son origine.
Passons maintenant à un autre archaïsant britannique, plus fidèle à ses textes celui-là, et qui contribua également au relèvement de la ballade.
En 1765 parurent à Londres les trois volumes in-8° des Reliques of Ancient English Poetry, consisting of Old Heroic Ballads, Songs and other Pieces of Our Earlier Poets. L'ouvrage était publié sous le couvert de l'anonyme, mais on n'ignorait pas que son éditeur était un jeune clergyman, Thomas Percy, qui deviendra un jour évêque de Dromore.
Percy avait tiré ces ballades d'un vieux manuscrit in-folio, trouvé chez un de ses amis, à Shiffnal, et dont plusieurs feuillets avaient servi pour allumer le feu. Dans sa préface, l'auteur réclamait une grande indulgence de la part de ses contemporains lettrés pour ces «rudes chants des vieux bardes qui chantaient pour le peuple».
Les Reliques furent d'abord froidement accueillies par les coryphées de la littérature. Le docteur Johnson, dont on connaît la célèbre polémique avec Macpherson au sujet des chants ossianiques, ne répondit que par des dédains aux avances flatteuses que lui avait faites l'éditeur des Reliques dans la préface. Du reste, l'éminent critique avait eu déjà l'occasion d'exprimer son opinion sur les imitateurs de vieilles ballades, quatorze ans auparavant, dans son Club des antiquaires:
Cantilenus, dit-il, concentrait toutes ses pensées sur les vieilles ballades, car il les considérait comme des souvenirs fidèles du goût naturel. Il m'offrit de me montrer un exemplaire des Enfants dans la forêt qu'il croyait original et dont il pensait qu'il était utile d'épurer le texte; comme si cette époque barbare avait le moindre titre à de telles faveurs[221]!
Warburton, le commentateur de Shakespeare, ne se montra pas plus clément. «La manie de l'antiquaille est aux vraies lettres, disait-il, ce que de brillants champignons sont au chêne: ils ne poussent et fleurissent que lorsque la vigueur et la sève du bois sont allanguis et presque épuisés[222]!» Un troisième critique fit une charge à fond contre Percy. Le jeune clergyman était traité de contrefacteur qui se serait «servi de son caractère ecclésiastique pour sanctifier la fraude». Il lui reprochait, et d'avoir mal représenté, dans ses commentaires, l'office et la dignité des anciens ménestrels, et d'avoir altéré et interpolé la plupart des vieux poèmes qu'il avait publiés[223].
Ce critique n'avait pas tort en ce qui concerne le manque de scrupules de Percy. En effet, son travail peut être contrôlé aujourd'hui, car le manuscrit original, gardé jalousement par la famille, fut enfin publié en 1867 et 1868[224]. Parmi les cent soixante-seize pièces qui forment le recueil, il n'y en a que quarante-cinq qui soient véritablement copiées sur le fameux manuscrit, et même elles n'ont été publiées qu'après avoir été l'objet de retouches très sensibles de la part de l'éditeur. Le reste était glané un peu partout; la ballade The Friar of Orders Grey était tout entière due à Percy.
Pourtant, malgré tous ses défauts, ce livre fit époque; son influence se fait sentir jusqu'à nos jours. Il est nécessaire de l'ajouter—Hermann Hettner l'a justement remarqué—Percy travaillait inconsciemment et ne se doutait pas de l'importance de son œuvre[225].
Le premier mérite de Percy, c'est d'avoir «sauvé de l'oubli quelques chefs-d'œuvre de la poésie anglaise, dit Macaulay dans l'introduction de ses Lays of Ancient Rome, chefs-d'œuvre dont les uniques exemplaires déchirés étaient à la merci d'une mouchure de chandelle ou d'un mauvais chien». Mais il a d'autres titres à la reconnaissance que celui d'avoir très à propos sauvé ces vieilles ballades du temps et de l'oubli: il stimula le patriotisme local et la vanité littéraire d'autres écrivains, plus ou moins capables d'une pareille entreprise; il fut suivi dans le chemin qu'il avait frayé: d'autres complétèrent son œuvre et même la dépassèrent. Nous n'indiquerons que trois de ces imitateurs et continuateurs: Herd, qui publia sa collection en 1769; Scott, en 1802 et 1803, et Motherwell, en 1827. D'autre part, ses ballades contribuèrent très puissamment à réformer le goût littéraire, à rendre possible la renaissance du style poétique anglais qui se dégageait des règles sèches du pseudo-classicisme, cherchant le naturel dans le «langage direct» des aïeux. Elles inspirèrent des poètes de génie. Wordsworth, Coleridge, Southey, Scott, ont tous reconnu, chacun à leur tour, la dette qu'ils avaient contractée envers le vieux collectionneur de ballades. Wordsworth allait jusqu’à dire que la poésie anglaise fut «et absolument délivrée» (redeemed) par Percy[226]. «Je ne crois pas qu’il y ait un seul poète contemporain, écrivait-il, qui ne serait fier de reconnaître ce qu’il doit aux Reliques. Mes amis en sont là; et, pour ma part, je suis heureux de faire à cette occasion mon aveu public[227].» Walter Scott fait des déclarations à peu près semblables[228],—ce qui n’était pas nécessaire, du reste, car les Chants populaires des frontières méridionales de l’Écosse le témoignent suffisamment, ainsi que l’œuvre tout entière de l’inventeur du roman historique. «Il est évident que l’ouvrage de Percy fut la source où sir Walter alla puiser ses premières inspirations. Ses poèmes ne sont que des légendes romanesques écrites dans le style et le rythme des vieux chants populaires. Lorsqu’il vit que le public commençait à se fatiguer de ces légendes versifiées, il démonta sa harpe écossaise et se contenta de la prose. La même pensée, la même vénération pour les temps anciens, les mêmes études de costumes et de caractères qui avaient fait le succès des poèmes, assurèrent le succès des romans[229].»
Cette influence de Percy se prolongea à travers le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Elle est très sensible chez les poètes et les peintres du noble et beau mouvement préraphaéliste, surtout chez Dante Gabriel Rossetti et Edward Burne-Jones[230]; chez le «poète-typographe» William Morris, de même que chez les grands poètes de l'école irlandaise contemporaine: William Butler Yeats et Nora Hopper.
§ 3