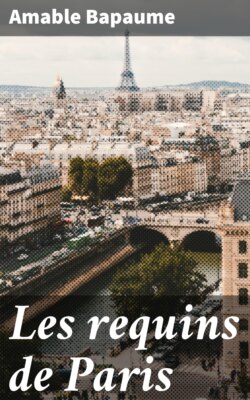Читать книгу Les requins de Paris - Amable Bapaume - Страница 8
CHAPITRE IV
PUR SANG
ОглавлениеGeorges de Cerny, dernier espoir d’une des plus anciennes et des plus riches familles de France, était fils unique de M. le comte Sosthène de Cerny, baron de Bois-gobert, chevalier de Preslaye, colonel des dragons de Sa Majesté Charles X, rallié à la branche cadette après cinq ans de fidélité transformée ainsi en bouderie, nommé pair de France en1839, élu député pour la Maute-Marne aux Assemblées révolutionnaires, un des membres actifs du groupe de la rue de Poitiers, rentré dans la vie privée depuis décembre1852.
La santé de Georges, vigoureuse aujourd’hui, avait été fort délicate jusqu’aux dernières années de l’adolescence; nécessairement, son éducation s’était ressentie des craintes qu’il inspirait; on l’aimait d’ailleurs éperdûment: sa mère, de toute son âme; son père, de tout son cœur et de tout son orgueil; il avait donc pris, dès l’enfance, l’habitude de ne pas bien comprendre quelles raisons il pouvait y avoir à ne pas satisfaire ses désirs; comme presque toujours, l’enfant gâté s’était épanoui en égoïste inconscient.
Au moral, à vingt-quatre ans, c’était un excellent garçon, ami dévoué, fils respectueux et tendre; promettant un époux charmant et un père Irréprochable; mais, en ; attendant, c’était surtout un parfait gentleman, membre du Jockey, un des fondateurs du Mirliton, grand sou-[peur, grand coureur d’aventures galantes, aimant jouer, mais adorant parier, allant aux courses, pour les poules et pour les cocottes–(l’expression était de lui),–trouvant que tout était bien dans le meilleur des mondes, si l’on pouvait à sa guise manger ses revenus et parfois toucher au capital; d’autant plus charmé de vivre ainsi que son père, pour des raisons très-particulières, paraissait enchanté des fredaines de son fils et laissait largement ouverte la bourse paternelle.
Au physique, ainsi que Galathée l’avait déjà dit à Surin, c’était un beau garçon, fort capable de faire battre plus d’un cœur et sachant admirablement bien se vêtir, se coiffer, s’adorner de façon à faire ressortir ses avantages naturels; il avait, plus que beaucoup de ses amis de cercle, le grand art d’obéir au goût du jour, tout juste ce qu’il faut pour satisfaire tout le monde et ne point blesser les délicats; il évitait adroitement le ridicule si souvent caché dans les plis d’un vêtement nouveau, restant toujours un courtisan de la mode, mais évitant de jamais paraître son humble serviteur.
Jusqu’à cette aventure, Georges n’avait été que quelqu’un dans la foule, mais quelqu’un de promis à de nombreux et retentissants succès; peut-être parce qu’il était venu fort tard prendre place parmi les coureurs d’aventures, il avait mis une telle ardeur, une telle fougue en ses moindres actions, qu’il avait donné l’éveil à bien des jalousies comme à bien des espérances; on avait pris cela pour de la passion véritable; il avait paru posséder un tempérament de véritable viveur; au fond, c’était simplement l’avidité gourmande d’un enfant qui goûte un fruit nouveau, le trouve agréable et veut en manger encore jusqu’à la satiété.
Mme de Cerny, retenue par l’âge, dans son hôtel l’hiver, dans son château de Saint-Cloud l’été, ne savait que fort peu de chose des prouesses galantes et bachiques de monsieur son fils; mais elle adorait Georges à ce point que, tout ce qui le rendait heureux lui paraissait presque impossible à critiquer; et puis, on ne doit pas, on ne peut pas élever un garçon comme une demoiselle; il faut que jeunesse se passe; un peu de folie vous donne plus tard beaucoup de sagesse; il faut bien savoir ce que c’est que la vie; lorsqu’on a vu ce que c’est que les joies éphémères du plaisir, on comprend et l’on apprécie mieux les véritables joies de la famille, et toutes les autres banalités que l’on se dit à soi-même pour se convaincre qu’il ne faut pas gronder son fils bien-aimé.
Pour M. de Cerny, le cas était tout différent; il savait absolument tout ce que faisait son fils, non point par le détail, ce qui importait peu à ses projets, mais dans le résultat, ce qui était nécessaire; il avait lui-même, sans que Georges en eût le moindre soupçon, conduit son fils en cette aristocratiquement mauvaise et banale compagnie, où le jeune homme avait trouvé des professeurs de ice élégant; en lui-même, il avait jugé bon que le viomte de Cerny fût, pendant deux ans et demi, trois ans, un des membres actifs des clubs de la haute vie pariienne; il avait condamné Georges à faire toutes les folies qui lui passeraient ou, qu’au besoin, on lui ferait passer par la tête, et cela pour que la famille de Cerny pût s’allier à la famille de Troismont.
Ce mariage était en effet le réve implacable de M. de Cerny; il faisait de son fils le plus riche gentilhomme de France, car Mlle Eglé de Troismont avait cinq millions de dot et trente-sept millions d’espérances.
Mais la jeune fille avait quatorze ans et sept mois seulement, et le mariage, convenu depuis longtemps déjà, ne devait avoir lieu qu’après que Mlle de Troismont aurait atteint sa dix-septième année; c’était plus de deux ans à passer, deux ans terribles, deux ans qu’il fallait faire s’écouler sans qu’ils pussent paraître longs. Or, qui pourrait, mieux que le plaisir, faire oublier le temps à un jeune homme ardent, fait pour plaire, riche et guidé dans l’ivresse par un invisible et prudent ami?
D’ailleurs, il n’y avait pas à hésiter: il fallait permettre les amours qui laissent libre pour éviter l’amour qui prend tout l’avenir; des femmes, soit; mais pas une de celles-là que l’on puisse, que l’on doive épouser.
M. le comte de Cerny avait eu trop grande peur une première fois pour ne pas prendre de bonnes précautions.
Près de Mme de Cerny, en effet, il y avait une adorable jeune fille de dix-huit ans, Mlle Jeannette de Nezel, que Georges avait cru aimer d’amour, que Georges avait parlé d’épouser.
Or, il avait fallu compter avec cette passion, vu qu’on devait à la mère de Jeannette la vie de Georges.
Après dix ans de mariage stérile, Mme de Cerny avait eu la joie immense d’être mère. Malheureusement, les suites des couches furent si laborieuses que Mme de Cerny ne put nourrir la frêle créature à qui le sein était nécessaire, indispensable. Cette idée de confier son fils à une étrangère lorturant la comtesse, une de ses amies, qui avait un fils âgé de treize mois, sevra son enfant et donna le sein à Georges. Hélas! Georges fut sauvé, mais le petit garçon de Mme de Nezel, trop tôt sevré, mourut au bout de quelques mois.;
La douleur de tous ne se calma que lorsque Dieu sembla vouloir récompenser Mme de Nezel et payer un peu de la dette de la famille de Cerny. Quinze mois après le salut de Georges, Mme de Nezel devint grosse, mais il était dit que son dévouement ne devait point être récompensé sur terre. Elle mourut en donnant le jour à une fille et en emportant de son amie le serment que cette enfant serait la seconde enfant de la maison de Cerny.
Il n’avait donc pu être un instant question d’éloigner Mlle de Nezel. Et puis, c’est qu’elle était adorable, cette sœur de lait, cette amie d’enfance, cette fiancée du berceau; c’était une belle fille au doux regard, souriant et tranquille, portant sur un front large et merveilleusement modelé une forêt de cheveux châtains, dorés au soleil, sombres à l’ombre; vive, rieuse comme une brune; douce et charmeuse comme une blonde. Elle avait encore le charme, l’esprit et le cœur. Enfin elle avait des doigts de fée, et c’est à prix d’or, aux ventes de charité, que l’on se disputait ses broderies, qu’elle vendait elle-même. jouant à la marchande comme il est de mode depuis quelques années, le sourire aux lèvres, voletant comme un oiseau autour de Mme de Cerny, gravement déguisée en caissière et mettant bravement ses lunettes sur son nez pour compter la recette des pauvres; enfin et surtout, elle avait une voix splendide, pleine et chaude, doucement sonore, ample, merveilleusement souple, capable de la rendre célèbre en une heure et riche en un jour.
C’eût été un miracle que deux enfants, ainsi élevés l’un près de l’autre, se sachant tout autre chose que frère et sœur, se devinant peut-être fiancés dans le secret de vieilles espérances intimes, n’eussent pas eu quelques velléités d’amourette: donc, Georges et Jeannette avaient cru s’aimer très-sérieusement; ils s’aimèrent si bien même que leur union parut inévitable aux amis intimes de la famille, d’ailleurs instruits du dévouement de Mme de Nezel, et voyant dans ce mariage une façon délicate de payer à la fille ce que l’on devait à la mère.
Seuls peut-être, M. et Mme de Cerny ne voyaient rien. Pourquoi? Par l’éternelle raison que ceux qui poursuivent implacablement un but n’aperçoivent jamais le grain de sable qui fait verser le char.
Un jour, en voyant entrer Georges et Jeannette bras dessus, bras dessous, riant à belles lèvres en devisant de bagatelles, se taquinant, se renvoyant épigramme pour épigramme et se disant des yeux tout le contraire de ce que disait la bouche, un ami demanda à M. de Cerny si le mariage de ces enfants allait bientôt avoir lieu.
Le jour même, M. de Cerny eut un entretien sérieux avec la comtesse; la brave mère était facile à tromper; il s’agissait des intérêts, de l’avenir, du bonheur de son fils; il lui fit facilement entendre que les enfants n’en étaient qu’à l’amité et qu’il fallait veiller à ce que cette amitié ne devînt pas de l’amour.
Le soir, Georges fut prié, par son père, de venir lui parler en particulier. Les grâces présentes et futures, l’immense fortune de Mlle de Troismont, furent alors l’objet d’un éloge pompeux et même enthousiaste jusqu’au lyrisme; renoncer à pareille union, ce serait une folie inqualifiable. Georges protesta; M. de Cerny insista; Georges fit alors une charge à fond de train contre les mariages d’ambition et d’argent. M. de Cerny, en véritable parlementaire qu’il avait été, fit adroitement volte-face et parut convaincu. Tendant alors la main à son fils, il lui dit: Soit, je n’avais jamais eu l’intention que tu pa rais me supposer de faire passer les questions d’intérê avant les raisons du cœur, mais il suffit que tu puisses me soupçonner de ce sentiment indigne de nous pour que je tienne à me disculper; je vois ton bonheur d’un côté, tu crois le trouver d’un autre, soit; ne discutons plus; tu es trop jeune; celle que tu crois aimer et celle que je te destinais sont trop jeunes aussi pour que nous ayons besoin de nous convaincre tout de suite; voici ce que je crois devoir te proposer:–Demain, nous partons; nous visiterons la Suisse, l’Italie, les pays que tu désireras connaître; je suis à tes ordres comme cicérone; nous voyagerons un an; tu vas me donner ta parole, et je donne ici la mienne, de ne jamais parler ni de Mlle de Nezel, ni de Mlle de Troismont pendant cette année de voyage. A notre retour seulement, sur ta demande seule, nous causerons, si tule juges utile, et je te le jure, tu seras libre d’écouter alors ou ton cœur seul ou mon expérience et mon amitié.
Georges, radieux, avait accepté, en murmurant:– Dans un an, Jeannette, je serai donc ton époux!
Quinze mois après, Georges s’amusait comme un fou; il jouait, il aimait, il vivait largement, et Mlle de Nezel, pas plus que Mlle de Troismont, ne troublait ses nuits de plaisir; il était, d’ailleurs, dans l’ivresse du premier triomphe; ce qu’il venait de faire l’avait rendu célèbre;’ on ne parlait que de lui: au théâtre, on se le montrait et on le lorgnait autant que le premier ténor ou que l’artiste en vogue; les hommes l’enviaient, les femmes le regardaient de l’air le plus charmant du monde.
Pensez donc! Le jour de la légendaire promenade au Bois, au milieu d’un souper où s’était retrouvée toute la galanterie parisienne, le jeune duc de Bouchy, au nom du high-life, avait porté un toast à Georges; après quoi, la grande Cora, qui avait réussi à apprendre par cœur la phrase suivante, s’était écriée:
–Richelieu est mort, vive de Cerny!