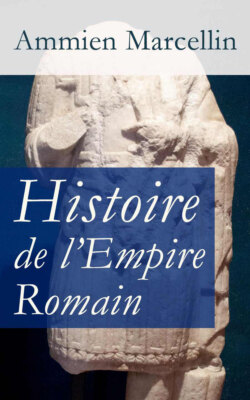Читать книгу Histoire de l'Empire Romain: Res gestae: La période romaine de 353 à 378 ap. J.-C. - Ammien Marcellin - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapitre XII
ОглавлениеTable des matières
XII. On sut bientôt l’affront que venaient d’essuyer, nos armes. Les rois allemands Chnodomaire et Vestralpe opérèrent une jonction de leurs forces, auxquelles se réunirent successivement Urius,Ursicin, Sérapion, Suomaire et Hortaire ; et les confédérés allèrent camper près d’Argentoratum, se flattant de l’idée que Julien s’était replié dans la crainte d’un désastre complet, tandis qu’en réalité il continuait à s’occuper des fortifications des Trois Tavernes. Ils devaient surtout cette confiance au rapport d’un scutaire que la crainte de quelque châtiment avait fait déserter peu après l’échec essuyé par Barbation, et qui leur dit que J ulien n’avait pas avec lui plus de treize mille hommes. C’était avec ce nombre en effet que César avait d’abord fait tête au déchaînement universel de la rage des barbares. Le transfuge répéta son assertion avec une assurance qui mit le comble à leur audace. Ils dépêchèrent vers Julien une députation pour lui intimer, du ton le plus impérieux, l’injonction de quitter un pays qui leur appartenait, disaient-ils, par le droit de la valeur et la fortune de leurs armes. Celui-ci, qu’on n’effrayait pas aisément, reçut sans émotion un tel message ; mais, tout en se moquant de la jactance des barbares, il signifia aux envoyés qu’il les retenait près de lui jusqu’à l’achèvement des travaux, et garda tranquillement sa position.
Parmi les confédérés le roi Chnodomaire se donnait un mouvement incroyable, allant, venant, se multipliant, toujours le premier quand il s’agissait d’un coup de main, et plein de cette confiance que donne l’habitude du succès. Il avait effectivement battu le César Décence à forces égales, détruit ou dévasté nombre de villes opulentes, et promené à son gré le ravage dans la Gaule sans défense. Il venait encore (ce qui n’accrut pas peu sa présomption) de chasser devant lui un général romain avec un corps nombreux de troupes d’élite ; car les Allemands avaient reconnu aux insignes des boucliers que ceux qui venaient de lâcher pied devant quelques-uns de leurs coureurs étaient les mêmes soldats qui avaient battu et dispersé leurs forces en tant de rencontres. Tout cela ne laissait pas de faire impression sur César, qui se voyait avec inquiétude réduit, par la défection de son associé, à engager une poignée de braves gens contre des populations entières.
La trompette sonna aux premières lueurs du jour, et l’infanterie se mit en marche d’un pas mesuré, flanquée sur les deux ailes par la cavalerie, qui était elle-même renforcée des deux redoutables corps des cataphractes et des archers à cheval. L’armée avait encore quatorze lieues ou vingt-un milles à franchir, de son point de départ au camp des barbares, quand Julien, dans sa prudente sollicitude, rappela tous ses avant-postes, donna le commandement de halte, et, se plaçant au centre de l’armée distribuée en sections formant le coin et qui rayonnaient autour de sa personne, avec cette élocution paisible qui lui était naturelle, leur adressa ce discours :
“Mes chers compagnons, vous avez le sentiment de votre force, et cette noble confiance qu’il inspire ; mais le chef qui vous parle n’est pas non plus suspect de manquer de cœur. Il peut être cru quand, au nom du salut commun, Il vient vous dire (ce peu de mots d’ailleurs vont vous le démontrer) qu’il faut, dans les épreuves de patience ou de courage qui nous attendent, écouter les conseils de la circonspection et de la prudence, et non ceux de la précipitation et d’une ardeur inconsidérée. Les hommes d’action, fiers et intrépides quand le péril est là, ont bonne grâce à se montrer à propos réfléchis et dociles. Voici l’avis que je vous soumets et que je vous conjure d’adopter, si vous pouvez prendre à ce point sur la juste indignation qui vous anime. Il est près de midi : nous allons, déjà fatigués par la marche, entrer dans des défilés tortueux et obscurs ; la lune sur son déclin nous menace d’une nuit ians lumière ; il ne faut pas s’attendre à trouver une goutte d’eau sur ce sol brûlé par la sécheresse. — Nous triompherons, je le veux, de tous ces obstacles ; mais où en serons nous quand. nous allons avoir par milliers sur les bras l’ennemi, reposé, repu, rafraîchi ? De quel air soutiendrons-nous son choc, nous, épuisés par la fatigue, par la faim, par la soif ? D’une seule disposition dépend quelquefois le succès dans les circonstances les plus critiques. Un bon avis, pris en bonne part, est une de ces voies que nous ouvre la Providence pour sortir des positions les plus désespérées. Croyez-moi, campons ici, sous la protection d’un fossé et d’une palissade ; passons cette nuit nous reposant et veillant tour à tour ; et demain au lever du soleil, restaurés par le sommeil et par la nourriture, nous déploierons de nouveau, avec l’aide de Dieu, nos aigles et nos enseignes victorieuses”.
On ne le laissa pas achever. Le soldat, témoignant de son impatience par des grincements de dents, et le fracas de toutes les piques heurtant contre les boucliers, voulait immédiatement être mené à l’ennemi, qui déjà se trouvait en vue. Tous comptaient sur le ciel, sur eux-mômes, et sur la fortune et la valeur éprouvées de leur général. Et en effet, comme le prouva la suite, ils semblaient, tant qu’il fut à leur tête, inspirés par le génie même des combats. Ce qui augmentait l’entraînement, c’est que les chefs le partagèrent ; et Florence, préfet du prétoire, plus décidément que tous les autres. « Il étaitd’une bonne politique, disait-il, d’en venir aux mains coûte que coûte, pendant que les barbares étaient réunis. On aurait trop à faire, une fois la confédération dissoute, avec cette fièvre de séditions si habituelle au soldat, qui cette fois aurait le prétexte spécieux de s’être vu enlever la victoire. Un double souvenir mettait le comble à la confiance de l’armée. Les Romains, l’année précédente, avaient franchi la barrière du Rhin, et fait des courses sur la rive droite, sans qu’un seul ennemi se fût montré pour défendre le sol de son pays. Les barbares s’étaient contentés d’entraver les rentes par des abatis d’arbres ; puis, s’enfonçant dans les terres, avaient passé l’hiver misérablement sans abri contre un ciel rigoureux. Une autre fois, l’empereur en personne avait occupé leur territoire sans qu’ils eussent osé résister ni paraître, et ce n’est pour implorer la paix en suppliant.
Mais on ne voulait pas voir que les circonstances avaient bien changé. Les Allemands, dans la première occurrence, étaient pressés de trois côtés à la fois : par l’empereur, qui menaçait la Rhétie ; par César, qui leur fermait absolument l’entrée des Gaules ; enfin par des nations limitrophes, qui s’étaient déclarées contre eux et les prenaient à dos. La paix une fois conclue avec l’empereur, celui-ci avait retiré son armée ; ils avait alors accordé leurs différends avec leurs voisins, qui s’étaient joints à eux pour agir de concert ; et, tout récemment encore, la fuite honteuse d’un général romain venait d’ajouter à leur fierté naturelle. Un événement étranger aggravait d’ailleurs notre position. Les rois Gundomade et Vadomaire, liés par le traité qu’ils avaient obtenu de Constance l’année précédente, n’avaient osé jusque-là prendre part au mouvement, ni écouter aucune proposition à cet égard. Mais voilà Gundomade, le meilleur des deux et le plus sûr dans ses engagements, qui périt victime d’une trahison ; tout son peuple aussitôt se réunit à la ligue ; et Vadomaire (c’est du moins ce qu’il affirma) ne put empêcher le sien de prendre également parti pour nos adversaires.
Aux premiers rangs comme aux derniers, l’armée se montrait donc unanime sur l’opportunité de marcher immédiatement à l’ennemi, autant que disposée à se raidir contre l’ordre contraire. Alors un porte-étendard s’écria soudain ; « En avant, César, ô le plus heureux de tous les hommes. La fortune elle-même guide tes pas. Nous comprenons seulement depuis que tu nous commandes ce que peut la valeur unie à l’habileté. Montre-nous le chemin du succès en brave qui devance les enseignes ; et nous te montrerons, nous, ce que vaut le soldat sous l’œil d’un chef vaillant, qui juge par lui-même du mérite de chacun”.
A ces mots, sans accepter de relâche, l’armée s’ébranle de nouveau, et parvient au pied d’une colline en pente douce, couverte de blés déjà mûrs, et située à peu de distance de la rive du Rhin. Trois cavaliers ennemis étaient en observation au sommet, et coururent à toute bride annoncer aux leurs notre approche. Mais une quatrième vedette qui était à pied, et ne put suivre les autres, fut gagnée de vitesse par nos soldats, et nous apprîmes d’elle que l’armée germaine avait employé trois jours et autant de nuits à passer le Rhin. Nos chefs pouvaient déjà voir l’ennemi former ses colonnes d’attaque. On commande halte ; et aussitôt les antépilaires, des hastaires et leurs serre-files se mettent en ligne et restent fixes, présentant un front de bataille aussi solide qu’un mur. Même immobilité dans les rangs ennemis, qui veulent imiter notre réserve. Voyant toute notre cavalerie placée à l’aile droite, ils lui opposèrent à leur gauche, et par masses serrées, l’élite de leurs cavaliers, dans les rangs desquels, par une tactique très bien entendue, et dont lis devaient l’idée au transfuge déjà mentionné, ils jetèrent çà et là des fantassins agiles, et armés à la légère. Ils avaient remarqué en effet que les rênes et le bouclier ne laissant à leurs gens de cheval qu’une main libre pour lancer le javelot, le plus exercé, dans un combat corps à corps avec un de nos “clibanares”, ne faisait que s’escrimer en pure perte contre le guerrier complétement abrité sous son armure de fer ; mais qu’un fantassin pouvait, inaperçu dans la chaleur du conflit, et quand on ne songe qu’à ce au’on a devant soi, se glisser sous les flancs du cheval, l’éventrer, et démonter ainsi l’ennemi invulnérable, dont alors on avait bon marché.
Non contents de cette disposition, ils nous ménageaient à leur droite un autre genre de surprise. Cette belliqueuse et féroce armée avait pour chefs suprêmes Chnodomaire et Sérapion, les plus puissants entre tous les rois confédérés. A l’aile gauche, où, suivant l’attente des barbares, la mêlée devait être plus furieuse, se montrait le funeste promoteur de cette levée de boucliers, Chnodomaire, le front ceint d’un bandeau couleur de flamme, et montant un cheval couvert d’écume. Amoureux du danger, plein de confiance en sa force prodigieuse, il s’appuyait fièrement sur un javelot de dimensions formidables, et frappait de loin les yeux par l’éclat de ses armes. Dès longtemps il avait établi sa supériorité comme brave soldat et comme chef habile. Sérapion commandait l’aile droite. Il entrait à peine dans la fleur de l’âge, mais la capacité chez lui avait devancé les années. C’était le fils de ce Médérich, frère de Chnodomaire, dont la vie entière n’avait été qu’un tissu de perfidies. Médérich, qui avait fait comme otage un long séjour dans les Gaules, s’y était initié à quelques-uns des mystères religieux des Grecs. C’est à cette circonstance qu’était dû le changement de nom d’Agénarich, son fils, en celui de Sérapion. Venaient en seconde ligne cinq rois inférieurs en puissance, dix fils ou parents de rois, et, derrière ceux-ci, une longue série de noms imposants chez les barbares. La force de cette armée était de trente-cinq mille combattants, tirés de diverses nations. Une partie était soldée, et le reste servait, en vertu de traités d’assistance réciproque.
Le terrible signal des trompettes avait résonné, lorsque Sévère, qui conduisait notre aile gauche, aperçut devant lui, à peu de distance, des tranchées remplies de gens armés qui devaient, se levant tout à coup, porter le trouble dans ses rangs. Sans s’émouvoir, il suspend toutefois sa marche, ne sachant à quel nombre il avait affaire ; craignant d’avancer, et ne voulant pas reculer. César voit de l’hésitation sur ce point ; il y vole avec une réserve de deux cents cavaliers qu’il gardait autour de sa personne, prêt à se porter où sa présence était le plus nécessaire, et toujours plus animé quand le péril était plus grand. D’une course rapide il parcourt le front de l’infanterie, distribuant partout les encouragements. Comme l’étendue des lignes et leur profondeur s’opposait à toute allocution générale, et qu’il ne se souciait point d’éveiller les jalousies du pouvoir en s’arrogeant ce qu’il regardait lui-même comme la prérogative du chef de l’État, il se contenta de voltiger çà et là, se garantissant comme il pouvait des traits de l’ennemi ; et jetant à chacun, connu ou non connu, quelques mots énergiques. Il les exhortait tous à faire leur devoir. Eh bien ! mes amis, disait-il aux uns, voici enfin une bataille en règle. C’est le moment qu’appelaient vos vœux et les miens, et que votre impatience devançait toujours. S’adressant ensuite aux derniers rangs : “Camarades, il est venu le jour tant désiré qui nous appelle tous à effacer les taches imprimées au nom romain, et à lui rendre son ancien lustre. Voyez, les barbares viennent ici chercher un désastre ; une aveugle fureur les pousse à s’offrir eux-mêmes à vos coups”. Aux guerriers qu’une longue habitude rendait aptes à juger des manœuvres, il disait, tout en rectifiant quelque disposition - “Allons, braves soldats, réparons par de nobles efforts les affronts qu’ont essuyés nos armées. C’est dans cet espoir que, malgré mes répugnances, j’acceptai le titre de César”. A ceux qui demandaient étourdiment le signal, et dont la pétulance menaçait d’enfreindre les commandements et de causer du désordre : « Gardez-vous, disait-il, gardes-vous, quand l’ennemi tournera le dos, de trop vous acharner sur les fuyards ; ce serait compromettre l’honneur de votre succès. Que nul aussi ne céde le terrain qu’à la dernière extrémité ; car, aux lâches, point d’assistance de ma part. Mais je serai là pour seconder la poursuite, pourvu qu’elle se fasse sans emportement inconsidéré. » Parlant ainsi à chacun son langage, il fait avancer la plus grande partie de ses forces contre la première ligne des barbares. Ce fut alors parmi l’infanterie allemande, contre les chefs qui étaient montés, un frémissement d’indignation qui bientôt éclata en vociférations effroyables. Il fallait, disait-on, qu’ils combattissent à pied comme les autres, et que nul ne pût se ménager, en cas de fuite, un moyen de sauver sa personne, en abandonnant le reste à son sort. Cette manifestation fit quitter à Chnodomaire son cheval, et son exemple fut aussitôt suivi. Pas un ne mettait en doute que la victoire ne dût se déclarer pour eux.
L’airain donne le signal, et des deux parts on en vient aux mains avec la même ardeur, en préludant par des volées de traits. Débarrassés de leurs javelots, les Germains se lancent sur nos escadrons avec plus d’impétuosité que d’ensemble, en rugissant comme des bêtes féroces. Une rage plus qu’ordinaire hérissait leur épaisse chevelure, et leurs yeux étincelaient de fureur. Intrépides sous l’abri de leurs boucliers, les nôtres paraient les coups, ou, brandissant le javelot, présentaient la mort aux yeux de l’ennemi.
Pendant que la cavalerie soutient la charge avec vigueur, l’infanterie serre ses rangs, et forme un mur de tous les boucliers unis. Un épais nuage de poussière enveloppe la mêlée. Nous combattons avec des chances diverses, ici tenant ferme, là repoussés ; car les Germains, rompus la plupart à cette espèce de manœuvre, s’aidaient de leurs genoux pour enfoncer nos lignes. C’était un corps à corps universel, main contre main, bouclier contre bouclier ; et l’air retentissait de cris de triomphe et de détresse. Enfin notre aile gauche, s’ébranlant de nouveau et chassant devant elle des multitudes d’ennemis, venait avec furie prendre part à cet engagement, lorsque inopinément la cavalerie lâcha pied à l’aile droite, et se replie s’entre-choquant jusqu’aux légions, où, trouvant un point d’appui, elle put se reformer. Voici ce qui avait causé cette alarme. Le chef des cataphractes, en rectifiant un vice d’alignement, reçut une blessure légère ; et l’un des siens, dont le cheval s’abattit, resta écrasé sous le poids de l’animal et de son armure. Ce fut assez pour que le reste se dispersât ; et ils eussent tous passé sur le ventre à l’infanterie, ce qui eût causé un désordre général, si cette dernière n’avait soutenu leur choc par sa masse et par sa résolution.
De son côté, César voit cette cavalerie éparse, et cherchant son salut dans la fuite. Il pousse à elle, et se jette au-devant comme une barrière. Le tribun de l’un des escadrons l’avait reconnu, en voyant de loin-flotter au haut d’une pique le dragon de pourpre qui guidait son escorte, enseigne dont la vétusté attestait les longs services. Plein de honte, et la pâleur sur le front, cet officier court aussitôt rallier sa troupe. Julien alors, s’adressant aux fuyards de ce ton persuasif qui ramenait les cœurs les plus ébranlés : “Où courons-nous, braves gens ? leur dit-il. Ne savez-vous pas qu’on ne gagne rien à fuir, et que la peur elle-même ne peut conseiller un plus mauvais parti ? Allons donc rejoindre les nôtres qui combattent pour la patrie, et ne perdons pas, en les abandonnant sans savoir pourquoi, la part qui nous reviendra du triomphe commun”.
Par cette adroite allocution, il les ramène à la charge, renouvelant ainsi, à quelques particularités près, un trait qui jadis avait honoré Sylla. Abandonné des siens dans une rencontre où il se trouvait pressé par Archélaüs, lieutenant de Mithridate, Sylla saisit l’étendard, le lance au milieu des ennemis, et dit à ses soldats : “Allez, vous qu’on avait désignés pour partager mes périls. Et si l’on vous demande où vous avez perdu votre général, répondez (et vous direz vrai) : En Béotie, où nous l’avons laissé seul combattre et verser son sang pour nous”.
Profitant de leur avantage et de la dispersion de la cavalerie, les Allemands fondent sur notre première ligne de pied, comptant trouver des hommes ébranlés, et peu capables d’une résistance énergique. Mais leur choc fut soutenu, et l’on se battit longtemps sans que la balance penchât d’un côté ni de l’autre. Les Cornutes et les Braccales, milices aguerries à ces gestes effrayants qui leur sont propres joignirent alors ce terrible cri de guerre qu’ils font entendre dans la chaleur du combat, et qui, préludant par un murmure à peine distinct, s’enfle par degrés, et finit par éclater en un mugissement pareil à celui des vagues qui se brisent contre un écueil. Les armes se choquent, les combattante se heurtent au milieu d’une grêle sifflante de dards, et d’un épais nuage de poussière qui dérobe tous les objets. Mais les masses désordonnées des barbares n’en avancent pas moins avec la fureur d’un incendie ; et plus d’une fois la force de leurs glaives parvint à rompre l’espèce de tortue dont se protégeaient nos rangs par l’adhérence de tous les boucliers. Les Bataves voient le danger, sonnent la charge ; secondés par les rois, ils arrivent au pas de course au secours de nos légions, et le combat se rétablit. Cette troupe formidable devait, le sort aidant, décider du succès dans les circonstances même les plus critiques. Mais les Allemands, qu’une rage de destruction semblait avoir saisis, n’en continuaient pas moins leurs efforts désespérés. Ici, sans interruption, les dards, les javelots volent ; les carquois se vident ; là on se joint corps à corps ; le glaive frappe le glaive, et le tranchant des armes entr’ouvre les cuirasses. Le blessé, tant qu’il lui reste une goutte de sang, se soulève de terre, et s’acharne à combattre. Les chances de part et d’autre étaient à peu près égales. Les Germains l’emportaient par la taille et l’énergie des muscles ; les nôtres, par la tactique et la discipline ; aux uns, la férocité, la fougue ; aux autres, le sang-froid, le calcul. Ceux-ci comptaient sur l’intelligence, ceux-là sur la force du corps. Pliant quelquefois sous les coups de l’ennemi, le soldat romain se redressait bien vite. Le barbare, qui sentait ses jarrets se dérober, se battait encore, un genou en terre. L’horreur de céder ne saurait aller plus loin.
Tout à coup les principaux Germains, leurs rois en tête, et suivis de la multitude obscure, fondent sur notre ligne en colonne serrée, et s’ouvrent un passage jusqu’à la légion d’élite placée au centre de bataille, et formant ce qu’on appelle la réserve prétorienne. Là les rangs plus pressés, les files plus profondes, leur opposent une masse compacte, inébranlable comme une tour ; et le combat recommence avec une nouvelle vigueur. Attentifs à parer les coups, et s’escrimant du bouclier à la manière des “mirmillons”, nos soldats perçaient aisément les flancs de leurs adversaires, qui, dans leur fureur aveugle, négligeaient de se couvrir. Ceux-ci, prodigues de leurs vies, et ne songeant qu’à vaincre, font les derniers efforts pour rompre l’épaisseur de nos lignes. Mais les nôtres, de plus en plus sûrs de leurs coups, couvrent le sol de morts, et les rangées d’assaillants ne se succèdent que pour tomber tour à tour. Enfin leur courage fléchit, et les cris des blessés et des mourants achèvent de les glacer. Accablés de tant de pertes, il ne leur restait plus de force que pour fuir ; ce qu’ils tirent soudain dans toutes les directions, avec cette précipitation du désespoir qui pousse des naufragés à toucher la première plage qui se présente à leurs yeux.
Quiconque fut témoin de cette victoire conviendra qu’elle était plus souhaitée qu’elle n’était attendue. Sans doute un dieu propice intervint ce jour-là pour nous. Nos soldats chargèrent à dos les fuyards, et, à défaut de leurs épées émoussées qui plus d’une fois refusèrent le service, ils arrachaient la vie aux barbares avec leurs propres armes. Ni les yeux ne se rassasiaient de voir couler le sang, ni les bras de frapper. Nul ne reçut de quartier. Une foule de guerriers, blessés à mort, imploraient le trépas pour abréger leurs souffrances ; d’autres, au moment d’expirer, soulevaient un œil mourant, pour chercher une dernière fois la lumière. Des têtes tranchées par le large fer des javelots pendaient encore au tronc dont elles venaient d’être séparées. On trébuchait, on tombait par monceaux sur le sol détrempé de sang ; et plus d’un périt écrasé par les siens, qui s’était tiré du combat sans blessure. Les vainqueurs, enivrés de leurs succès, frappaient encore de leurs épées émoussées les casques splendides et les boucliers, qui sous leurs coups roulaient dans la poussière. Enfin les barbares aux abois, acculés jusqu’au Rhin, et enfermés comme par un mur de cadavres entassés, ne voient plus de salut pour eux que dans le fleuve. Pressés par nos soldats, que leur pesante armure ne saurait retarder dans leur poursuite, quelques-uns se précipitèrent dans les flots, comptant sur leur habileté à nager pour sauver leurs jours. César, qui vit aussitôt le danger de trop d’entraînement pour les nôtres, défendit à haute voix, et fit proclamer par les chefs et les tribuns, la défense à tout soldat de s’engager, en suivant de trop près l’ennemi, dans les eaux tourbillonnantes. On se contenta donc de border la rive, et de faire pleuvoir sur l’ennemi une foule de traits de toute espèce. La plupart de ceux que la fuite dérobait à nos coups trouvaient, s’abîmant de leur propre poids, le trépas au fond du fleuve. Alors la scène présenta sans danger un intérêt dramatique. Ici le nageur se débat contre l’étreinte désespérée de celui qui ne sait pas nager, et le laisse flotter comme un tronc, s’il parvient à s’en défaire. Là, saisis par les tourbillons, les plus habiles roulent sur eux-mêmes, et sont engloutis. Quelques-uns, portés par leurs boucliers, sans cesse déviant pour éviter le choc des vagues, parviennent, après mille hasards, à toucher enfin l’autre bord. Le fleuve, rougi des flots du sang barbare, s’étonne de la crue soudaine de ses eaux. Au milieu du désastre ; le roi Chnodomaire, qui avait su échapper, en se glissant entre des monceaux de cadavres, s’efforçait de regagner au plus vite le campement qu’il occupait avant sa jonction à peu de distance de deux forts romains. Il avait fait réunir de longue main, et en cas d’échec, des embarcations dont il songeait en ce moment à se servir pour chercher quelque retraite obscure, et y attendre un changement de la fortune. Comme il ne pouvait y arriver qu’en passant le Rhin, il revint sur ses pas, ayant la précaution de se couvrir la figure. Il approchait de la rive du fleuve, lorsqu’en tournant une espèce de marécage qui se trouvait sur son chemin avant d’arriver au point d’embarquement, son cheval s’abattit dans un terrain fangeux, et le renversa sous lui. Malgré sa corpulence il parvint à se dégager, et à gagner une colline boisée qui n’était pas loin de là. Mais il fut reconnu ; l’éclat même de son ancienne grandeur l’avait trahi. Aussitôt une cohorte commandée par un tribun enveloppa de tous côtés la colline, sans chercher à pénétrer dans le fourré, dans la crainte de rencontrer quelque embuscade. Chnodomaire alors se vit perdu, et se décida à se rendre. Il était seul dans le bois ; mais deux cents hommes qui formaient sa suite et trois de ses plus intimes amis vinrent d’eux-mêmes se livrer, regardant comme un crime de survivre à leur roi, et de ne pas donner, s’il le fallait, leur vie pour sauver la sienne. Les barbares, insolents dans le succès, sont d’ordinaire sans dignité dans le malheur.
Chnodomaire, la pâleur au front, montra, tandis qu’on l’entraînait, la contenance dégradée d’un esclave : la conscience du mal qu’il avait fait enchaînait sa langue. Combien différent, alors du féroce dévastateur que le deuil et la terreur annonçaient naguère, et qui, foulant aux pieds la Gaule en cendres, menaçait de ne pas borner là ses ravages !
La bataille ainsi terminée par l’assistance du ciel, vers la chute du jour le clairon rappela notre invincible armée, qui, réunie près la rive du Rhin, put enfin, sous la protection active de plusieurs lignes de boucliers, prendre quelque nourriture et du repos. Les Romains perdirent dans cette action deux cent quarante-trois soldats et quatre chefs principaux, Bainobaudes, tribun des Cornutes, Laipse et Innocent, officiers des cataphractes, et un tribun dont le nom ne s’est pas conservé. Du côté des Allemands, six mille morts restèrent sur le champ de bataille, indépendamment du nombre infini de cadavres que le Rhin entraîna dans son cours. Julien, dont l’âme était supérieure encore à sa haute fortune, et qui ne croyait pas grandir son mérite en augmentant son pouvoir, réprimanda sévèrement l’indiscrétion des soldats, qui par acclamation l’avaient salué Auguste : il protesta par serment que ce titre était aussi loin de ses vœux que de ses espérances.
Mais, pour ajouter encore chez eux à l’exaltation du triomphe, il fit amener devant lui Chnodomaire. Celui-ci s’avança en s’inclinant jusqu’à terre, et finalement se prosterna à ses pieds, implorant son pardon à la manière des barbares. Julien le rassura. Quelques jours après, Chnodomaire fut conduit à la cour de l’empereur, puis envoyé à Rome par ce dernier, qui lui assigna pour demeure le quartier des étrangers, sur le mont Palatin. Il y mourut de langueur.
Malgré ces grands et brillants résultats, il ne manquait pas de gens près de l’empereur qui, sachant bien faire ainsi leur cour, trouvaient à Julien des torts ou des ridicules. On lui donna par dérision le surnom de Victorin, parce que, dans ses relations, il revenait assez souvent, bien qu’en termes très modestes, sur ce que les Germains avaient été constamment défaits partout où il avait commandé en personne. Par un tour de force d’adulation dont l’extravagance était palpable, mais bien faite pour chatouiller une vanité portée au delà de toute mesure, on parvint à persuader à Constance que dans tout l’univers il ne se faisait rien de grand que par son influence et sous les auspices de son nom. Cette fumée lui monta au cerveau, et dès ce moment et par la suite on le vit donner hardiment le démenti aux faits, en disant dans ses édits, à la première personne, « J’ai combattu, j’ai vaincu ; j’ai relevé des rois prosternés à mes pieds”, lorsque, dans le fait, tout cela s’était passé sans lui. Qu’un de ses généraux, par exemple, pendant qu’il ne bougeait lui-même d’Italie, eût obtenu quelque avantage sur les Perses, il ne manquait pas d’envoyer dans toutes les provinces de ces lettres au laurier, avant-courrières de ruine, contenant d’interminables récits de l’action, et des hauts faits du prince en première ligne. Les archives publiques conservent encore des édits, monuments d’aveugle jactance, où il s’élève lui-méme jusqu’au ciel : on y trouve même une relation détaillée dé l’affaire d’Argentoratum, dont il était éloigné de plus de quarante marches. On y voit Constance réglant l’ordre de bataille, combattant près des enseignes, poursuivant les barbares, recevant la soumission de Chnodomaire ; et, pour comble d’indignité, pas un mot de Julien. Constance eût enseveli toute cette gloire si la renommée, en dépit de l’envie, n’eût pris soin de la publier.